Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Forum de Motards en Nouvelle Calédonie :: LE COIN DES MOTARDS... :: MOTOS ET MOTARDS : DU SERIEUX A L'HUMOUR
 Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Source
Fred Tran Duc s’en est allé…
Par Jean Jacques Cholot - le Mercredi 03 août 2011
Difficile de trouver les mots pour décrire ce que j’ai ressenti ce matin en découvrant le dernier Moto Journal. Fred Tran Duc s’en est allé le mercredi 20 juillet, rattrapé par ce put.. de crabe.
Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant…
Journaliste à Moto Journal au début des années soixante dix, il nous a régalé avec ses « khomérages » et ses essais légèrement déjantés avant de nous faire voyager chaque semaine avec sa « carte postale d’un bout du monde » relatant ses aventure au guidon d’un…. GT 80 !!!.
Ce globe trotteur insatiable ne tenait pas en place et à peine était-il de retour d’un de ses périples qu’il remettait le couvert, toujours au guidon de « p’tits cubes » qu’il affectionnait particulièrement, n’hésitant pas à leurs donner un surnom.
La puce, Brigitte, Grenouille, ou encore Tacotte la Bultaco avec laquelle il a décroché un titre d’un championnat américain en catégorie motos anciennes, sans oublier Mama San, le vieux Ford qu’il utilisait pour se rendre sur les différentes épreuves, et qui lui servait d’atelier, chambre à coucher, cuisine, salle de rédaction…seront les vedettes de ses récits que je dévorais chaque jeudi dans Moto Coin Coin.
Un hors série racontant son premier périple a été publié. A lire absolument « le tour du monde vécu et raconté par Fred du haut d’un mini Yam ».

J’ai eu la chance de le rencontrer furtivement à Montlhéry lors d’une manifestation d’anciennes au début des années 2000. Il était là avec son vieux fourgon et je crois même que Tacotte était du voyage.
Il s’était retiré au Viet Nam, pays d’origine de son père après un dernier voyage au guidon d’une 125 Zongshen. A sa famille et à ses proches, nos plus sincères condoléances.
Dernière édition par cobalt57co le Mer 16 Jan 2013 - 16:40, édité 1 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Je cite:
Fred Tran Duc: carte postale d'un bout du monde
Il était le trublion, le fou du roi, celui qui aimait ne pas suivre le même chemin que les autres.
J’aimais sa verve, son humour, parfois décapant.
J’imaginais bien que la vie à ses côtés ne devait pas être un long fleuve tranquille, mais ses écrits ne me laissaient jamais indifférents.
Et, il y eut ce jour fatidique où il annonça aux lecteurs de Moto Journal qu’il avait décidé de faire un bout de route au guidon de sa petite moto.

Puis, une photo en noir et blanc le montrant dans les rues de Marseille sur sa Yamaha 80 GT.
Préambule:
A partir de ce jour, j’ai attendu, trois années durant, les nouvelles de ce voyageur atypique qui envoyait ses extraits de carnet de route à Moto Journal.
La Carte postale d’un bout du monde était la première rubrique que je m’empressais de lire, et de relire, souvent, tant Fred me faisait rêver lorsqu’il racontait avec son humour si personnel, sa grande humanité, ses rencontres, ses impressions de voyage
Ses écrits de voyage étaient toujours surprenants, touchants, vivants. Sans m’en rendre compte, ils alimentaient mes envies futures de voyage.
Un an après sa mort, dans le pays d’origine de son père, le Vietnam, où il s’était arrêté lors de son dernier grand voyage, je réalise à quel point ce personnage m’a accompagné dans mes envies sans cesse renouvelées de départ au guidon d’un deux roues.
J'ai, affiché depuis de nombreuses années dans mon bureau, une phrase, d'origine coranique, qu'il faisait sienne: " Ne marche pas orgueilleusement sur la terre car tu ne saurais ni la fendre en deux ni égaler la hauteur de ses montagnes ".
Salut Fred.


--------------------------------------
J'ai longtemps vécu au chaud dans mon village natal, qui, même à quatorze kilomètres de Paris, était en ce temps-là à l'autre bout du monde.
Paris nous était Byzance...
Enfant, comme la plupart, je en voyageais jamais seul. Protégé par le cocon familial, je ne sentais pas les distances. L'automobile paternelle, nid familial compact avec Papa, Maman, frères, chat et bagages accompagnés, était notre bastion. Nous faisions ensemble semblant de nous mouvoir, mais en fait c'est l'étranger qui se mouvait vers nous. Non que nous le méprisions, mais le fait d'être en bloc nous donnait la certitude que rien ne nous empêcherait d'être de retour à l'heure ...
Ce bastion s'écroula un jour, lorsqu'un foutu enfant de Marie trouva malin de graffiter sur le panneau "Paris 14 km", qui était l'une des fiertés de notre commune et de la nationale 14 réunies, "Ouagadougou, 7241 km".
Dis, Papa, c'est vrai que la rue de Paris va à Ouagadougou?
Ce que mon père m'expliqua cette nuit là, assis comme un jurisconsulte sur son lit, main gauche, l'index gardant la page du Fleuve Noir dont mon incursion avait interrompu la lecture, posée sur le dessus du cosy, main droite frottant par moments, comme pour mieux exciter la pensée, sa joue hérissée d'une barbe rêche au baiser, avec un bruit de barbe-à-papa, m'a trois cent mille fois plus impressionné que la révélation des mystères du sexe, laquelle me fut faite, blague à part, par la bande...
Oui, au fond, elle y va: quand tu vas à l'école, en sortant de la maison, il faut que tu tournes à droite, puis à gauche, puis à droite, puis tout droit dans la rue de la station, puis à gauche après chez Madame Large, tout droit et à droite Si tu fais autre chose, tu peux te retrouver n'importe où... En fait, de la maison, il y a des routes qui mènent à Ouagadougou, à Moscou, partout...
- Et si je vais toujours tout droit?
- Si tu vas toujours tout droit, tu fais le tour de la terre et tu reviens à la maison, mais tu arrives par derrière, par le garage; mais on ne peut pas aller tout droit.
- Pourquoi?
- Parce qu'il y a toujours des obstacles à contourner.
Oh, Papa! Qu'as-tu dit?
Et merde alors, j'aurais eu un père comme ton beauf' qui m'aurait dit en bon chrétien " la rue de Paris s'arrête porte de la Chapelle ", tout ça ne serait probablement jamais arrivé...
De la France à l'Italie
CHICHE !
Chiche ! C’est le plus dangereux monosyllabe de la langue française… Il m’advint de l’entendre au bistrot Le Petit Pavois, un soir où, avec quelques amis, nous discutions de raids, comme il était alors à la mode de nommer les voyages en terre plus ou moins lointaines.
« Les raids, affirmais-je avec une emphase hélas coutumière, c’est du pipeau. Ils ne sont l’apanage ni de machines ni d’hommes exceptionnels. Quiconque le veut vraiment peut faire un raid. Tiens, j’en ferais même un avec la Puce, si … ».
Quelqu’un dit « Chiche ! »
Chiche, dans la conversation de gens un tant soit peu fiers, c’est comme « pour voir » au poker. Cela marque la frontière entre le baratin et le jeu qu’on a en main. Seulement, moi, j’avais mieux qu’une quinte flush : j’avais Puce.
C’est ainsi que Puce et moi, on s’est, quelques jours après, retrouvé sur le boulevard périphérique parisien, pour commettre une erreur volontaire : au lieu de prendre la sortie « Porte d’Orléans » qui vous emmène à l’intérieur de Paris, prendre l’autoroute du Sud et partir vers ces pays où, dit-on, les gens arrivent à parler couramment une langue aussi compliquée que le grec, le turc, la parsi, l’arabe, allez savoir …
Il faut que je vous présente Puce. Puce, c’est ma moto. C’est un 80 cc mini Yamaha fier de soi, mais qui souffre de ne pas être pris au sérieux du fait de sa petite taille. Vous voyez, j’ai déjà été obligé à dire « un » mini-Yam, alors qu’il s’agit bel et bien d’une moto. Cette tradition qui veut que les petits cubes soient masculins et les grosses cylindrées féminines.
Lorsque, au cours de notre voyage, près de la frontière turque, un pilote de 125 Yam avec qui on s’était tiré la bourre dans une descente sinueuse a dit : « il marche drôlement, ton mini », j’ai senti Puce se hérisser : encore une fois, on la classait, la reléguait dans un rôle d’engin tout juste bon à faire du porte-à-porte, alors que son truc ; c’est le farniente entremêlé de courses aux grands espaces.
Puce et moi avons bien vite découvert que nous étions faits l’un pour l’autre : je ne suis ni grand ni lourd, et Puce n’aime pas les êtres encombrants. J’aime les gens qui cachent leur jeu, et Puce, sous sa petite taille et son aspect fragile, dissimulait un tempérament à déplacer des montagnes. Alors, nous nous sommes liés bien vite, pour nous préparer à nous enfuir ensemble. Comme cadeau de mariage, j’offris à ma petite androgyne ce que bien des motards n’offrent pas à leur « grosse » : des Koni, le luxe, les seuls amortisseurs dont l’hydraulique est réglable. Puce n’était pas peu fière, d’autant plus qu’elle était la première Puce au monde à être ainsi équipée : les Koni pour mini-Yam, les premiers furent créés pour elle…
Ayant lu une flopée de récits de raids depuis Fenouil jusqu’aux Navigateurs Solitaires de Jean Merrien, je savais qu’un raid se prépare. J’ai donc tourné autour de Puce pour voir quoi diable devait être préparé. Or, plus je tournais autour d’elle, plus je trouvais ma Puce parfaite. Alors, j’ai fait un peu n’importe quoi, pour avoir l’air d’un vrai raider. J’ai démonté toutes les vis, tous les boulons de ma Puce et je les ai remontés avec du Neili Lock, un équivalent japonais du Loctite. J’ai remplacé les vis cruciformes du carter d’allumage par des BTR. J’ai empli les chambres à air d’anti-crevaison. J’ai vérifié que les repères d’avance à l’allumage sur le volant magnétique étaient justes, pour ne pas devoir emporter de comparateur. Ensuite, je n’ai plus su quoi faire, alors je m’en suis tenu là.
Un vrai raider, ça emmène des outils et des pièces détachées. Alors, j’ai acheté une paire de sacoches cavalières et j’y ai mis tout ce qui m’est passé dans les mains : un jeu de clés de 6 à 23 mm, trois clés BTR, deux tournevis, trois clés à molette assorties, un arrache-volant, des démonte-pneus, des rustines, des chambres à air, une clé à griffe, une dizaine de bougies ( standard, froides et ultra-froides), des ampoules de rechange, des fusibles, deux rupteurs d’allumage, un condensateur, une bobine haute tension, une couronne arrière, différents pignons de sortie de boîte, un piston complet, des joints de culasse, des joints d’embase, des filtres à aire, des transmissions de gaz et d’embrayage, un gros bout de chaîne, des attaches rapides, des rondelles-frein, une broche de roue arrière avec son écrou et ses tendeurs de chaîne et huit litres de Motul 300 V.
Tous les ceusses qui étaient allés loin avec des deux-temps se sont plaints de ne pas trouver la bonne huile. Avec la 300 V, j’avais réglé ma pompe à huile pour qu’elle débite grosso-modo 3% à fond, ce qui devait représenter un litre aux 1000 km.
Ensuite, j’ai attaché un pneu de rechange à l’arrière de la selle et me suis frotté les mains. J’avais maintenant une vraie machine de raid. Puce était toute fière, du coup elle m’a demandé de lui rallonger sa démultiplication. On a fait avec ce qu’on a trouvé, le 15/41 d’origine est devenu un 14/31. C’était beaucoup trop long, mais avec un pignon de 13 dents, la chaîne venait caresser le bras oscillant. On est donc parti avec un braquet bon pour rouler sur l’anneau de vitesse de Daytona avec le vent dans le dos.
Quand j’eus mis tout ça dans les sacoches de Puce, je m’aperçus qu’il ne me restait plus de place pour mes propres affaires. D’abord, quelles affaires ? J’eus beau fouiller dans mes armoires, je ne trouvais pas la tenue appropriée à un raid au Moyen Orient ; Le Barbour ? Trop chaud. Le blouson de cuir ? Trop chaud aussi. Alors, je suis allé chez mon tailleur préféré : « Au Paradis du Minou-Chat ». Les patrons sont vraiment a-do-rables, ils ont retourné toute la boutique pour me trouver une tenue qui fasse raider. Depuis la saharienne en tergal jaune Bahamas discrètement surpiquée de soie rose, assortie d’un pantalon cintré délicatement relevé par un galon de satinette ajourée, jusqu’au pardessus en agneau voilé mais d’aspect très martial, accompagné d’un pantalon à poches plaquées et cloutées, je n’ai rien trouvé de vraiment seyant.
Alors, je me suis rabattu sur une toute bête veste de jean, avec pantalon du même métal, des demi-bottes en chevreau tout à fait croquignolettes et un blouson en nylon léger pour couper le vent du désert. Je calai mes boîtes de pièces détachées avec des T shirts publicitaires qui me tiendraient lieu de chemises, une brosse à dents, un rasoir, un bout de savon et je fus prêt.
Ainsi, le 4 août 1975 après-midi, Puce et moi partîmes vers des horizons inconnus.
En passant devant une vitrine, je nous regarde pour voir si j’ai l’aspect d’un raider. Horreur ! C’est d’un coursier que j’ai l’air avec mes sacoches en toile à bâche, mon petit casque léger et ma tenue pas motarde pour un flesh. N’importe ! Puisque coursier il y a, je serai le coursier du désert.
LE VOYAGE DANS LA NUIT
Il est 17 heures lorsqu’enfin, Puce et moi, nos engageons sur le boulevard périphérique pour commettre la fameuse erreur qui nous emmènera dans des pays où les chameaux ont des dents.. Nous l’accomplissons religieusement, ce tour de périphérique qui sera peut-être – qui sait – le dernier.
Arrivés du côté de la porte d’Orléans, nous prenons l’air de rien la sortie « autoroute A6 » et aussitôt, je m’écrie : « enfer et damnation ! Je me trompai ! ». Ainsi, au cas où ça finirait mal, Dieu nous sera témoin que l’on n’a pas fait exprès. Cela commence d’ailleurs mal puisqu’à peine engagé sur l’autoroute, je me souviens que j’ai oublié quelques menues choses : une chaîne de rechange, le manuel d’atelier de Puce, du fil de fer, mon carnet d’adresses et le plein d’essence. Je calcule vite dans ma petite tête combien de kilomètres on a fait depuis le dernier plein, avec un réservoir de 4,8 litres, il ne faudrait pas …
A quelle distance se trouve la première pompe sur l’autoroute ? Je me vois déjà en train de pousser quand apparaît la première station-service.
Du coup, je me décide d’acheter une nourrice à essence, au cas où …
Dans la boutique attenante à la station-service, on vend de superbes bidons de cinq litres Design Guy Boucher, de section triangulaire. Fichtre, ça pourrait en même temps faire un appuie-dos, ce machin là ! Pointant un index décidé sur l’un de ces objets : » Je voudrais une nourrice comme ça, mais couleur puce, s’il vous plait.
- Cela ne se fait pas en rouge.
- Mais ma Puce à moi, elle est bleue ! » réponds-je, comme s’il s’agissait là d’une évidence.
Faute de bleu, je repars avec un bidon jaune, laissant la vendeuse quelque peu étonnée. Pensez, elle n’avait jamais vu de Puce bleue…
Le braquet « Daytona » s’avère parfait sur autoroute, en aspiration derrière les camions, on marche à 90 de croisière. Sympas, d’ailleurs, les routiers. Le plus souvent, voyant Puce derrière eux, ils font attention, font des appels de stops avant de ralentir, et lorsqu’on se sépare, on fait un signe de la main, à la prochaine, merci…
Il va bientôt faire nuit lorsque j’aperçois une 125 Kawasaki trail arrêtée au bord de la route. Je pense déjà : Zut, si je m’arrête, ça va casser la moyenne, si c’est grave, on va y passer la nuit, acré vingt dieux …mais j’ai déjà commencé à ralentir. Le gars n’était qu’en panne d’essence, c’est déjà arrangé, merci, salut, bonne route, et c’est reparti.
La Kawa me double cinq minutes plus tard, signe de la main, et on roule, on roule … Une heure plus tard, lorsque je m’arrête pour faite le plein, le gars est là, on se sirote un café, on discute. Il va à Lyon. Et toi, où vas-tu ? J’hésite un peu car en fait, je n’en sais trop rien ; J’avais pensé à Bagdad, à cause du khalife Haroun-el-Poussah, mais je n’ai pas trouvé de visa irakien. Ensuite, j’ai pensé suivre le rallye Shah Abbas vers Ispahan ; lorsqu’il est parti, le 1er août, je n’avais encore aucun des visas qu’il fallait pour passer les frontières. Bah ! Si je vais assez vite, je tâcherai de le rattraper à Ispahan, sinon, bah, on verra…
Mon compagnon me laisse son adresse à Lyon. « Si tu es fatigué, tu peux passer à n’importe quelle heure, il y aura à manger et un lit pour toi ». Je remercie, c’est beau l’amitié entre motards… On repart.
A une cent-cinquantaine de bornes de Lyon, je me mets en « sucette » derrière un camion superbe, un semi tout tôlé, de ceux qui ne risquent pas de vous lâcher leur chargement sur le nez, une merveille. En plus, il ne fume pas trop. Tiens, il transporte des bacs à fleurs « Riviera »… C’est inscrit en gros avec motif floral, sur les portes arrière du bahut. Il fait nuit, l’arrière du camion avec Riviera et les fleurs peintes constituera mon seul paysage jusqu’au péage de Lyon.
Le chauffeur me fait signe « au revoir », il doit être minuit mais j’ai la flemme déjà de regarder ma montre. Après avoir un instant pensé arrêt et lit chaud, je prends la direction « Chambéry », encore par l’autoroute, car je veux être vite, vite le plus loin possible de Paris et je n’ai pas envie de Rouler de nuit sur une route dangereuse.
Peut-être l’autoroute la plus chère du monde. A la sortie de Chambéry, 90 km plus loin, on me demande 22 balles. Je me soulève péniblement de la selle et montre Puce. Oh ! C’est ni une Rolls ni un semi-remorque … 22 balles, c’est le tarif minimum, ah ! bon… je repars, direction Albertville. J’y suis à quatre heures du matin, j’ai faim, j’ai froid, ma tenue spéciale désert est un peu légère pour rouler de nuit dans les Alpes. Quoi ? des vêtements chauds ? V’rendez pas compte de la place que ça prend… Bof, dans quelques z’heures je serai en Italie, f’ra plus chaud. J’ai sommeil, j’ai froid, fait ch…
Qu’est ce qui me prend de rouler comme un forçat alors qu’au fond je suis en vacances ? Oui, peut-être rattrapé le rallye Shah Abbas … Il y a aussi que je suis déjà allé plusieurs fois en Italie et en Grèce, même si c’était par le train, et que je suis pressé de voir du nouveau, aussi que si j’ai fait beaucoup de moto, je ne suis jamais allé plus loin que Toulon, et que du coup je ne suis pas sûr que ma moto ne va pas se transformer en cougourde passé la frontière italienne, des incertitudes, quoi. Cela m’oblige à rouler plus vite que mes doutes, de peur qu’ils ne me rattrapent.
Le patron de la station Esso, à l’entrée de d’Albertville, me propose de me reposer un peu dans son hall d’expo de voitures. « A six heures, il y a un bistrot qui ouvre, vous déjeunez et vous repartez… »
Cela ma plaît. Je m’installe dans un fauteuil, mais j’ai eu trop froid pour pouvoir dormir maintenant. A six heures moins le quart, le gars vient me voir ; « J’ai vu passer la patronne du bistrot, elle ouvre tout de suite ».
J’y vais, je déjeune et je repars. Il commence à faire jour. Les Alpes … C’est beau, les Alpes, mais c’est mal chauffé et ça monte, ça monte… Megève, altitude idéale, mille et j’sais plus combien de mètres, claironne un panneau. Idéale pour qui ? Plus on monte, et plus Puce perd de chevaux. Enfin, bientôt le tunnel du mont Blanc, l’Italie, tiens, au poil, une descente …
Ah ! Les descentes de montagne, quel pied ! Je bombe comme un mort. L’empattement ultra-court de Puce nous permet de négocier les épingles à toute vibrelure, on peut entrer à fond partout et freiner dans les virages, c’est super… Un tunnel, deux tunnels, fait pas clair là d’dans, et puis c’est humide, tiens qu’est ce qu’y fait c’con-là, ma parole, il s’est arrêté, ça va pas la tête ? Debout sur les freins… C’est con, j’aurais pas dû entrer à fond dans le tunnel, la route est toute noire, mon phare n’éclaire rien, j’les ai vus trop tard, paraît qu’il faut fermer un œil avant les tunnels pour voir clair après, faut être con pour s’arrêter comme ça dans un tunnel, ça freine pas des masses, à tous les coups je tape, j’verrai même pas l’Italie bonsanxècon…
Je freine, je freine, mais c’est plus pour limiter le gravité du choc que pour l’éviter. Je ne vois rien que cette vacherie de bagnole arrêtée devant moi. Et puis si, au dernier moment, je me dis que c’est bon, je bloque la roue arrière, mets Puce en travers, et on s’arrête ; ma cuisse touche la tôle froide de la caisse. J’en suis tout essoufflé. Ce n’est rien pourtant, juste un brave homme qui est tombé en panne dans le tunnel, s’est arrêté et a ouvert sa porte, bloquant la circulation dans les deux sens…
On continue donc, Puce et moi, un peu secoué, et l’on arrive au tunnel du Mont Blanc. Pas possible, ce tunnel. Il est incroyablement long, si bien qu’au bout d’un moment, privé de points de repère, on ne sait plus où il va, d’où il vient, s’il monte ou s’il descend. Histoire de rigoler, j’ai essayé de faire croire à Puce qu’il allait au centre de la terre. Du coup, on a vraiment eu l’impression qu’il descendait, qu’il descendait… Nous avons tout de même été rassurés quand, à l’autre bout, on a vu le jour. Ce ne pouvait tout de même pas être les antipodes… En fait, c’étaient déjà les antipodes : c’était l’Italie. Aussi, tout en descendant vers Aoste, je fis un exposé sur la géographie italienne. Puce, en effet, ne connaissait avant notre départ que Hammamatsu et Paris…
L’Italie est un pays en forme de botte, qui est le plus souvent baigné par trois mers : à gauche, la Tyrrhénienne, qui, selon certains, ne serait que le pseudonyme de la méditerranée, à droite l’Adriatique, et au dessus, la lumière.
L’Italie possède deux ressources naturelles : le soleil, qui absorbe l’énergie et incite au farniente, importante activité du pays, et la décontraction naturelle de ses indigènes, qu'en langage scientifique on appelle les Italiens et, en pratique, de façon beaucoup plus irrévérencieuse.
L'Italie possède trois industries principales:
A/ Les affiches
Les affiches sont en Italie, un sous-produit de l'incertitude politique, qui constitue le pilier de la civilisation latine. L'importance d'un parti politique est, en Italie, directement proportionnelle à sa production d'affiches, sauf, bien sûr, quand ledit parti est au pouvoir. Il est alors interdit d'affichage, et ce sont les partis d'opposition qui y ont droit, chacun à son tour: l'extrême-gauche affiche d'abord, puis l'extrême-droite colle ses affiches par dessus celles de l'extrême-gauche, puis la gauche par dessus celles de l'extrême-droite, puis la droite par dessus celles de la gauche, etc. Cette loi simple d'alternance bipolaire permet à l'industrie italienne des affiches d'être rentabilisée à fond.
B/ Les graffiti
Les graffiti sont, bien plus que la télévision, le vecteur de la pensée populaire italienne. Cela s'explique très bien par le fait que chaque Italien dispose en moyenne de 120 m2 de murs privés ou publics, qui représentent une surface utile sans comparaison avec le tiers de m2 d'un écran de télévision. Ainsi, depuis "Romeo e Giulietta, per la vita" jusqu'à "Cani rossi, morte a voi" (mort à ces chiens de rouges), l'essentiel de la pensée italienne se transmet par graffiti interposés.
C/ Les véhicules automobiles
Ces industries sont très saisonnières, car elles ne fonctionnent qu'en dehors des périodes de grève.
1/ les voitures automobiles: il est assez étonnant de trouver des automobiles italiennes hors de leur pays d'origine: elles sont en effet uniquement conçues en fonction des besoins nationaux. Une auto italienne possède quatre vitesses: la première sert à faire cirer les pneus, la seconde à faire du bruit, la troisième à doubler en sommet de côte et la quatrième à emmener les enfants en vacances. Une cinquième vitesse peut être utile à ceux qui voyagent avec chien ou chat: elle permet audit animal de passer aisément de l'avant droit à l'avant gauche de l'auto, pour par exemple aller se lover sous les pédales, sans être gêné par le levier de vitesses.
Les pneus qui se trouvent en temps normal aux quatre coins de la voiture, servent d'avertisseur de virage: quand ils hurlent, c'est que la route n'est pas droite. La fenêtre est un élément important: elle sert à faire pendre le bras gauche en conduite normale. Autre élément essentiel, le rétroviseur: attention! Quiconque regardera dedans sera transformé en pierre. Il est là pour servir de point d'attache à l'indispensable poivron porte-bonheur, ceci compense cela...
2/ Les motos: l'industrie motocycliste italienne repose sur la loi de la division des forces: il s'agit de fabriquer le plus grand nombre possible de modèles, dans le plus petit nombre d'exemplaires. cette règle est destinée à favoriser l'industrie de scatalogues, qui est une branche de celle des affiches. La moto italienne, plus qu'à rouler, est destinée à faire du bruit, car l'Italien moyen a une sainte terreur du silence. cela dit, des personnes dignes de foi affirment en avoir vu rouler.
Dernier point, le casque est rigoureusement interdit en Italie. Bien sûr, on trouve quelques contestataires pour s'affubler de cet invraisemblable accessoire, mais on a tôt fait de les mettre à l'écart: ce sont des couards et des antinationalistes.
Nous voilà déjà à Milan. On n'a rien vu, rien. Cela fait une nuit blanche passée, et, nous roulons par habitude, polarisés, indifférents à tout, avec pour tout horizon un bout de macadam à bouffer. Je veux arriver vite, vite, à Brindisi, pour prendre le bac pour la Grèce.
Après, il y aura une mer entre la France et nous, on pourra respirer, perdre cette impression que la réalité est en train de nous courir aux fesses... Au passage, nous avons dû acheter une carte grandeur nature de l'Italie. En effet, seules les autoroutes sont panneautées grande ville par grande ville.
Si, par exemple, vous voulez aller de Milan à Ancone par l'autoroute, vous n'avez qu'à suivre la direction d'Ancone, c'est élémentaire. Si, par contre, vous voulez faire le même parcours, ô vicieux, par les routes ordinaires, il vous faut connaître le nom de toutes les petites villes intermédiaires. Elles sont seules indiquées. Or, les autoroutes nous sont fermées, à Puce et à moi: à l'entrée de chacune d'entre elles, un immense panneau indique les restrictions d'usage. Entre autres, les deux roues de moins de 150 cc sont interdits. Allez faire croire que Puce, qui est tout juste grosse comme un Saint Bernard moyen, fait plus de 150 cc!
Après déjeuner, nous partons de Milan. Il est en gros 15 heures, cela fait vingt heures que nous avons quitté Paris. J'ai un peu la flemme et beaucoup mal aux fesses. Quant à Puce, elle a toujours bon moral. Tout de même, pour que je ne l'oublie pas, elle noie sa bougie ultra-froide en sortant de la ville. Puis, le cycle recommence: quinze bornes tranquilles, un village limité à 50 km/h, vingt bornes tranquilles, une traversée de ville, vite chercher le nom de la ville suivante sur la carte, et l'on recommence. Nous arrivons ainsi à Bologne. On imaginait une cité industrielle froide et laide, Bologne nous a au contraire paru coquette, d'autant qu'on a eu le temps de l'admirer, en cherchant, comme d'habitude, la petite ville suivante. Après avoir arpenté Bologne pendant trois quarts d'heure sans trouver notre chemin, nous décidons de passer hors-la-loi. Bravant le panneau "interdit aux motos de moins de 150 cc", nous prenons l'accès vers l'autoroute pour nous présenter, fiers et dignes, au péage d'entrée.
C’est une cabine de verre fumé, à l’intérieur, deux képis nous lorgnent. Silence… J’essaie de me faire tout petit, pour donner à Puce l’air d’une grosse moto. Je tends une main innocente pour prendre ma carte d’entrée sur l’autoroute. Le regard du premier képi de fait froid, et arrive la question tant redoutée : Che cilindrata, questa moto ? Elle fait quelle cylindrée, cette moto ?
On s’est arrêté un peu en avant du guichet, pour mettre en valeur la plaque « F » qui peut constituer une bonne excuse. A nouveau, l’un des péagistes désigne Puce d’un doigt sévère et dit, en martelant le mot « Ci-lin-dra-ta ? ». je le contemple de mon air le plus imbécile et lui dis en français : « Pardon, c’est à propos de quoi-t-est-ce, s’il vous plait ? »
« Ci-lin-dra-ta !!! »
Impitoyable, je continue à le regarder avec mon air abruti n°16. Le second péagiste pousse du coude son collègue et lui dit : « Cela ne fait rien ! C’est une moto et basta… ».
L’autre marque un temps puis d’un air méprisant, me tend ma carte d’entrée. Je m’en saisis calmement, passe en première, et nous voilà, dans des conditions illicites, sur l’autoroute, Puce et moi. On rigole bien.
« T’as vu Puce comme on l’a mis en boîte ? »
« Et si l’on tombe sur les flics ? »
C’est Puce qui parle. Eh oui, elle parle, quand elle est sûre que personne d’autre que moi ne peut entendre. Sinon, elle ne parle qu’aux autres motos – et encore pas n’importe lesquelles – et parfois aux enfants.
« T’en fais pas, Puce ! Maintenant qu’on a la carte d’accès, on s’en fout. On chique de nouveau à celui qui ne comprend rien, à la limite on nous obligera à quitter l’autoroute. De toutes façons, il fait nuit, il fait froid, y’a pas grand risque ».
C’est reparti pour 250 bornes d’autoroute. Cela n’a l’air de rien, comme ça, 250 bornes, mais il ne faut pas oublier que Puce et moi, on marche à 60-70 de moyenne. Cela fait quatre bonnes heures à passer, avec la nuit, le froid, et de fichus travaux mal signalés. Il ne doit pas y avoir grand monde qui roule de nuit en Italie, les chaussées rétrécies sont souvent signalées par de simples cônes, pas de feux clignotants, rien… Une fois comme ça, du temps déjà lointain où je roulais 50 cc, j’ai pris un terre-plein central à fond, oh là là, quelle gaufre ! Rien que d’y penser, j’ai encore plus froid.
Hé Puce, si tu vois arriver un sac de nœuds, préviens-moi. Puce ne répons pas. Elle en a marre, elle aussi, elle se renfrogne. Du coup, je me retrouve tout seul dans la nuit, avec pour seul horizon un compteur rivé sur 80 km/h et une route sombre que j’entrevois à peine. Je commence à en avoir sérieusement marre. C’est décidé, on s’arrêtera à Ancone pour y passer la nuit. Enfin, ce qu’il en restera car il doit être tard. Je me contorsionne pour regarder ma montre, mais avec cette foutue nuit noire, je n’y vois rien. On a déjà fait soixante-dix bornes depuis l’entrée de l’autoroute.
A la prochaine station, parole, on s’arrête. La station suivante, il nous faudra trois quarts d’heure pour y arriver. Je fais faire le plein de Puce, puis direction le bar. Les bars italiens ne sont pas conçus comme dans les pays civilisés : en France, on boit et l’on paye après. En Angleterre, on paie à la réception de sa glougloute. Dans beaucoup de bars italiens, on annonce à la caisse ce que l’on veut boire, on paie et l’on donne le ticket de caisse au bar. Si l’on veut remettre ça, il faut retourner à la caisse, repayer, reprendre un ticket, etc. Heureusement que le café italien est sublime. Fort, savoureux, incomparable. Je m’en tape trois de suite, ça fait trois passages à la caisse. Tout à ma béatitude de goûteur de café, je regarde dehors.
OH, MERDE ! IL PLEUT …
Mon moral, un instant remonté par le café chaud, redégringole en piqué. Je vais chercher Puce pour la mettre à l’abri sous un grand escalier. En levant les yeux, je vois que cet escalier mène à un « motel Agip ». Si l’on restait là ? L’idée ne nous plait pas plus que ça : on avait dit « halte à Ancone » et pas « halte à cent bornes d’Ancone ».
En plus, de jour, on risque de se faire arrêter par les flics. Il faut continuer mais je n’ai pas l’ombre d’un vêtement imperméable. Emporte-t-on une tenue de pluie pour se rendre dans ces pays bénis d’Allah où il ne pleut en été que chaque fois que le prophète perd un bras ?
Je retourne boire d’autres cafés, puis la pluie se calme. On repart. Depuis Milan, j’ai mal aux meules comme ce ne doit guère être permis. Toutes les vingt bornes, il faut changer de position : assis en avant et en appui sur la cuisse gauche, puis en avant sur la cuisse droite, en arrière sur la fesse gauche, etc. En plus, il y a mon slip : c’est le modèle « super-frisson » de chez Rôminet, de ces trucs super-sexies, taillés au plus juste, si riquiquis qu’on n’y trouverait pas la place pour se moucher. Côté séduction, érotisme, c’est 15 sur 15. Par contre, les élastiques de cuisse qui font que le mien est si provocamment ajusté sont en train de me scier les jambons de façon intolérable. Toutes les étapes suivantes, je les ferai sans slip, d’abord ça fait des économies de blanchisserie, ensuite j’aurai moins mal au cul…
Lorsqu’arrive la sortie vers Ancone, je suis en loques. Puce ne me parle plus. Je suis tout seul, tout seul. De la sortie de l’autoroute jusqu’au bled, horreur, il devait y avoir une quarantaine de bornes. Enfin, nous entrons à Ancone, longeons le port, à la recherche d’un hôtel digne de nous, un hôtel de première classe normes italiennes.
On ne doit pas être beau à voir, à force de suivre les camions qui nous crachent à la face leurs renvois de suie. Si vous vous pointez cradaud, à une heure du matin, dans un hôtel minable de la Chaîne Régionale des Marchands d’Aspirateurs, on vous jette. Si vous arrivez dans le même état à la porte d’un ****NN, Dinner’s Club, American Express cards welcome etc,on trouve ça très original, et vous accueille à bras ouverts. Nous repérons sans mal le « Jolly-Hôtel » qui domine la ville et l’écrase de son enseigne lumineuse. O joie des hôtels … Respectables. Nous sommes aussitôt pris en charge.
On met Puce à l’abri, on me donne les horaires des ferry-boats de Brindisi à la Grèce, je n’ai plus qu’à me laisser guider jusqu’à ma chambre. Aussitôt introduit dans mes appartements, je me regarde dans la glace. Ciel ! Je suis plus noir qu’Idi Amin Dada, ma veste Levi’s bleue est totalement noire jusqu’au niveau de mon nombril.
Ah ! Un bain chaud lorsqu’on est crevé, vanné, tout cassé, quel pied ! Sorti du bain, un problème se pose à mon esprit épuisé : et mon cul ? Rassemblant toute ma force d’âme, je présente mes fesses à un miroir, contemplant le paysage en passant la tête entre les genoux. Le spectacle est cent fois plus dramatique que le « Guernica » de Picasso. C’est rouge carminé avec des raies bleues, comme un steak tartare pas frais. Horrifié, je me jette au lit.
C’est le double café matinal servi au lit, avec œufs au plat, qui me sort d’un sommeil en béton armé. Je fonce à l’agence de voyages la plus proche, pour demander un aller en bateau Brindisi-Patrai (Grèce). L’employé de l’agence de voyages me regarde d’un air apitoyé : « Je suis désolé, mais pour Brindisi-Patrai, il faut attendre jusqu’au 12 août. Si vous voulez partir d’ici, d’Ancone, il vous faut attendre jusqu’au samedi …».
Nous sommes mercredi matin. On avait bombé jusqu’ici en pensant rejoindre les BMW du rallye Shah Abbas à Ispahan, il n’en est plus le moins du monde question. Je sors de l’agence de voyages pour annoncer la nouvelle à Puce.
« Écoute, Puce, y’a un truc : notre gag d’Ispahan, c’est foiré. C’est ma faute, on aurait dû passer par les pays de l’Est pour ne pas avoir à prendre un bateau en août sans réservation. C’est moins drôle que la côte adriatique italienne, c’est peut-être moins beau, mais …Excuse-moi, c’est ma faute. On va aller quelque part en Orient tout de même, on improvisera ».
Puce ne répond rien, mais son silence est un pardon. Nous retournons, tout penauds, à l’hôtel, j’ai en poche une réservation de bateau Ancone-Patrai pour samedi dix heures du soir. Je n’ose rien dire à Puce. Je la mets soigneusement à l’abri, et retourne me coucher. Le lendemain matin, très tôt, je réveille Puce pour lui remettre sur les épaules les sacoches cavalières, le pneu de rechange, tout le fourniment. Elle paraît surprise. Elle pensait peut-être que nous allions rester là en attendant le bateau de samedi. Cela aurait pu être le cas et, je crois, Puce en eût été déçue.
Malgré cela, elle joue la surprise, et me demande, parodiant un disciple du Christ dans un roman pseudo-antique dont j’ai malencontreusement oublié le titre :
« Quo imus, domine ? ».
- D’abord, je ne suis pas ton maître, répondis-je tendrement, puis prenant des élans plus antiques : « A Rome, pour nous faire crucifier une fois de plus ou béatifier une fois pour toutes ! ».
Nous partîmes pour une journée de route, laquelle devait nous mener à la plus déconcertante des villes que je connaissance à ce jour : Rome, où, malheur de ma vie, j’ai bien cru rester pour toujours, entre les ténèbres humides et propices à l’amour à la sauvette de Casa di Nerone et la lumière blanche comme mort de la Piazza Venezia. Rome qui, sans blague, avait des serres assez longues pour nous garder tous deux à jamais. Puce et moi …
D’Ancone à Rome, il y a sur la carte, moins de 300 kilomètres. Nous avons trouvé le moyen d’en faire 330. De là à dire que nous nous sommes un peu égarés… La route passe par une bathe chaîne de montagnes, que j’appellerai les Abruzzes parce que je trouve ça joli, et que j’ai toujours dormi pendant les cours de géographie . Maths, histoire et géo m’assomment plus que le phénobarbital.
La petite journée de route Ancone-Rome a été idyllique. C’est merveilleux, la montagne lorsqu’il n’y fait pas froid. De plus, les grimpettes des Abruzzes ( ?) ne sont pas trop abruptes, et nous savons qu’après chacune d’elles, il y aura une descente de luxe qui nous permettra de prendre un petit pied des familles. De temps en temps, au bord de la route, un village accroché à flanc de montagne nous regarde tranquillement passer.
En passant devant Spolète, je raconte à Puce l’histoire du fou qui repeint son plafond.
« Tu te rends compte, Puce, si tout à coup Spolète oubliait de s’accrocher à la montagne, et dégringolait comme un jeu de cubes ? Il faudrait construire une nouvelle route, qui serpenterait entre les maisons tombées, ça ferait un drôle de circuit : épingle de chez Mario Boni, virage du bistrot, esse de l’épicerie, double-droit de la gendarmerie, tout ça pêle-mêle… Houps ! »
J’ai dit « houps » parce qu’on a failli louper un virage, que j’appellerai le virage du Trou, parce qu’il borde un chouette précipice.
Puce me rappelle à la raison, et l’on arrive sans encombres à Rome, en début d’après-midi. Rome… On l’appelle la Ville Éternelle, ben, c’est idiot. Toutes les villes sont éternelles, sauf tremblement de terre, et encore, dans ce cas-là, on s’arrange généralement pour les reconstruire au même endroit, avec le même, alors quoi ? Qu’est ce qui différencie Rome des villes pas éternelles ? Peut-être… Peut-être ses monuments ? Il faut bien dire que lorsque l’on se déplace à Rome, c’est un permanent slalom entre monuments.
Impossible de faire cent mètres en ligne droite sans en heurter un. Des hauts, des bas, des beaux, des moches, des classiques, des baroques, et tout le monde circule à toute vitesse autour. Puce voulait voir le Colisée. Je ne pouvais pas le lui refuser. On a eu quelque mal à y parvenir à cause des voitures qui, en permanence, le contournent en faisant crisser leurs pneus, tout comme si c’était un truc pas éternel. On croirait que les jeux du cirque se poursuivent non plus dans le Colisée, mais autour de lui, avec des Fiat et des Alfa à la place des chars. On a fini par réussir à se faufiler au milieu de la course de chars pour parvenir dans le Colisée.
Sous le soleil du mois d’août, il ressemblait à une grouillante fourmilière éventrée, pleine de petits êtres multicolores qui … Ben …fourmillent à gauche à droite, s’arrêtent en faisant vibrer leurs antennes, entrent, sortent, hésitent, dévorent ici ou là une becquée de cartes postales ou de diapositives. Puce et moi avons été un peu effrayés, n’ayant encore jamais visité une fourmilière. Il valait mieux aller plus loin.
Une avenue plus loin, nous voilà Piazza Venezia, dominée par ce que les Romains appellent le Monumento Olivetti, dédié au dernier roi d’Italie. Il porte bien son nom, ressemblant à une gigantesque machine à écrire des années trente. Un immense escalier donnant sur une rangée de colonnes et après … Rien ! Rien de rien !!!
Incroyable… Décadent. Splendidement inutile. Ave Puce, on s’est dit qu’un peuple capable de construire des incongruités de ce calibre devait être passionnant. Il fallait trouver des Romains, les mesurer, les analyser, les soumettre au test de la liqueur de Fehling, en bref chercher à savoir. Mais, au fait, où sont les Romains ? Nous n’avions en effet, jusque-là, rencontré qui que ce soit qui ressemblât, de près ou de loin, à un Romain.
« Il faut chercher des Romains, dis-je à Puce, viens, quittons cet endroit et explorons ce mystère ».
Nous roulâmes, roulâmes, sans voir autre chose que des gens qui étaient trop accoutrés, trop rougis par le soleil, qui avaient l’air trop conquérant pour n’être pas des touristes. Nous découvrîmes tout de même le plus grand danger que Rome réserve aux Puces : les rails de tramway. En effet, à Rome, il y a des tramways, et ces animaux redoutables qui, à chaque poteau, crachent au ciel, une gerbe d’étincelles, apportent avec eux le plus épouvantable des fléaux : les rails.
Ces horribles serpents au dos luisant ont pour nourriture favorite les Puces ; Si une Puce à le malheur de passer sur le dos de ces monstres, ils lui enserrent les pneus, la jettent à terre et en font leur pâture. Pour échapper à l’emprise de ces affreux reptiles, il faut les attaquer de biais, comme tous les serpents, qui n’ont pas ou peu de vision latérale. Ce serait facile s’il n’y avait les automobiles, les horribles complices des serpents pucivores. Elles se mettent à deux, une de chaque côté. Lorsque la malheureuse Puce est prise en tenaille par les deux automobiles, l’une d’elles se rapproche de la victime. La pauvre Puce est alors perdue. Si elle ne bouge pas, elle est dévorée par l’automobile de droite. Si elle oblique sèchement pour échapper à celle-ci, tout en se préservant du serpent tapi sur le sol par une approche suffisamment biaisée, elle est dévorée par l’automobile de gauche. Dans tous les autres cas, elle est presque à coup sûr engloutie par le serpent. Puce, ma Puce à moi, était effrayée. Moi-même faisais de mon mieux pour la protéger des monstres. Toutes les techniques acquises en dix ans de combats sur les arènes parisiennes me servirent : feinte au corps, freinage-surprise, accélération éclair suivie d’un déboîtement au ras du pare-chocs, coups de pied en vache, tout me fut utile.
Soudain, apercevant une ruelle sombre, nous nous y jetâmes pour échapper aux serpents. C’est ainsi que, par hasard, nous découvrîmes à la fois les Romains et une vérité première.
Tout à notre joie d’être dans une ville au ciel clair, nous avions, Puce et moi, toujours roulé au soleil. Or, dans les pays chauds, seuls les touristes donnent leur pâleur en pâture à Phoebus. Pour les autres, le soleil n’est là que pour faire apprécier les recoins qu’il néglige. Ceux qui le connaissent mal le recherchent. Ceux qui l’on toujours connu ne cherchent qu’à se cacher de lui. Les Romains étaient donc là, dissimulés dans l’ombre.
C’est aussi dans l’ombre que nos trouverons plus tard les Grecs, les Turcs et les Arabes… Nous découvrîmes donc les Romains autour d’une place ombragée et loin de tout monument, au moins autant qu’il est possible à Rome : Sainte Marie majeure n’était guère qu’à 500 mètres. C’est Place Victor-Emmanuel II que nous entrâmes vraiment dans Rome, et que Rome se referma sur nous. Nous n’en sommes jamais vraiment sortis.
Où que vous alliez dans le Sud, les enfants sont toujours les premiers ambassadeurs. Dès que nous fûmes arrêtés, ils s’approchèrent de nous et commencèrent à palper Puce sans vergogne. Tout, depuis le cabochon de feu arrière jusqu’au pneu avant fut inspecté, palpé, commenté. On se serait cru à un contrôle médical. Puce était toute fière d’être le centre d’intérêt de cette volée de chérubins qui n’avaient sûrement jamais vu une si jolie moto construite à leur taille. En effet, les mini-motos que nous avions rencontrées dans Rome étaient des rustaudes, bruyantes, mal finies, mal peintes, bref des filles de rien que Puce ne daignait même pas regarder.
Ensuite, ce fut à moi que les enfants s’intéressèrent : comment t’appelles-tu, d’où viens-tu ? Ils ont ouvert de grands yeux en apprenant que je venais de Paris, l’autre ville éternelle.
« Comment, avec une si petite moto ? »
Tiens, je crois découvrir à l’instant pourquoi Puce a tant aimé l’Italie : on y appelle « moto » tout ce qui a deux roues et un moteur. Partout, on m’a parlé de « la tua moto ». Cela a dû plaire à Puce, car je la soupçonne d’être un peu fière…
Après les enfants, les parents arrivèrent avec les mêmes questions. Ils parlent beaucoup plus fort. Puce avait un peu peur, j’étais aussi désorienté face à ces escogriffes gesticulants, prompts à vous saisir par le coude ou à vous flanquer de grandes claques sur l 'épaule pour appuyer un propos. Au bout d’une vingtaine de minutes de discussion, le plus grand et le plus gros de mes Romains, un colosse musclé, trapu, velu, inexplicablement père du plus chérubinesque de mes petits ambassadeurs, me propose un « gorgettino », un petit verre.
Détail en passant, à Rome, on peut très bien en dehors des heures de repas n’entrer dans un restaurant que pour boire un coup, et l’on paie dans les 5 francs un litre de vin blanc pas crade. Nous nous retrouvons à dix autour de la table, à discuter bruyamment entre deux petits gorgeons. On me fait parler, on s’esclaffe, on me flanque des claques sur l’épaule, puis le colosse de tout à l’heure me demande : « Où dors-tu cette nuit ? »
- Probablement à l’hôtel, juste là sur la place.
-Tu es fou, il est trop cher, ça va te coûter au moins dix mille lires pour la nuit. Viens chez moi ! »
Ainsi, nous nous retrouvâmes, Puce et moi, adoptés par une famille romaine, Pietro et Marisa Polce, et leurs deux fils Mauro et Stefano.
« Ce soir, tu prendras le lit de l’un des garçons. Demain, on ira acheter un lit pliant pour toi.
- Mais, il faut que je parte samedi matin, que je retourne à Ancone prendre le bateau !
- Non ! tu restes à Rome, qu’est ce que tu veux faire chez les Arabes ? Ici, tu as du soleil, tu as Rome à visiter, dimanche, on ira tous se baigner à la mer… ».
J’ai le plus grand mal à faire comprendre que Puce et moi sommes bien décidés à poursuivre notre route jusqu’en Orient et que, bien sûr, c’est idiot, mais parti comme on est, on ne veut pas, on ne peut pas s’arrêter à Rome. Samedi matin maximum, et puis via…
Pietro regarde sa femme d’un air songeur, je le crois rendu à mes raisons. Or, le lendemain midi, en rentrant de promenade, je trouverai un lit pliant dans la salle à manger…
Levé tard le lendemain, je vais rejoindre les enfants dans les jardins de Mécène, qui surplombent le Colisée. Les voilà qui s’installent à trois sur Puce, brandissant la bannière « Forza Roma » des supporters de l’équipe de foot de Rome. Cela me fait bien rire. Soudain, derrière nous, une voix forte d’adulte se met à vociférer : « A bas Rome, vive la Juventus ». Au ton de la voix, je crois avoir affaire à un fanatique agressif, en fait, c’est un quinquagénaire à l’allure placide qui s’approche et dit : « Vous savez, c’était pour plaisanter ».
Montrant Puce du doigt : « Je n’ai jamais vu une moto aussi petite et aussi bien faite ! ».
Une heure plus tard, alors que je me promenais avec mes petits guides dans une autre partie de la colline Oppio qui est, traditionnellement, le repaire des partisans du MSI qui est disons très à droite, l’un de ces « redoutables fascistes » s’en prend à moi, mon gros appareil photo lui ayant fait croire que j’étais un de ces « porcs de la R.A.I » de la télé italienne, qui sont de dangereux gauchistes aux yeux de d’un MSIste.
Mon accent français et mes fautes de grammaire lui ayant fait réaliser son erreur, il me prit par l’épaule et me fit un long et patient discours sur la décadence italienne et les moyens d’y remédier.
Lorsque nous rentrâmes déjeuner, Pietro et Marisa me demandèrent : « Alors, c’est beau, Rome ? Je répondis : « Fantastique ! ». Mais ce n’est pas aux Thermes de Caracalla, ni au Monumento Olivetti que je pensais. Que Rome soit belle, je m’en foutais presque complètement. Seulement, je commençais à sentir que je m’y attachais, et cela me faisait un peu peur…
A Rome, comme dans la plupart de l’Italie, tout va toujours de travers. Le spiccio, les pièces de monnaie, manquent, car les pièces de 50 et 100 lires arrivent à valoir plus au poids de leur métal que la somme marquée dessus. Il n’y a donc pas de monnaie, souvent on la remplace par des jetons de téléphone, des timbres, des cartes postales ou des bonbons. Il y a toujours une grève de ceci ou de cela, ou une panne d’autre chose, malgré cela, « si vive », on vit, on blague, et quand on se plaint, c’est presque toujours en riant à moitié.
Le soir, après dîner, on va entre hommes au restau du coin, non pas pour re-dîner, mais pour jouer des bouteilles de Frascati aux cartes avec des copains du quartier. On rigole, on s’engueule comme dans un film de Pagnol, même si l’on ne peut pas couper à cœur quand on joue à sette e mezzo, c’est le bonheur.
Quand d’aventure j’ai quelque chose à acheter, impératif d’y aller avec l’un des gamins « comme ça, els commerçants savent que tu habites chez nous et tu as 10% de réduction ».
J’ai l’impression que Rome a deux enfants de plus, Puce et moi. Si nous continuons, trouverons nous une autre ville qui nous adopte ainsi ?
Samedi matin, je posai la question à Puce. Fallait-il continuer, retourner à Ancone, prendre le bateau puis faire encore quatre mille bornes de route, ou rester là, avec notre nouvelle famille, et couler des jours tranquillement heureux ?
Que nous importe, au fond, hein Puce ? Ulysse a bien parcouru les sept mers pour s’apercevoir que le bonheur l’attendait dans sa propre maison. Est-ce nécessaire de …
Puce, pour une fois, fut catégorique :
« Ulysse a vu sept mers, tu ne m’en as montré qu’une ; alors, si tu veux, concluons un marché : montre–moi sept mers, et je te révélerai une grande vérité ».
Quand reviendras-tu ?
Mes amis me regardent un peu tristement. J’en ai gros sur la patate aussi. Je réponds : « Bientôt ».
C’est ce que l’on dit lorsqu’on ne sait pas. Combien de gens a-t-on quittés en disant : «A bientôt ? ». On m’a donné un plan de Rome avec notre chemin tout tracé, mais Rome est comme toutes les grandes villes : on s’y perd. Il nous faudra deux heures pour enfin trouver la Via Salaria qui nous ramènera à Ancone. Je bougonne un peu : sept mers, où veux-tu que je te trouve sept mers, ma pauvre Puce ?
Puce ne répond rien. Elle savoure silencieusement sa victoire. Sept mers… A vrai dire, je ne sais pas trop où je vais les trouver, mais il n’y a pas trop de soucis à se faire : des mers, il y en a partout, alors roulons, roulons…
En fin d’après-midi, tranquilles, nous arrivons à Ancone. Je gare Puce sur le port, à côté d’une monstruosité de 900 Kawasaki venue de Suisse. Ma Pucette a vraiment l’air microscopique près de cette grosse chose pleine de cylindres. Croyez-vous qu’elle soit intimidée ? Point du tout !
La voilà qui se met à entreprendre la 900. Vous venez d’où ? Ah ! Du canton de Vaud ? Mohâ, je viens de Paris, ma chère ! Comment trouvez-vous l’Italie ? Follement pittoresque, n’est-ce pas ? Avez-vous vu Rome ? Non ? Quel dommâââge ! Voyez-vous, il n’y a pas cinq minutes, je disais à mon khâvalier…
Je me retire discrètement, laissant Puce snober la grôsse moto comme elle veut. Il reste à régler les formalités d’embarquement. C’est chose vite faite et, pour passer le temps, en attendant l’heure de monter à bord, je m’amuse à lire l’espèce de contrat d’embarquement qui figure sur notre billet. Hébin, c’est pas vraiment rassurant.
En gros, la compagnie maritime est responsable de nous en toutes circonstances, tant qu’il n’arrive rien. Si d’aventure quelque malheur advient, sa responsabilité s’en trouve par le fait même dégagée. Dire qu’il me faut confier ma Puce à moi, qui ne sait pas nager, à des gens qui déclinent toute responsabilité en cas « d’actes de Dieu », article 4, paragraphe B du contrat d’embarquement…
A neuf heures, la file des candidats au départ commence à se mouvoir ; On nous guide vers une espèce de soute qui n’ouvre que sur la coque du bateau. Puce va rester dans ce piège à rats pendant trente-six heures, quelle tristesse… j’arrime mon petit animal à une grosse tuyauterie de je ne sais pas quoi, un sandow pour tenir la roue avant, un pour la roue arrière, un au guidon, un ici, un là. Un matelot à la porte de la soute, commence à m’invectiver parce que je traîne trop. Aspetta un tantitto, per piacere ! Ils ont vraiment l’air pressés, pourtant il reste une demi-heure avant le départ, faut pas pousser. En fait, le bateau partira avec trois heures de retard…
Je passe la moitié de la nuit, couché sur le pont du bateau –c’est moins cher si l’on dort sur le pont- à penser à la Puce, ficelée dans les soutes aux côtés d’une Mercedes teutonesque à qui, je le sais bien, elle ne daignera pas adresser la parole. Trente-six heures sans parler à personne…
Le mal de mer, rien à craindre. L’adriatique, en été , est à peu près aussi agitée qu’un pot de graisse consistante. Les sandows… J’aurais dû en mettre plus, si par impossible on avait gros temps, je ne pourrais même pas vérifier l’amarrage de Puce, les soutes ne communiquent pas avec l’intérieur du bateau… Sale C… de matelot de mes noix qui m’a pas laissé finir alors que le rafiot s’est barré trois plombes à la bourre.
Nénesse, va ! Et puis si l’on coulait, Puce resterait coincée là dedans, noyée comme un rat, ce n’est pas possible… une moto qui a séjourné dans l’eau de mer, comment peut-on la soigner ? Bah, si elle ne reste pas trop longtemps, on démonte tout, on nettoie tout, on change tous les roulements, tous les joints d’étanchéité, tout ce qui est en caoutchouc, si elle reste longtemps, il y a la rouille… Combien met-on de temps à récupérer l’épave d’un bateau coulé ? Et puis d’abord, cherche-t-on à la récupérer ? Je me vois déjà en homme-grenouille, sondant l’épave du « M.S Patra », explorant les soutes. « Puce, me voilà, je viens te sauver ! ». Je me vois la démonter, la soigner, attention à ne pas oublier d’enlever le circlip en bout de barillet de sélection avant de séparer les deux carters-moteur sinon… Crac ! Le carter se fêle, toute ma Puce se désintègre, tombe en morceaux, le moteur, couvert de coquillages, se désagrège sous mes doigts, l’huile glacée coule sur les mains… Un éclair… Puce !
C’est le soleil qui m’a réveillé. Le M.S Patra se promène peinardement sur l’Adriatique. J’ai mal dormi… Il fait beau. Il est … Mhh… Huit heures douze, et le soleil, un soleil tout blanc, froid, chatouille mes bras qui sortent du sac de couchage que j’ai acheté à Rome, ah oui ! Rome… Hier matin encore… Puce !...
Ah ! C’est vrai… Puce est dans la soute-piège à rats, je ne la verrai que demain matin, quand nous arriverons à Patrai. Pas eu de tempête cette nuit, ça m’aurait réveillé. Mollis pas, Puce, dans vingt quatre heures, non… Vingt sept, je viendrai te délivrer… La moitié des passagers est déjà en train de s’agiter…
Le dépliant de l’Helit, Hellenic Italian Line, annonce pompeusement que notre voyage « peut être considéré comme une mini-croisière ». En fait, nous sommes sur un rafiot d’économiquement faibles, un barlu militaire reconverti en somptueux trans-adriatique, comme le trahit une plaque « Arsenal de Brest, 1953 ». Il s’appelait alors le Pierre Loti.
Eh bien ! Cela ne fait rien ! Ayant lu le mot magique croisière sur le dépliant, une petite armée de Gérââârd et de Mârie Chantâl, qui se croit sans doute sur le Mermoz, le Christina, je ne sais quoi de friqué, est en train de fourbir son attirail. Lunettes noires grosses comme des hublots de transatlantiques, shorts et T-shirts Acapulco 1974, crèmes solaires à l’huile de coude, tout y passe !
A côté de ces pupazzi de pacotille, il y a les habitués de la ligne qui ne confondent pas l’Orient Express et un train de banlieue et roupillent. Au dessus de ma tête, un Italien solidement charpenté, à la peau tannée comme du vieux cuir, barbe de trois jours si dure et drue qu’elle pourrait servir de brosse à bougie, émet des ronflements sonores, francs, clairs, modulés. Si Herbert Von Karajan l’entendait, il lui ferait un pont d’or. Pour ma part, je passe ma journée sur le « Manuel du parler arabe au Moyen-Orient » ouvrage de Jean Kassab, publications du Centre Universitaire des Langues Orientales Vivantes, série 6, Tome VIII, y’a pas de quoi, c’est cent balles. J’me suis tapé cinq mois de cours de dialecte à Langues O’ pour apprendre à prononcer Allah correctement. J’aime bien être traité d’égal à égal dans les pays plus pauvres que le mien. Plutôt être pris pour un immigré clandestin que pour un touriste.
Mon âme était déjà au Moyen-Orient. Je vis à peine revenir la nuit…
Dernière édition par cobalt57co le Ven 18 Jan 2013 - 0:17, édité 6 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
C’est une certaine agitation sur le pont qui m’éveille, nous approchons la terre. Le temps d’acheter quelques inutilités hors taxes à bord, nous arrivons, nous sommes arrivés à Patrai. Les bagages de Puce et les miens sur l’épaule, j’attends la passerelle. Bousculant de ci, de là, je me fraie un chemin jusqu’au quai et me rue dans la soute qui enferme encore ma Puce bien-aimée. Elle est là, toujours arrimée. Intacte ! J’ai envie de danser de joie. Fébrilement, je récupère mes sandows, je remets mes sacoches cavalières, mon casque, mes gants…
Au premier coup de kick, Puce donne de la voix. A nous la Grèce, balbutie-t-elle dans un petit nuage de fumée bleue. A la douane, la gabeloutte inscrira sur mon passeport « avec moto Yamaha n° 6676 EG 92 », et officialisera le tout d’un coup de tampon décidé. Pour Puce et moi, ce sera en quelque sorte un deuxième mariage.
Patrai-Athènes, 222 kilomètres, ce n’est rien, un tiers de saut de Puce ! Le saut de Puce sera ma mesure de distance pour ce voyage. On commence à « sentir son fessier » sur Puce au bout d’une dizaine d’heures, soit 600 kilomètres.
Nous prenons ce que les Grecs appellent l’autoroute. De deux choses l’une : ou ce n’est pas une autoroute, ou bien les Grecs n’ont pas la même conception que nous de ce genre de voie de communication. Pour nous, il s’agit au moins de deux routes à deux voies séparées par un terre-plein central.
L’autoroute Patrai-Athènes a tantôt deux voies dans chaque sens avec terre-plein, tantôt deux voies sans terre-plein, tantôt une voie dans chaque sens sans rien du tout. Cela dit, il n’y aucun feu rouge et un péage de temps en temps, ce qui fait dire que c’est une autoroute. Quoi qu’il en soit, pour nous, c’est la joie : il fait beau, nous sommes en Grèce, les bas côtés sont de terre dure et de pierre sèche, mais, de temps en temps, un buisson compact nous envoie un filet de senteurs méditerranéennes… Enfin… Pas méditerranéennes, en fait, puisque c’est la mer ionienne, notre seconde mer, que nous laissons dans notre dos, mais vous connaissez cette odeur des buissons du Sud-Est de la France, qui vous picote le nez à travers la chaleur… Eh bien ! C’était comme ça.
A une soixantaine de bornes de Patrai, nous nous arrêtons pour faite le plein de Puce, et j’en profite pour boire un petit coup. Survient un bon français moyen, avec sa femme et ses deux enfants, le plus jeune dans les bras de Bobonne, a le visage recouvert d’une pâte blanchâtre, remède probable contre les coups de soleil. Pauvre moutard ! Avec cette gangue cadavérique, il a l’air de Frankestein. Le plus âgé des fistons regarde Puce d’un œil curieux et dit à l’auteur de ses jours « Dis, c’est un français ! ». Bonne pomme, je commence à discuter avec le brave homme qui me dit avec une lueur de reproche dans les yeux : « Décidément, on voit des Français partout ! ».
Eh oui ! Parti avec sa smala dans sa Simca 1500, destination la Grèce, le bout du Monde, quoi, Gugusse aurait voulu être le seul citoyen de la Démocratie Gauloise (sans blague, Galliki Dimokratia, c’est le nom officiel de la France en Grèce) dans ce pays lointain.
Puce et moi étions les envahisseurs, les gâcheurs de congés payés héroïques, ceux qui viennent débomber le torse du vaillant pionnier qui, rentré le premier septembre au siège de la Société générale des entreprises Connexes, dira à ses inférieurs hiérarchiques, en roulant moralement des épaules : « Cet été, on a fait la Grèce… ».
Nous voilà repartis, pour une séance de bourre-bus. La bourre-bus est un sport exaltant. En Grèce, il doit y avoir une seule ligne de chemin de fer. Tout le reste est desservi par autobus.
Ce sont souvent de vieilles trapanelles qui néenplus, pètent le feu, bardées d’icônes, de franfreluches, de portraits du président Caramanlis (il y a peu de temps, c’était Papadopoulos) qui emmènent de ville en ville des cargaisons parfois impressionnantes d’humains, de bagages, de cabas, le tout à bonne vitesse. Puce et moi, on a beaucoup aimé la bourre-bus. On voyait venir de loin les bus et, dès qu’ils nous dépassaient, on changeait de file pour se mettre en aspiration derrière.
La traînée aérodynamique d’un bus, même s’il n’est pas grec, correspond à celle d’un troupeau d’éléphants, d’où l’opportunité pour une moto de petite cylindrée, d’augmenter considérablement sa vitesse de pointe, et de dépasser le bus au premier virage un peu difficile. Le bus reprendra l’avantage en ligne droite, où au début des montées où son inertie lui conserve plus longtemps sa vitesse, mais il y a toujours moyen de le repiéger ensuite, on peut ainsi rouler des heures ensemble, un coup à toi, un coup à moi, et tout le monde s’amuse. Cela a duré comme ça jusqu’aux faubourgs d’Athènes.
Athènes… Zut ! Encore une ville éternelle ! Au premier abord, c’est une ville comme une autre, au second… Aussi. Paris en moins prétentieux et plus ensoleillé ; soudain, au détour d’une rue, boum ! The monument. The truc, guicheté, entouré, surveillé, colossal, super-big, le choc. Prenez vos billets…
En août, les touristes sont omniprésents, et tout est prévu, orchestré, pour les accueillir… et les saigner. Normal, d’ailleurs. Celui qui vient d’un pays riche dans un autre qui l’est moins ne doit pas venir pour être radin sinon quoi ? La vraie Grèce doit être visible au printemps ou en hiver.
Puce et moi ne sommes pas là pour ça. Nous comptons nous arrêter ici un jour pour raison sanitaire. Puce pour que je lui fasse une révision générale, et moi pour me faire vacciner contre le choléra, car sans vaccin anticholérique, pas de Moyen-Orient. Le premier hôtel du côté de la gare est le bon…
Le lendemain matin, en prenant le chemin du centre de vaccination, nous faisons connaissance avec la circulation athénienne. Elle est basée sur un organe vital, le vecteur des joies et des peines, de saluts et des injures, j’ai nommé :
LE KLAXON !
Le dieu Klaxon est adoré dans tout l’Orient : il est le saint patron de tout ce qui roule sur terre. En Grèce et en Turquie, en Syrie et en Jordanie et même au-delà sans doute, un véhicule n’est déclaré en panne que lorsque son klaxon ne fonctionne plus.
On klaxonne lorsqu’il y a du monde, pour saluer, pour avertir de sa présence. On klaxonne lorsqu’il n’y personne pour meubler sa solitude. On klaxonne en ligne droite à la manière des chauves-souris, qui jettent un cri pour que sa réverbération signale les obstacles ; on klaxonne en virage pour couvrir le chant lancinant des pneus. On klaxonne comme on rit lorsque l’on est gai, on klaxonne pour ponctuer, comme d’un sanglot, ses chagrins. On klaxonne sa joie, sa tristesse, sa mélancolie, sa peur. On klaxonne comme les enfants chantent, lorsqu’ils marchent seuls la nuit, pour éloigner le croquemitaine et autres mauvais esprits. Je klaxonne pour que l’univers entier sache que j’existe. Je klaxonne pour que l’on sache que la mort court à mes basques et me rattrapera un jour. Je klaxonne parce que je veux vivre. Je klaxonne, donc je suis…
Dans cette rumeur klaxonéenne, il devient difficile de communiquer. Si vous voulez insulter un maladroit, un malveillant, ne klaxonnez pas ! Votre cri dérisoire se perdrait dans la grondeur permanente. Alors quoi ? Les Athéniens-à-moteur ne peuvent-ils point communiquer entre eux ? Mais si, capoundediou ! Lorsque les organes auditifs sont saturés, il reste le langage des signes.
Je me suis documenté. J’ai acheté un livre sur le grec « gestuel ». En effet, j’avais remarqué que, parfois, les Grecs appliquaient une ou deux mains ouvertes sur leur pare-brise. Pas pour désembuer ! Tout simplement parce qu’en grec gestuel, la main ouverte tendue vers quelqu’un signifie « va en enfer ». Les deux mains « va deux fois en enfer ». En situation non-automobiliste, on peut amplifier la malédiction en y ajoutant un ou deux pieds, ce qui correspond à envoyer la victime trois ou quatre fois en enfer.
Ces damnations triplées et quadruplées ne sont hélas que peu employées dans la circulation, car l’expérience l’a prouvé, même un Grec ne peut contrôler efficacement son véhicule avec les deux pieds et les deux mains contre son pare-brise.
Ce langage muet m’a beaucoup frappé. Plus Puce et moi irons vers l’Orient, plus il prendra d’importance. J’apprendrai par la suite que l’on peut être explicite, éloquent, en gardant la bouche fermée, mais ça, c’est une autre histoire…
Voilà, nous quittons déjà Athènes, nous n’y sommes restés qu’une soirée, une nuit et une matinée. Ma piqûre anticholérique, je l’ai à peine sentie. La révision de Puce, une formalité : tension de chaîne, réglage des freins, garde de l’embrayage, avance à l’allumage, graisse un peu partout, de la broutille en somme.
Sitôt après déjeuner, nous sommes partis pour Salonique. Salonique n’est guère qu’à 500 kilomètres, un petit saut de Puce, quoi. La route à péage est bonne, il y a du soleil, beaucoup de soleil, si bien que je décide de motocycletter à la grecque ou presque. En Grèce, on roule à moto sans casque et en chemise, voire torse nu. Je retire donc ma veste, mais garde mon casque tout de même… Une demi-heure après, une soudaine brûlure à l’épaule, juste au dessus de mon vaccin anticholérique. Ouillouillouille !
Vite à moi le bas-côté, je retire mon T-shirt, une guêpe déjà morte en tombe. Vaccin plus piqûre de guêpe, je repars avec une épaule gauche raide comme du béton. Lorsqu’il faut lever le bras pour regarder l’heure à ma montre, ce sont les grandes douleurs.
De rage, lors d’un arrêt essence-pipi, je fourre ma toquante dans mes bagages. Ce faisant, sans le savoir, je m’orientalisais. Histoire de passer le temps, il me vient l’envie de faire la course avec un camion. Un beau gros me dépasse, je déboîte et me colle derrière, mais Puce me fait remarquer : « tu as vu son chargement? ». Il s’agit de gros ballots de laine ou de coton, pas vraiment bien arrimés.
Elle a raison, la Puce. Pas vraiment prudent de se coller derrière ce genre de loustic. Nous le laissons filer seul, pour le retrouver, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Passant sous un pont trop bas, il a accroché ses ballots dont la moitié est épandue sur la route..
« Qu’est-ce que je disais- fais Puce d’un ton professoral- tu me conjugueras je ne jouerai plus avec les camions à tous les futurs jusqu’à la fin des temps !!! ».
De fait, au-delà de la Grèce, je n’ai plus joué avec les camions. Enfin, presque plus, beaucoup moins, quoi…
Il commence à faire nuit. Là se présente un problème non prévu : les moustiques. Un brouillard, un mur de moustiques. On a vraiment l’impression de rouler sous une chute de neige. En l’espace de dix minutes, la bulle de mon casque devient opaque, le phare de Puce n’éclaire plus rien, nous marchons au radar. L’entrée dans Salonique est un vrai rodéo. Faubourgs sombres, des passages à niveau, des nids de poule partout. Entrés dans Salonique elle-même, Puce et moi poussons un gros soupir.
Thessaloniki, c’est un nom de ville qui m’a toujours plu. Y’a pas, ça fait historique, ça fait lointain, c’est comme Bagdad, Tombouctou, Ouagadougou, Phnom Pen, ça sonne !
Pour Puce et moi, c’était déjà la porte des pays lointains. Salonique, tu te rends compte, Puce, nous sommes déjà arrivés à Salonique, c’est-y-pas beau, tout de même?
« Et mes sept mers ? » répond Puce aussi sec.
Je m’offre une bouffe du soir commak, avec la chose que j’aime le plus en Grèce, la salade de poivrons verts, d’oignons, de tomates avec une sorte de fromage de chèvre ou de brebis, j’sais pas trop. Le feta, quoi !
Deux heures ensuite, deux heures pour trouver un hôtel qui ait à la fois de la place pour moi et un garage couvert pour mettre ma Puce à l’abri de la pluie (on ne sait jamais) et des voleurs (il y en a partout).
Faute d’en trouver, je saucissonne Puce à un arbre avec la chaîne antivol que, Dieu merci, j’avais emportée. Une belle, bien grosse, bien musclée, bien rébarbative, avec un cadenas Yale théoriquement à l’épreuve des guerres de religion, secousses sismiques et autres révolutions culturelles.
Ah ! Se réveiller dans une chambre d’hôtel, et mettre une longue seconde à réaliser où l’on est ! Se dire : au moment présent, personne que je connaisse ne sait où je suis. Pas de téléphone qui sonne à baise-heure, « Viens vite, y’a ça et ça à faire, y’a machin qui veut te voir urge urge », pas de note d’ électricité, pas de convocation à la commission de retrait de permis de conduire, pas de, pas de…
Allongé sur mon lit, dans ma chambre d’hôtel de Salonique, je me marre. Je les ai bien eus. Envolé, je suis. « Où est-il, que fait-il ?» (grosse voix) Je glande !
Je ris comme un fou dans mon lit de fer, qui se met à onduler en grinçant au rythme de ma rigolation comme si je peenais comme un book. Si quelqu’un passe dans le couloir, il va penser que l’hôtel abrite un fou dangereux ou un zob-cédé scesçqüel. A cette pensée, je ris encore plus fort.
Oh, je sais, toutes les tristesses et autres emmerdements dont je me délie attendent patiemment mon retour. M’en fous ! Après cet instant, le déluge ! Et je ris encore…
Salonique, c’est déjà la porte de la Turquie. C’est très peuplé, bruyant, les rues sont pleines de commerçants divers, la moitié ayant pignon sur rue et l’autre pognon sur le trottoir.
Je passe ma matinée à déambuler dans les rues. Une envie d’acheter une de ces icônes toutes dorées splendidement baroques à tel endroit. A tel autre, une heure d’arrêt pour regarder les gens vivre et passer.
Soudain, dans la rue, que vois-je ? Une Puce !!! Une petite moto du même modèle que la mienne, mais couleur orangé. Ma première impulsion est de me précipiter dans la rue pour parler au puciste. Puis, je m’arrête. C’est un bonhomme d’une quarantaine d’années, l’air occupé et rébarbatif. Je le laisse partir, interdit, et retourne voir ma Puce à moi, papillon bleu attaché à un arbre.
« Tu sais, j’ai vu une autre Puce
- je l’ai vue aussi…
- Elle avait l’air d’aller au boulot, t’aurais vu le pilote, sérieux et tout, triste, quoi.
- Cela ne m’étonne pas, tu n’a pas vu ? C’était une Puce rouge… »
O Puce décadente !!!
Nous quittons Salonique. Dieu merci, nous n’y sommes pas restés suffisamment pour nous y attacher. C’est ça le drame du voyageur. Dès que l’on reste assez longtemps en un lieu pour y assimiler un tant soit peu le mode de pensée, les coutumes, on s’y attache.
Si l’on veut voyager loin, il ne faut s’arrêter nulle part, nulle part ! Nous partons plein pot, pour fuir cette impression que si nous étions restés, peut-être…
O joie ! Des virages, des virages de Puce, bien serrés, des esses, des doubles-esses, sur une route aux gravillons saillants, qui accrochent nos pneus comme des ventouses.
Allah ! Quel pied, quelle folie, on fait racler les sacoches dans les virages. Cela fait « crooooonch » à gauche, puis à droite, on est heureux, Puce et moi. Puce, c’est la Yamaha 4 qui gagna des championnats du monde. Moi, je suis Phil Read, son chevalier servant. Hailwood est devant nous… Attends, puce, à Craig Ny Baa, on lui fait l’intérieur, et à nous un nouveau titre de champion du monde. Et ric, et rac, Hailwood est derrière nous maintenant.
Nous arrivons à … MEGA PISTON !!!
Un frisson me court le long de l’échine. C’est pas vrai, je n’ai pas vu ça…
Pourtant, sur un panneau indicateur, j’ai bien cru lire MEG PISTON.
Meg. C’est Megalos, en grec cela veut dire gros. Piston… C’est un piston !
Mega Piston, ce doit être la ville, la cité, le pays, le paradis du gros piston, du moteur monocylindre, le Gromono. Arrête-toi, Puce ! Nous avons un pèlerinage à faire… Demi-tour… O prêtres impénitents du Gromono, votre terre promise existe, quelque part entre Salonique et Alexandroupolis, la porte de la Turquie… Genou à terre, je baise la terre sacrée de la cité de Mega piston. C’est la rédemption de tous les monos, dont Puce et moi sommes en ce moment les ambassadeurs avec nos 72 cc et nos 47/42 mm d’alésage/course. N’est-il pas de coutume, lors de la grande rédemption, d’envoyer en ambassadeur son messager le plus humble ?
Puce et moi repartons élevés, transportés. Le contact de la terre sacrée nous a apportés tous les répits, toutes les consolations. Nous ne roulons plus, nous volons. Nos pneus ne reposent pas sur le sol, ils l’effleurent. Nous évoluons en un constant miracle. A nous les vents ! A nous les airs ! A nous les cieux !!!
Nos trajectoires sont impeccables, étonnante notre vitesse. Gauche, droite, gauche, droite. Nous avons dépassé les lois de l’adhérence. Un bout droit, je colle mon menton sur le réservoir, la barre de renfort du guidon me bouche la vue, n’importe, Dieu nous guide, la baraka nous sert de bâton d’aveugle. Banzaï !!!
Une bosse fait cogner mon menton sur le réservoir de ma Puce transgalactique. La réaction au choc me fait relever la tête, j’entrevois un trou… Un trou… Plutôt un nid de poule… de très grosse poule… De poule monumentale. Un ravin, un gouffre, un aven… Énorme, colossal, extra terrestre. On ne passe pas !!!
Un réflexe vital, ancestral, touterrainesque… motard, me fait dresser sur les repose-pieds, jambes semi-fléchies, bien en arrière, la pointe de mes fesses effleurant le jerrican à l’arrière de la selle. La roue avant passe, puis c’est la grande secousse, l’explosion, les sacoches cavalières se redressent comme les oreilles d’un cocker en pleine course, chargées comme elles sont, leur mouvement semble amplifier le décollage de la moto. Mirage IV en bout de piste d’envol, éteignez vos ceintures, attachez vos mégots, nous flottons, nous volons, au ciel quelques nuages transparents nous appellent. Puce, voilà la fin de nos peines. L’infini sans bornes nous aspire, si haut, si haut…
Et, lors de son vil échafaud, le clown monta si haut, si haut,
Qu’il creva le plafond de toile
Au son du cor et du tambour
Et le cœur dévoré d’amour
Alla rouler dans les étoiles…
(Volé à Banville, je crois)
« Tout ce qui monte devra descendre tôt ou tard ». Ce postulat nous vient de deux philosophes méconnus qui connurent, toujours ensemble, des hauts et des bas. Roux et Combaluzier s’élevèrent aux cieux le 8 mai 1771, jour de l’ascension : comme on ne savait pas encore se servir de l’électricité, ils moururent de faim, bloqués entre deux étages…
Cet implacable postulat nous tracasse, Puce et moi… Lorsque notre roue arrière a tapé le bord de ce fichtredieu de trou , on a décollé bien haut, à croire que nous allions échapper à l’attraction terrestre et partir vers une autre galaxie. Hélas, nous n’avions pas pris assez d’élan, au bout d’une très longue seconde, notre parabole ascensionnelle commence à s’infléchir. Il va falloir songer à l’atterrissage, en rappel sur le guidon, jambes semi-fléchies et le regard fixant la ligne bleue de l’Istrandja, car de la Grèce on ne voit guère les Vosges, ce qui ne facilite rien …
Notre atterrissage est quelque peu clownesque : lors de la première prise de contact avec le sol, les suspensions talonnent, leur détente nous donne l’impression de redécoller, et nous parcourons une trentaine de mètres avec une fourche avant qui pompe comme les suspensions d’une vieille 2 CV. Un coup d’œil en arrière pour vérifier que nous avons encore avec nous nos sacoches cavalières et notre réserve d’essence, et l’on ne s’arrête même pas, trop content de s’en tirer à si bon compte. Plus tard, à l’étape, je m’apercevrai que Puce a la jante arrière un peu en coin de rue. Stoïque, elle n’avait rien dit…
La route, entre Salonique et la Turquie, est vraiment … déroutante : cela va de la très belle à celle que l’on peut, je crois, appeler une piste. Tiens ! Tout à mes nids de grosse poule et mes megapistons, j’oubliais de vous dire ce qui fait le charme des rouets grecques, du moins de celles que nous avons prise, entre Patrai et Alexandroupolis, qui précède de peu la frontière turque : c’est la mer omniprésente.
Cette sacrée mer, on n’y échappe jamais longtemps, c’est à se demander si, au fond, la Grèce ne serait pas une mer avec quelques détritus de terre disséminés ça et là. Parfois, on ne la voit plus pendant une heure, on se dit « tiens, ce coup-ci, on l’a semée » soudain un virage, et crac ! On s’aperçoit qu’elle est toujours là, attentive, qu’elle suivait le voyageur, cachée derrière un pan de rocher. Si j’avais dû faire trempette à chaque fois que j’ai vu la mer, Puce et moi, au jour d’aujourd’hui, ne serions pas encore arrivés à Salonique…
Il y a aussi les stations à essence : de Patrai (port ouvert sur l’Europe) à Athènes, elles sont un peu comme cheu nous, mis à part qu’il y a à peu près toujours un bistrot attenant. A mesure que l’on s’approche de la Turquie, elles deviennent de plus en plus rares mais plus complètes, se doublent le plus souvent d’un restaurant. Par dessus l’odeur d’essence, vous sentez celle du graillou. Elles deviennent des oueds, des havres de grâce où l’on satisfait toutes les envies contractées au fil d’une longue étape : faim, soif, essence, pipi et j’en passe sans doute. En Turquie, beaucoup de stations-service font en même temps hôtel…
En milieu d’après-midi, Puce et moi abordons la descente qui mène sur Kavala, un chouette petit port, à 210 kilomètres de la frontière turque. La route est redevenue moderne, large, et les virages en descente sont vraiment ce que Puce préfère. Comme tout le monde se promène, on double sans cesse, à gauche, à droite, la furie du Gazzafon nous a repris dans ses serres veloutées, mais délicieusement sournoises.
Au détour d’un virage, nous apercevons deux Yamaha immatriculées en France sur le bas-côté, qui s’apprêtent à reprendre la route. Nous leur adressons un grand salut. Un peu plus loin, dans le rétro de Puce, je vois qu’ils nous suivent.
« Chiche, Puce, qu’on arrive avant eux à Kavala !».
Nous déboulons à toute vibrelure, en débrayant dans les descentes pour ne pas faire de la compote de vilebrequin. C’est triomphants, en tête de peloton, que nous arrivons au premier feu rouge de la ville. L’un des Yamahistes profite de l’arrêt pour me dire : « il marche bien, ton mini ! ».
C’était gentil, mais Puce a été un peu vexée… Ce qu’elle aurait voulu entendre est : « Elle marche bien, ta bécane ». Évidemment, avec ses 72 cc, son gabarit gros pour un chien mais tout de même bien petit pour une moto, elle n’en impose pas des masses, et le mauvais sort a voulu qu’elle ait été vendue dans un pays sexiste où les petites motos sont du masculin, et les gros trucs qui remuent beaucoup de vent ont droit au genre féminin. Puce a quatre vitesses, un circuit électrique élaboré, et refuse qu’on la catalogue avec des petits trucs tout juste bons pour la sortie du lycée. Puce, c’est la fille de Mercure et de Vénus, c’est l’androgyne, c’est la paix sur terre…
Pas trop bègueules tout de même, nous les retrouvons au bistrot du port, confortablement assis devant une limonade, et discutons de tout et de rien. Comme deux Harleyistes rencontrés avant Salonique , ils vont à Istanbul. Nous n’avons rien de bien original à nous dire, mais ça fait du bien, entre deux brouettées de kilomètres, de s’asseoir devant une boisson fraîche et de bavasser dans la langue que finalement, nous parlons le moins mal. Enfin, nous repartons, j’aimerais être à Alexandoupolis, la dernière grande ville grecque avant la frontière, avant la nuit. La nuit, tous les trous pucivores, toutes les bosses janticides sont à l’affût, et attendent le voyageur fatigué. En fait, la route est bonne… Pas aussi bien indiquée que nous l’aimerions, Puce et moi, car on n’a pas vraiment le sens de l’orientation. Enfin, après plusieurs arrêts-renseignements, un pope tout de noir vêtu et copieusement barbu nous donne la bonne route. Pourquoi ? Parce qu’il la savait.
En un mot, pope sait, y donne, huark, huark, huark…
Roule, roule, roule… La route est un ruban doré aux graviers luisants, bordé de champs. De proche en proche, un paysan, juché au milieu de sa terre, nous regarde passer, tranquille, parce qu’il fait chaud et qu’il faut prendre le temps de vivre.
Ce doit être le froid, la grisaille, qui rendent la bête humaine laborieuse et agressive. Ici tout a l’air d’aller bien, on a le temps. Depuis notre départ de Rome, j’ai installé mon sac de couchage plié sur la selle de Puce, il couvre ainsi le réservoir, la selle et mon jerrican triangulaire. Cela me fait une selle de branleur, je roule complètement vautré, comme sur un divan. J’ai l’impression que l’on pourrait aller ainsi au bout du monde, la vie est douce…
De temps en temps, il y a un triporteur à doubler. Il sont supercocasses, les triporteurs grecs, il y en a de beaux, somptueux comme des corbillards chinois, pleins de colonnettes peintes, d’arabesques et propulsés par des moteurs Volkswagen ou Datsun.
Il y en a d’autres… ripous, brinqueballants, en ruines, ceux-là ont des moteurs BMW moto d’avant guerre, auxquels on a rajouté un pont arrière et un différentiel. Selon leur degré de vétusté, ils avionnent entre 60 et 80 à l’heure, avec des « apchoum-apchoum » de vieux berlingot dont les soupapes n’arrêteraient pas une brise d’automne. Il faut les avoir vus et entendus pour y croire…
Dans notre béatitude semi-sommeillante, nous voyons à peine arriver Alexandroupolis. Il nous semble avoir à peine roulé ; « Dis, Puce, si t’es pas fatiguée, on pourrait continuer, on passe la frontière turque cette nuit ? ».
Puce ne répond pas. Le simple fait qu’on puisse imaginer qu’elle soit fatiguée…
Dix bornes après Alexandroupolis, nous doublons un scooter avec trente bornes de mieux, rien de bien étonnant, à partir de la Grèce l’entretien d’une machine se borne souvent à mettre de l’essence. Juste après l’avoir doublé, je réalise :
« Dis donc, Puce, il n’a pas de plaque d’immatriculation :
- Il a dû la perdre » me répond Puce qui déteste les scooters, de même que tous les engins qui n’osent pas montrer leur moteur. Un peu plus loin, ayant un doute sur l’itinéraire, nous nous arrêtons. Le bas-côté est fait de sable pulvérulent où Puce n’est pas à l’aise. Pendant que nous consultons la carte, le scooter nous passe devant.
Non, décidément, il n’a pas de plaque d’immatriculation. Bizarre, bizarre : Partout, sauf en France, on immatricule tout ce qui a un moteur. Serait-ce un scooteriste de chez nous ?
Nous repartons, ma Puce raciste et moi, direction la frontière turque. Puce, bien sûr, n’est jamais allée en Turquie, venue en direct du Japon en France. Moi non plus. Pour elle comme pour moi, ce sera la frontière de l’inconnu. On a un peu le trac, on roule vite pour le faire passer. On repasse le scooter, disons plutôt qu’on le laisse sur place. Pas violent, son ratagaz. Il commence à faire sombre, je n’ai pas le temps de détailler l’engin. A tout hasard, je lui lance un salut…
Une demi-heure ou une heure après, c’est la frontière. Elle ressemble un peu à un péage d’autoroute, et précède un pont dont, la nuit commençant à se faire bien noire, on ne voit pas le bout, ni même ce qu’il enjambe.
J’ai l’trac, les khôpains. Au-delà de ce pont, c’est l’inconnu qui nous attend. L’inconnu, vous connaissez ? Ah ! C’était une question piège…
Nous passons à la police et à la douane grecques, les postes turcs sont de l’autre côté du pont.
C’est l’Instant : ma Puce, ma pucette, ma petite chose androgyne m’aura, passé ce pont qui sépare la Grèce de la Turquie, mené plus loin que je suis jamais allé, que ce soit avec M. Essen Ceheffe, M. Air-France ou mes motos précédentes. Je découvre, oui, je découvre que ma Puce est magique, magique !
Comment croyez-vous que ce petit bout de moto, gros comme un demi-Vélosolex, m’ait emmené plus loin que de grosses machines n’aient su le faire ? Qu’elle m’ait fait rouler trente-six heures quasiment d’affilée entre Paris et Ancone, moi qui suis fainéant comme une couleuvre, atteinte d’hépatite virale à son stade final ?
Qu’elle m’ait fait rouler, au lever du jour, dans les Alpes carrément pas chaudes, moi qui grelotte au dessous de 27° C et souffre mille morts s’il faut s’arracher avant onze heures de la plume complice et moelleuse ? Comment l’expliquez-vous ? Comment ?
Puce est magique, c’est évident…
Avant de passer le pont, je déhotte au bistrot qui jouxte le bureau de police, et sirote deux cafés de suite, tout songeur. Sur ma lancée, je remplis quelques cartes postales. Il n’y pas de timbres, le bureau de poste est fermé, le garçon –le dernier Grec que je verrai en Grèce- me propose aimablement de les timbrer et les envoyer à ma place demain matin.
Je lui donne l’argent, les cartes n’arriveront jamais. Ma lééch… Oh, pardon, j’anticipe…
Je termine mon second café lorsque je vois le scooter de tout à l’heure franchir le poste de police. Il n’a pas de plaque, on ne l’a pas arrêté pour ça, c’est donc un Français, sur un scooter 50. Le temps de terminer mon jus, je sors, démarre Puce, et me mets face au pont. Il est vraiment long, et vire un peu dur la droite. Nuit noire. Le pont, seul.
Derrière nous, trois mille et quelques bornes de route, devant nous autant qui restent à faire. C’est le milieu, le point de non-retour. Il suffit de passer le pont, comme Brassens dit à César lorsqu’il franchit le rubis-con en proférant je ne sais quelle insanité.
Première. Embrayage. En douceur, deux, trois, quatre. J’entends à peine le moteur de Puce. Notre phare 25/25 W découpe devant nous un halo ringard, pensez, peut-être à quatre mille tours de régime-moteur, ça débite pas beseff.
Un panneau. Une ligne jaune, « Turkiye » ou quèque chose comme ça. Alea iacta est. Ah oui… j’ai jeté Léa. Téléa-via, via-duc, on est sur un via-duc. Au dessous de nous, il y a le trou, devinez son nom ? Il fait frais, un long frisson me parcourt. Cette fois, c’est la Turquie…
LA MAIN QUI SE TEND
Au bout du pont, c’est la douane turque. Comme la gabeloute grecque à Patrai, le douanier turc me marie à ma Puce, en portant son nom et son numéro d’immatriculation sur mon passeport. Puce et moi sommes maintenant trois fois mariés. Pendant que je discute avec mon douanier, un gars d’une vingtaine d’années s’approche et m’interpelle en français. Un peu plus loin, garé devant la boutique de change, j’aperçois le scooter déjà vu plusieurs fois avant le passage de la frontière. C’est donc lui !
Lui, c’est Jean-Marc. Jean-Marc Brillouet, venu ;, tenez-vous, de La Rochelle sur son scooter Vespa 50 cc, de ces trucs à trois vitesses et 1 CV DIN à 6000 tours minute, qui vous dépote à 45 à l’heure dans les descentes avec le vent dans le dos, s’il fait beau. J’en suis assis, et lui fait les remarques que me firent les pilotes de grosses motos rencontrés sur le chemin.
Tu n’as pas peur de t’endormir entre deux virages, sur ton soufflet à punaises ? Combien de temps as-tu mis ? Cela fait vingt jours qu’il est parti. Où vas-tu ? Il va à Istanbul, lui aussi. Istanbul n’est qu’à 250 kilomètres, c’est dire qu’il y est presque. Seulement, après, il y aura le retour, et Jean-Marc se demande comment il va rentrer : il n’a presque plus de ronds, et ne sait si, au retour, il aura assez pour payer à la fois sa bouffe et l’essence de son Vespa.
J’ai aussi l’impression qu’il en a marre de rouler sur son truc qui se traîne. En plus, cingler vers un but, en se disant « c’est là que je veux aller », ça vous donne des ailes, ça vous fait oublier le mal de fesses et tout, mais le retour, s’il n’y pas de choses merveilleuses qui vous attendent chez vous, c’est la grosse tasse.
Jean-Marc a envie de mettre son Vespa dans le train. Aura-t-il assez de fellouze pour ce faire ? Il n’en sait rien… Quant à moi, je viens de trouver un ami, un dingue, un… pur qui ne calcule pas ses coups.
Ayant encore du chemin à parcourir, je suis plus argenté que lui, je lui propose donc une grosse bouffe à Keçan, le prochain bled, à cinquante bornes d’ici ? Où tu couches ? Sous la tente ? Baste ! On va arriver à Keçan passé minuit, je t’offre l’hôtel aussi !
Jean-Marc ouvrant la route à vitesse réduite -45 sur le plat, 30 dans les montées- nous partons vers Keçan. Puce n’est pas vraiment contente : « Non mais, tu as vu sa machine ? Quelle pèquenaude, excuse-moi ! En plus, elle se traîne, tu penses un peu à mes sept mers ? On en a vu trois : l’Adriatique à Ancone, l’Ionienne à Patrai et l’Egée nous a suivis d’Athènes à Alexandoupolis. Il en manque quatre. Si nous continuons à rouler avec ce machin-là, il nous faudra cent ans pour les voir… ».
De colère, Puce mouille sa dernière bougie froide. De la NGK B 9 HS, il nous faudra désormais descendre à la B 8. Nous le regretterons plus tard…
A l’allure du Vespa, la route nous parait effectivement longue. Quelqu’un est toujours la tortue de quelqu’un d’autre… Voilà enfin Keçan, dont la première maison est une station-service-bar-restaurant-hôtel comme il y en a beaucoup par ici. Aussitôt les pleins faits, nous filons au restaurant en terrasse qui surplombe la station-service. Il est passé minuit, et nous avons faim, mais faim !!!
La mangeaille turque courante ressemble de très près à la grecque, mais avec des nuances : la viande est plus abondante, la salade de poivrons, de tomates et d’oignons est coupée menue au lieu d’être servie à la paysanne.
A cet instant, je réalise l’un des plaisirs du voyage. Sur la route, je n’ai jamais mangé deux soirs de suite la même chose, car chaque soir, en moyenne, je me trouvais cinq cents kilomètres plus au sud-est. Où serai-je, que ferai-je demain ? Ma léch…. J’anticipe encore…
Honnêtement goinfrés, nous demandons au garçon : « Avez-vous des chambres de libres ? ».
- « Désolé, non » répond-il.
Eut-il répondu oui, il nous eût évité une galère, mais comme le disait le cardinal, les choses étant ce qu’elles sont, ne sont plus ce qu’elles étaient, mais pas encore ce qu’elles seront.
Nous reprenons donc nos machines, pour aller vers le centre de Keçan. C’est une sorte de grand village aux maisons resserrées, aux rues étroites, pavées, bosselées, bourrées de nids de poules. Plis nous avançons dans la ville, plus les rues de font sombres, resserrées. Au premier panneau « Hotel », je mets pied à terre, et me dirige vers la réception. C’est un petit hall mal éclairé. Face à moi, un comptoir vide, dans la salle une dizaine de personnes est assise, et me regarde sans rien dire. Histoire de me donner une contenance, je veux dire « bonsoir » mais diable, je ne parle pas un fichtre mot de turc. Alors, quoi ? En dehors du turc qu’était pas une option à mon école maternelle, j’parle plein de trucs. Alors en quoi on attaque ? En français, en anglais, en italien, en espagnol, en arabe ?
J’essaie en anglais. « Good evening » fais-je avec une inclinaison de tête à la cantonade…
Silence… On me regarde toujours sans rien dire. Coincé ainsi entre deux rangées de regards froids, je ne bande que d’une un quart…
Enfin le Cerbère survient, attend de se jucher derrière son comptoir, et me demande en anglais ce que je veux.
Deux chambres ? Désolés, nous sommes complets.
Cinq hôtels ainsi, cinq fois la même réponse.
Je me sens vraiment mal à l’aise, et propose à Jean-Marc de faire voile vers Istanbul qui, au fond, n’est plus bien loin, même à la vitesse du Vespa. Cinq ou six heures à tout casser. Jean-Marc ne veut pas rouler de nuit. Nous camperons, dit-il, je t’invite sous ma tente. Nous sortons de Keçan pour rejoindre la route d’Istanbul.
Un bled, deux bleds, trois bleds, et toujours pas d’hôtel. Au bout d’une demi-heure, nous passons devant une sorte de campement illuminé, nous passons notre chemin jusqu’au village suivant. Toujours rien. Jean-Marc propose de revenir au camp que nous avions vu.
Demi-tour, il est deux heures du matin lorsque nous retrouvons notre « terrain de camping ». En fait, c’est une ferme éclairée pour le travail de nuit. Jean-Marc propose de planter la tente près de la ferme, dans les champs. Bien sûr, tous les manuels de tourisme recommandent de ne pas planter la tente dans des endroits isolés, mais ici, il n’y a que des paysans. « Les paysans sont toujours de braves gens » dit Jean-Marc. Voici la tente plantée. Nous nous installons, et en avant la dormette…
Ayant eu un ancêtre chat, je ne dors que d’une.
Juste avant le lever du jour, un bruit me réveille : c’est un tracteur. Notre tente est installée tout contre une meule de foin. J’entends de nombreuses voix d’hommes et de femmes, à leur ton, je sens que c’est de nous qu’on parle.
Je ne bouge pas mais descends lentement une main vers mon cotello a scatto, un couteau à cran d’arrêt acheté à Rome. C’est plutôt dérisoire, mais que voulez-vous, c’est la première fois que je campe au milieu de nulle part dans un pays qui n’a pas trop bonne réputation. Allons, c’est normal que les paysans du coin s’intéressent à une tente de camping et deux motos qui ont miraculeusement poussé comme ça pendant la nuit au milieu d’un champ. Le bruit du tracteur reprend, s’éloigne avec lui les voix, les rires. Je me rendors…
Tiens, le jour est levé. Il filtre tout pâlot à travers la toute petite fenêtre tressée de nylon de la tente.
J’entends deux hommes, cette fois ; ils parlent aussi de nous, puis s’en vont… Peu après, nous voilà debout, Jean-Marc et moi. Il n’a pas fait froid cette nuit, mais il a plu. Vous vous rendez compte ? Plu !
Le ciel est sombre, bouché. Plier la tente à deux, c’est vite fait. Le temps de faire une petite photo souvenir, comme si nos malheureuses têtes ne suffisaient pas à les contenir, et nous repartons.
Nous sommes en contrebas de la route, la terre est argileuse et humide, nous voilà partis, Puce et moi, en dérapage, bille en tête. Ric, dérapage à gauche, contrebraquage à fond, sans poser à terre. Rac, travers à gauche, même faute, même punition, nous sommes à vingt mètres de la rampe boueuse qui mène à la route, j’entends derrière nous un bruit de chute et un « merde ! ».
Notre compagnon de route a dû de gaufrer. Ne pas ralentir, garder l’élan… La rampe est avalée gaz à fond, voilà Puce sur la route. Je regarde en bas, Jean-Marc est en train de ramasser son Vespa. Je descends pour le pousser dans la montée, mais le fichu scooter ne redémarre pas.
Démontage de la bougie, elle est noyée. Elémensonne, mon cher Walter ! On la sèche. Le moteur repart, tourne cinq secondes et s’arrête à nouveau. Bien ! Jean-Marc tirant, moi poussant, on hisse le Vespa sur la route, près de puce triomphante. « tu vois, dit-elle, je te disais que lorsque l’on cache son moteur, c’est parce qu’il marche mal ».
Elle est dure, la Puce.
Bougie encore noyée. Je sors une NGK B 7 HS de mon stock et la monte sur le scooter ; au passage, Jean-Marc m’a révélé un nouveau trait de son caractère aventurier : il n’a quasiment pas d’outils, et ne connait rien en mécanique.
Il a déjà eu des ennuis de carburateur en Italie, qui lui ont coûté très cher. Bref, même topo, ça tourne cinq secondes puis extinction des feux. Trouvez l’erreur… Je ressors la bougie, mets le filetage à la masse sur le carter de ventilateur coup de kick. Une superbe étincelle bleue, large. C’est donc une affaire de carburation.
Sur un moteur à volant magnétique, on n’a jamais une aussi belle étincelle lorsque l’avance à l’allumage est par trop décalée. A nous le carbu… Z’avez déjà bossé sur un Vespa ? De ce côté-là, j’étais puceau.
Dieux du ciel, quelle tristesse ! Pour gratter sur un machin pareil, il ne fait pas être mécano, mais spéléologue ! Après m’être fait douze plaies, dont neuf contuses pour sortir le carburateur, je le démonte…
Mal fichu en diable, ce carbu de mes deux choses… Sur ce, deux catastrophes surviennent : primo ; du haut des nues commence à tomber un crachin merdouilleux, gras, slictueux, dégoulnasse. Secundo, rapplique une bande de moutards de grosso modo six à dix ans.
La pluie, jamais aimée, excuse-moi. Quant aux petits garçons, je ne suis pas contre, loin de là, mais ceux-là eurent tôt fait de nous emmerder… Comme la pluie !
Au début, ils n’étaient que six ou sept, à nous demander des cigarettes. Oh ! bien sûr, j’en avais, des Gitanes sans filtre auxquelles je tenais comme à queau de mes pouilles, vu que là où nous sommes, si vous demandez des gitanes blanches, on vous regarde comme un Iroquois qui, dans un restaurant végétarien, demanderait : « Avez-vous du bison cru ? ».
Bref, j’ai écarté les bras d’un air désolé, « ma fi ! », j’en ai pas. Affirmation crédible étant donné que l’on ne m’avait pas vu fumer. En fait, les gosses, tout le temps que nous restâmes à mécaniquer, restèrent groupés autour de nous.
De six ou sept, ils furent dix, puis une quinzaine, devisant à voix basse dans une langue pour nous incompréhensible, nous montrant de temps à autre du doigt. Jean–Marc, Puce et moi, nous nous sentions dans la peau de marchands de caviar en 1943 dans le ghetto de Varsovie.
Vraiment mauvais, mauvais, cette bande de mômes qui nous assiégeait de sa présence, de ses murmures, et de ses regards étranges. Que voulaient-ils ? Nous voler quelque chose ?
Je ne pense pas être radin, mais je teins, par exemple, à mes outils. J’ai de quoi réparer n’importe quoi sur ma Puce, et je tiens à ce que ça demeure ainsi.. A chaque fois qu’il me fallait contourner le Vespa pour raisons techniques, je disais sèchement à Jean-Marc : « Gaffe, les clous ! ».
J’étais en colère, je sentais que d’un moment à l’autre, j’allais prendre mon démonte-pneu le plus lourd, et éclater le crâne du plus proche de ces foutus moujingues, qui émiettaient entre leurs dents des chuintements aigus, je ne sais pourquoi. Mais bon dieu, que veulent-ils ces moutards ? Je n’en sais rien.
Je leur ai offert tous les bonbons que j’avais accumulés en Italie en guise de spiccio, de monnaie, puis leur ai crié « du vent » dans toutes les langues que je pouvais « Scram ! Raus ! Taillez-vous ! Via ! Aal béét, vayanse ! ».
Rien à faire, ils restaient toujours là, à nous regarder en conversant d’un air entendu. Je commençais à en avoir marre, marre le temps qui passe, ce Vespa de merde qui ne marche pas on ne sait pourquoi, ces putains de moujingues qui nous chient sur les arpions, cette chiasserie de pluie de merde qui nous dégoulnasse sur la gueule, sur les paluches, partout ! Eh merde, eh merde, eh merde !
J’attrape ce foutu Vespa de mes choses, et le traîne jusque sous un abri de bus où, au moins, on sera plus au sec, et recommence à mécaniquer. Les mômes, comme de juste, nous suivent. Un chien veut nous suivre aussi, mais, hésitant, se fait cartonner en plein travers par une bagnole qui ne ralentit même pas.
Les mômes rigolent… dans ma trousse à outils, sous mes yeux, il y a ma clef à œil de 21/23. Cette fois, c’est pas possible, j’en tue un…
La main que l’on cherche
Ma clef de 21/23 est un bel outil, chromé, poli, maniable, sans doute apte à faire une putain de bosse sur un crane d’emmerdeur. Mes doigts s’allongent déjà gracieusement vers l’outil presque chirurgical, lorsqu’une idée, soudain, me traverse la calbombe : la même qu’à Ancone après notre plus longue étape : « et mon cul ? ».
Mon cul, c’est l’échappement, tous les gastro-entérologues vous le diront. « Couche-le à droite » dis-je à Jean-Marc. Il couche son Vespa sur le côté, et la cause des ennuis, évidente, lumineuse, nous saute aux yeux : la sortie du pot d’échappement, qui est sur ces engins pieusement dissimulé sous le tablier, est obstrué par la boue, par suite de la gamelle de tout à l’heure.
Je me mets à rire, rire, mais rire ! Une rigolade franche, nerveuse, spasmodique, hystérique. Connécons, connécons ! Connécons !! Mais… connécons !!!!
Un tournevis, ascronch, asscronch, assscronch, la boue déjà séchée est partie, coup de kick, le Vespa se remet à parler dans un nuage de fumée bleue. « Foutons le camp ! ».
Je saute sur Puce, un coup de kick, en route pour le prochain village. Nous retournons vers celui que nous avions exploré à la recherche d’un hôtel, la nuit dernière. D’abord manger, nous abriter de la pluie, nous bouffons, bouffons. Pendant ce temps, la pluie tombe, tombe…
« T’es équipé pour la pluie ?
- Non, et toi ?
- Non plus… ».
Enfin, lorsque l’on va vers ces pays bénis où parait-il, au moins en été, on compte les précipitations en millimètres, et où un parapluie a l’air d’une plaisanterie, est-ce que l’on amène des vêtements imperméables ? Attendons la fin du déluge…
Une heure, deux heures quinze, trente, quarante cinq, trois heures… La pluie persiste. Il faut aviser. Je vais acheter un imperméable, dis-je en me levant. Attends-moi… Me voici parti dans le village, regardant en coin les vitrines, à la recherche de n’importe quoi qui protège de la pluie… Au coin d’une rue, un magasin d’habillement.
« Do you speak english ?
-…
-Parlez-vous français ?
-…
-Parla italiano ?
-…
-Habla espanol ?
-…
-Vocè fala portuguèch ?
-…
-Sprechen zie doïtche ?
-…
-Milaté ellinika ?
-…
Taak Aarabi ?
-…
-Hal tafham ou Aarabiya ?
-…»
Pas à dire, c’est bien parti. Si j’ai bien compris, ici le français n’est pas parlé, on ne speake pas l’anglais, on ne sprèche pas le teuton, on ne parle pas italien, l’espagnol ne se parle pas, vous ne parlez pas portugais, parlez pas grec et tu ne parles pas l’arabe, ni en dialecte, ni en savant.
Histoire de rigoler, j’aimerais demander « parlez-vous turc » à tout hasard, mais je ne sais pas le dire… Notez que si le marchand de sapes parlait grec, allemand ou arabe, j’aurais du mal à dire dans ledit idiome un truc aussi chiadé que « je veux un vêtement pour faire de la moto sous la pluie » mais bon, j’essaie d’ouvrir la conversation. Échec complet.
Essayez de dire « imperméable » sans ouvrir la bouche ! Je me mets à faire des gestes amples, m’enveloppant des épaules au bas des genoux, puis désigne la veste imperméable en devanture.
Aussitôt, avec des sourires larges comme ça, on m’amène un imperméable pour femme, un truc à coup sûr très cher, avec un col super-design, super-élégant, super-m’as-tu-vue… J’essaie de dire en arabe, puis dans toutes les langues que je connais plus ou moins : « ça, c’est pour femme, j’en veux un pour homme ! » en appuyant mes paroles des gestes explicites que vous imaginez.
Ce coup-là, on m’amène des manteaux de fourrure. Après maintes gesticulations, on m’emmène au premier étage, une véritable caverne d’Ali Baba, où les nippes insensées voisinent avec les fringues pas possibles.
Là, je suis rejoint par trois ou quatre jeunes garçons et deux jeunes filles, qui commencent à étaler leur connaissance dans la langue de Shakespeare.
« Ceci est mon frère. Ceci est ma sœur. Ma sœur étudie l’anglais. J’étudie (à la forme progressive, cette fois) l’anglais. Ma sœur étudie l’anglais ».
Du coup, m’enhardissant, je tente la phrase qui tue : « My tailor is rich ». cela ne les fait pas rire.
Évidemment, c’est de l’humour à Mimile. Puis mes gamins et gamines m’ont fait asseoir sur un divan, et offert du thé et des cigarettes. J’étais au début un peu choqué de les voir, ou plutôt entendre siroter leur thé en aspirant bruyamment, je pensais à la chanson de Jacques Brel « Et ça fait des grands schrllllp, et ça fait des grands schlurrrrrp ! ».
Au diable ces petits détails, ils boivent le thé tellement brûlant que, si vous faites autrement, vous mourez carbonisé. De « ceci est mon frère » à « il est un quart vers une », il n’y a qu’un pas, et me sentant depuis toujours le fibre pédagogique, je me retrouve en train d’enseigner « il est douze vers sept heures » and so on.
De temps en temps, entre deux tasses de thé, je fais l’inventaire de la caverne d’Ali Baba, dans le vain espoir de trouver un imperméable pour homme-à-moto et pouvoir poursuivre mon voyage… Quel voyage ?
Je me rassois sur le divan, tire une longue bouffée de ma cigarette turque, du moins j’espère, regarde mes jeunes élèves, regarde dehors… Dieu ! Mes sens m’abuseraient-ils ? je crois voir un soleil blanc qui sèche les pavés humides de pluie, je crois voir, je crois voir… Je vois !
Sans précipitation, c’est le cas de le dire, je me redresse, soleille un sourire à mes jeunes hôtes, et leur dis en anglais : « Voilà le soleil, j’ai à partir ». d’un pas lent mais décidé, je traverse la caverne d’Ali Baba, descends l’étage, et sors.
Devant le restaurant, c’est la fête : Jean-Marc, qui quand je l’ai quitté, avait le moral au double-zéro, a été réveillé par le soleil.
Il est en train de rire avec une bande de gamins groupés autour de Puce et du Vespa. J’entre comme un bon con dans le restau et lui dis : « T’as vu le soleil ? ». Il ne répond pas, il rigole et prend des photos.
Notre moral à tous deux est monté du trente-sixième dessous au cinquantième dessus, tout cela à cause d’un rayon de soleil. C’est marrant, on dirait que tout le village se dégèle. Un client du restau me pose un tas de questions sur Puce, et me laisse son adresse, ce qui me permet de dire où on était, Jean-Marc, Puce et moi : dans un bled qui s’appelle Malkara-Tekirdae, excusez l’autaugraffe, mais cé mâle hékri.

Sous les applaudissements de la foule enfantine, voilà Puce qui donne de la voix, suivie du Vespa. Le village étant sur une hauteur, nous descendons bille en tête vers la route principale. A la première station-service, arrêt-plein d’essence, méfiant quant au pourcentage d’huile mise dans le mélange du vespa, j’ajoute une grosse giclée de 300 V, pour qu’il ne descende pas son moteur, puis…
« Ecoute, me dit Jean-Marc, il vaut mieux qu’on se sépare. Moi, j’arrête à Istanbul, c’est pas loin. Toi, tu n’es pas arrivé. Pars devant, il marche, maintenant, le Vespa ».
On se donne rendez-vous à la poste centrale, bureau de poste restante, le lendemain, deux heures, si je me souviens bien. Plus j’avance sur la route d’Istanbul, plus je regrette d’avoir laissé mon copain tout seul. Les Turcs sont vraiment des conducteurs spéciaux. Toute leur vie est basée sur une idée : doubler.
L’individu moyen double quand il peut. Le Turc double quand il veut, et il veut tout le temps. Les poids lourds, kif-kif. C’est dire que quand, en Turquie, vous arrivez sur un sommet de côte, vous êtes sûr d’une chose : arrivé au sommet, vous vous trouverez face à deux gros culs ou deux gros cons en train de se doubler.
La route étant la plupart du temps à deux voies, vous avez le choix, à moto, entre le crash total et le voyage sur le bas-côté. Sur quelques 2500 kilomètres accomplis en Turquie, combien en ai-je fait sur les bas-côtés ? Dieu le sait…
Il fait très froid, ou du moins j’en ai l’impression. A chaque virage, chaque sommet de côte, il faut garder un œil sur le bas-côté, pour prévoir une échappatoire en prévision du sac de nœuds qui vient dans l’autre sens.
Avez-vous déjà croisé deux poids lourds en plein dépassement, le dépasseur vous frôlant ? Le déplacement d’air est colossal ! Chaque croisement me rabat la visière de casque sur le nez et nous fait zigzaguer, Puce et moi. Je pense avec horreur à ce que doit souffrir le copain Jean-Marc, avec son machin en forme d’oriflamme, qui prend les tourbillons comme voile au vent !
Gauche, droite, bas-côté, coup de hanches pour passer la berme, ça devient bien vite automatique. Puce et moi, on a pratiqué l’enduro, ce n’est pas un poids lourd, turc de surcroît, qui va nous faire peur. De proche en proche, des voitures de tourisme pliées comme des sandwichs grecs, immatriculées en Italie, en France, en Allemagne… Des gens pour qui les vacances se finissent là, parce qu’en Turquie, il faut doubler, doubler…
Un long arrêt, autant pour contempler notre quatrième mer que pour attendre le Vespa qui, peut-être , nous rattrapera… Quatre mers déjà… nos sommes sur une petite falaise tapissée de terre humide et d’herbe luisante, pourtant nous nous promenons au dessus d’une mer, la mer de Marmara. Joli nom. Et le Vespa… ? Le Vespa ne vient pas.
Nous eûmes beau, repentants, traîner, nous arrêter dans toutes les stations de thé-service, regarder les engins passer, nous ne le vîmes pas venir. Comme de juste, j’ai paumé son adresse. Il s’appelle Jean-Marc et venait de La Rochelle. Le lendemain, il ne sera pas au rendez-vous de la poste centrale, guichet « poste restante ».
Si vous le voyez passer, bizarrement fringué, traînant sous son séant un Vespa déglingué, messieurs, passez-moi un mot, dîtes-moi qu’il est encore sur terre.
Puce et moi reprîmes notre route, cette route qui mène à Istanbul, où, morbleu, tant de gens rencontrés en chemin disaient vouloir se rendre. A quoi donc peut ressembler Istanbul qui attire tant de voyageurs ?
La main qui échappe…
Je viens d’entrer, on m’a ouvert la porte sans un mot, je me retrouve au milieu sans un mot, je me retrouve au milieu d’une très vaste salle à manger assez pauvrement meublée, comme un restaurant à quinze balles, service compris. J’ai oublié ce que j’étais venu faire ou voir. Je voulais voir un ami, mais qui ?
Je ne m’en souviens plus. Une centaine de convives discute par petits groupes et personne ne se soucie de moi, me demande ce que je viens chercher, ni rien. Cela m’arrange un peu, puisque je ne m’en souviens plus. Alors que je passe devant une table, un convive, un Turc, je crois, me sourit, semblant me reconnaître. Heureux, je m’approche, il me tend la main, je crois qu’il veut me saluer, je m’approche main tendue, il croise les doigts et regarde ailleurs comme s’il ne m’avait pas vu. M’a-t-il vu, d’ailleurs. Je n’en sais rien. Je continue à longer les tables de la salle à manger, un pue plus loin une nouvelle main se tend. Je tends à nouveau la mienne, même manège.
C’est alors que je m’éveille… Où suis-je ? une chambre étriquée, aux murs badigeonnés de blanc. Un lit métallique, ah oui ! je suis, tenez-vous bien, à Seriflikochisar, entre Ankara et Adana.
Mon rêve résumé ce qui s’est passé depuis mon entrée en Turquie il y a bientôt trois jours : la Turquie et moi, nous nous sommes ratés. Puce et moi l’avons traversée sans jamais la toucher. Nous sommes restés une journée à Istanbul, où le courant n’a pas passé.
On ne rit guère à Istanbul, les gens nous croisaient, l’air triste ou indifférent ; seuls les commerçants nous faisaient les yeux doux, eux seuls semblaient vouloir ou pouvoir parler une autre langue que le turc. Cela serait tellement chouette si tous les gens du monde voulaient apprendre à l’école une même seconde langue, l’anglais, par exemple. Un Français face à un Turc aurait à faire l’effort de parler anglais, le Turc faisant le même effort de son côté. Ce serait kool…
Enfin, la Turquie, c’est raté. Puce et moi avons décidé de partir au plus vite, de traverser la Turquie, d’Istanbul à la frontière syrienne, en deux jours au lieu de trois.
Nous pensions faire Istanbul-Ankara, Ankara-Adana, Adana-Gaziantep et ne passer la frontière qu’au matin du quatrième jour, nous avons quité Ankara pour aller plus avant, à Seriflikochisar (si !) cent kilomètres plus loin.
Ainsi, si Dieu le veut-en Allah rad- c’est demain matin que nous passerons en Syrie. Faire de la route en Turquie, c’est exposer sa chienne de vie seconde après seconde. Tous les dix kilomètres, on trouve dans le fossé des carcasses fraîches de voitures, et surtout de camions désintégrés, de plus on voit circuler des véhicules délabrés, ruinés, hors d’âge, c’est la terreur… Puce et moi, on a même ramassé une gamelle, la première de ce voyage.
On allait arriver dans les faubourgs d’Ankara, un camion-benne arrivait en face, soudain nous avons vu un nuage de poussière au niveau de son train arrière et entendu une explosion. « Tiens, dis-je à Puce, il a éclaté un pneu » ça ne me faisait ni chaud, ni froid, je commençais à être habitué aux petits aléas de la circulation turque, je m’en faisais un jeu, même. J’avais tort.
Les deux voitures qui nous précèdent font un écart brutal, je freine sans changer de file, dans l’expectative… Merde et merde !
De sous la voiture devant nous, gicle un gigantesque éclat de pneu lâché par le camion-à-explosion, un énorme tiers de circonférence noir qui trémule sur la route comme un serpent agonisant. Je rentre une vitesse, me dresse en arrière sur les repose-pied et accélère à fond. La roue avant passe avec un choc mou, je me crois sorti de l’auberge, baste ! La roue arrière refuse l’obstacle. Puce s’arrête sur place, tout le monde descend. Derrière nous, j’entends un couinement de freins.
Tout en gamellant, je pense que je suis en veste de Levi’s manches retroussées, que mon pantalon est en toile, ça va être un massacre, je n’ai même pas de gants. Dès que j’ai pris contact avec le macadam, je regarde derrière moi pour voir un vieux pick-up américain, plein de monde à ras bord, qui freine comme un perdu.
Il s’arrête tout de même à l’aise, à cinq mètres de Puce, Dieu est grand, il m’a mis sous les roues du seul vieux Ford turc qui ait encore un peu de freins. Debout, les morts !
Je me relève un peu courbatu, je regarde d’abord mes mains. Une traînée de goudron sur les paumes, c’est tout. Aux bras, rien non plus.
Je relève Puce, mis à part les sacoches qui ont volé à trois mètres, elle n’a rien, rien, rien ! Pas même un cabochon de clignotant cassé, rien !
Je remets tout le matosse en place et, repoussant d’une main négligente les occupants du vieux Ford qui me proposaient de prendre à parti le chauffeur du camion, je repars. Tout à ma joie d’avoir bûché impunément, comme si Allah nous avait pris dans sa main et déposés délicatement à terre, je crie sept fois : « Allah Akbar ! ».
A la septième fois, Allah me répondit :

Je me le tins pour dit. C’était notre première gamelle, survenue à un moment où nous étions trop sûrs de nous. Ce fut la seule en ces huit mille kilomètres de vagabondage.
Ce sont les rares impressions que nous avons gardées, Puce et moi, de la partie de Turquie que nous avons déjà traversée. Comme par hasard, entre Istanbul et Ankara, nous avons commencé à avoir des ennuis d’allumage.
On roulait à 80 environ, suivant un bus comme nous n’en avions jamais vu : son châssis était tellement tordu qu’il roulait perpétuellement avec dix degrés de déport par rapport à la route. Il donnait l’impression d’être en train de tourner à droite.
Bref, par-dessus le bourdonnement de ma Puce, j’ai commencé à entendre une résonance aigüe des ailettes de cylindre. Bien souvent, cela signifie un serrage de piston à venir. Tournant la tête de côté pour analyser le bruit, j’écoutais, j’écoutais, quand la bougie que j’avais montée avant Istanbul nous lâche.
Je l’ai démontée, elle portait semble-t-il des traces de ce que les mécanos appellent du jus de piston, de l’alu fondu provenant de la calotte du piston surchauffé. Contrôle d’avance à l’allumage, Puce avait pris dix bons degrés d’avance. Ce fut vite réglé, mais pourquoi ce décalage, et surtout pourquoi dans le sens avance ? Généralement, un système d’allumage mécanique qui s’use perd de l’avance, mais n’en gagne pas…
En attendant, il s’agit de quitter la Turquie. Nous sommes grosso modo à six cents kilomètres de Gaziantep, dernière ville avant la frontière syrienne, et pour y parvenir, il nous faut traverser la chaîne du Taurus. On n’est pas arrivé.
La route à nouveau avec son lot décakilométrique de voitures et camions accidentés. Des motos, on n’en voit guère en Turquie, pays qui semble encore en être à l’ère de la voiture-à-tout-prix que connut l’Europe dans les années cinquante-soixante.
Lorsque Puce et moi avons franchi la Corne d’Or sur un bac, un conducteur de vieille Opel pourrie m’a dit : « La moto, c’est pas bon. Laisse ta moto, jette-là et viens avec moi dans la voiture ! ». Hélas ! J’aurais voulu savoir dire : « la moto, c’est le pied » en turc.
De temps en temps, tout de même, on double une moto, oui, on la double ! Ce sont de vieilles 250 et 350 Jawa tchèques, elles doivent rouler avec un mélange à 90% d’huile tant elles fument. Le moindre chien, là-bas, peut humer l’air et dire « Il y a 25 jours et 16 heures environ, une moto est passée ici ». La moto en Turquie, ce n’est pas le truc…
Puce et moi, on s’en fout, on s’en va. Le Taurus, nous commençons à le voir. C’est une ligne grise, lointaine, lointaine, une idée de ligne grise. Nous avons du mal à imaginer que nous allons la rejoindre, cette espèce de ligne d’horizon. L’horizon, à force de le regarder de loin, on s’est mis à penser que l’on ne pouvait l’atteindre…
Seulement, ma Puce, je vous l’ai déjà dit, est magique. Au bout de quelques heures, « ça » s’est mis à monter, preuve que nous avions atteint l’horizon, en l’occurrence les monts du Taurus.
Le Taurus, c’est beau. Les Alpes avec le froid en moins. Il fait même très beau, c’est tellement bon de jouer les pilotes de vitesse sur une route de montagne quand il fait bien chaud bien sec. Enfin, jouer les pilotes de vitesse quand ça descend, en montée, on ménage le matériel, mais à quoi sert une montée, si ce n’est à préparer la descente qui suit.
Dans une de ces descentes, j’étais en train de copier à peu près exactement le style de Phil Read, multiple champion du monde. Gauche, droite, droite, gauche, droite… attention, virage à droite fond de troisième, mais sans aucune visibilité. Je ralentis et élargis ma tra
Dernière édition par cobalt57co le Ven 18 Jan 2013 - 11:59, édité 4 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Une maison en pierre de taille, d’aspect médiéval, au milieu d’une vaste étendue de sable. Au-delà, des champs bien secs pour qui vient du nord, c’est la frontière syrienne. On a parcouru sur des kilomètres une route bordée de barbelés qui ne semblent protéger que du sable, hérissée de proche en proche d’un mirador. Une zone frontalière de ce style, ça donne carrément l’impression d’être entre deux pays qui se méfient l’un de l’autre.
Lorsque l’on a quitté la Turquie, on nous a dit que, sans visa, on nous laisserait jamais entrer en Syrie. Nous sommes arrivés à la barrière fatidique. Au-delà de ce morceau de ferraille blanc et rouge, c’est l’Orient.
Ya Bab ech-Charq, porte de l’Orient, Puce et moi te demandons passage. Sympas, les douaniers syriens, toujours est-il qu’il faut attendre ici vingt-quatre heures.
« Il faut téléphoner à Damas et, ici, le téléphone, c’est très long, mais vous voyez, il y a un restaurant juste là, si vous voulez dormir, vous avez des buissons là bas pour être à l’ombre, vous ne manquerez de rien …».
Effectivement, presque en face du bureau de douane, il y a un café-restaurant-épicerie-bazar, j’ai demandé du papier pour écrire et, écartant les bras avec une mimique consternée, on m’a répondu : « Ma fiii ! ».
Y’en a pas, pourquoi voudrait-on écrire, alors qu’il fait si chaud, qu’au-delà de la terre sèche qui nous entoure, il n’y peut-être rien. Pour occuper mon temps, je révise le « manuel du parler arabe au Moyen Orient ».
Sorti une seconde pour accomplir un devoir trivial, je trouve en rentrant un garçon d’une dizaine d’années en train de crayonner mon manuel. En gros caractères hésitants, il recopie « Jean Kassab » en oubliant un « s » au passage, peut-être parce que l’on ne double pas les consonnes en arabe, enfin si, mais pas en les écrivant deux fois, il y a un accent pour ça.
Cela fait une heure que je suis en Syrie, et Allah m’a déjà envoyé un ami.
Nous nous donnons mutuellement des cours d’écriture, chacun dans son alphabet, puis mon condisciple me demande : « Où vas-tu dormir, cette nuit ? ».
Je désigne les arbres rachots, en face du poste de douane : « Là ! »
- « Viens chez moi ! »
Deux choses me retiennent : d’une part, mon compagnon m’a l’air bien jeune pour décider qu’un tel sera invité à la maison ce soir, d’autre part, sans autorisation, je ne tiens pas à me risquer à franchir la petite barrière qui matérialise la frontière turco-syrienne. Je lui explique.
Sûr de lui, il file au bureau de douane, un gabelou qui sommeillait devant la frontière me fait signe de passer. C’est ainsi que, Puce et moi entrons pour la première fois, officieusement, en Syrie. Une demi-heure après, je me retrouvais dans le village de Salama, en famille. La famille, c’est mon petit copain, son père, un grand escogriffe maigre et sec, sa mère, plus petite, plus enveloppée, plus bavarde, surtout, et ses deux sœurs, fines, élégantes, de délicieuses biches fuyantes du regard…
Très difficile au début de converser en Arabie parce que nous n’avons pas l’habitude des silences. Dès que notre vis-à-vis arrête de parler, nous nous croyons obligés de boucher le trou. Eux, non.
Un silence de dix minutes dans une conversation ne les dérange en aucune sorte. Aussi, souvent, je me retrouvais comme un gland, tenté de sortir un équivalent du « and hummmmmmm » des Anglais, qui ne débouche sur rien.
De plus, les Arabes ne répugnent en rien à s’engueuler devant témoin. Apparemment, on est vite admis dans la famille, pour le meilleur et pour le pire.
Lorsque monsieur et madame commencèrent à se crêper le chignon, j'étais dans mes petites bottes… Gêné !
Mes hôtes font bientôt venir un voisin anglophone, avec qui je me livre à des échanges pédagogiques. Il est heureux comme tout d’entendre quelqu’un qui parle à peu près potablement le british, et ça me repose de ne plus avoir à déraper dans les virages difficiles de la langue arabe, surtout que l’arabe de mes hôtes n’a pas l’air d’être tout à fait le même que celui de mon bouquin.
Les dialectes du Moyen Orient, c’est un peu comme l’allemand de Suisse, différent d’un canton à l’autre. La lecture de son manuel d’anglais me fait tordre de rire. Ensuite, ce sont les cours de prononciation. Il m’écrase avec « Moustahil » (peut-être) dont le « h » est une spirante laryngale sourde qui fait le malheur de tous les arabisants débutants de l’occident.
Je me venge avec « Miss Ffyfth », le nom de la gouvernante galloise des enfants du major Thompson, et « Red Rolls Royces are rarer than red Ferraris », petit tord-langue que j’ai inventé pour inculquer le R anglais à mes petits Romains il y a … un peu plus d’une semaine, il me semble déjà que ça fait une éternité. C’est déjà loin, Rome…
A l’heure du diner, on pose à terre un très grand plat métallique garni d’un assortiment complet de légumes, et de pain syrien. Le pain syrien, c’est une sorte de crêpe très épaisse. J’attendais de voir mes hôtes commencer à se débrouiller avec ça, mais eux attendaient de toute évidence que leur invité-moi- prenne la première bouchée.
Or à l’horizon pas une assiette, pas une fourchette, rien. Je n’allais tout de même pas faire comme au collège les jours d’Anarchie : toute la tablée se mettait les mains derrière le dos puis quelqu’un scandait : anarrrrr…chie ! Sur cette dernière syllabe, tout le monde se jetait sur la bouffe à pleines mains, le moins cradaud était celui qui mangeait le moins.
Après réflexion, j’attrape un morceau de pain, et, m’en servant comme d’une cuillère, je chope quelques pois chiches.
Aussitôt mes hôtes se mettent en route à leur tour, et je comprends comment on procède: on prend un morceau de pain (ou plutôt de crêpe) que l'on plie en deux pour prendre de la mangeaille comme avec une pince. Il n'est pas du tout obligatoire de manger le pain à chaque fois. Il est là bas à la fois nourriture et couvert.
Lorsque vient le moment de dormir, mes hôtes commencent, dans la grande pièce où nous sommes, à déplier des nattes à même le sol. Au bout de la salle à manger devenue chambre, il y a un très haut et vaste lit à deux places. On me le désigne, "tfaddal", s'il te plait.
J'essaie d'expliquer que je n'ai pas besoin de ce grand lit, qu'une natte me suffit. Rien à faire. Je dormirai dans le seul et grand lit, pendant que les maîtres de maison coucheront sur des nattes, par terre...
Le lendemain matin, vers dix heures, je retourne au poste de douane. La réponse de Damas n'est pas encore arrivée, il faut attendre encore un peu.
Pour m'occuper-ah, ces occidentaux stakhanovistes- je me mets à régler mon avance à l'allumage, sous le regard curieux des douaniers.
J'ai à peine terminé mon réglage qu'un autochtone vient me voir avec son 50 cc KTM autrichien. Je n'en avais encore jamais vu. C'est un cyclo utilitaire à cinq vitesses et cadre poutre en tôle emboutie, avec une esthétique un peu wagnérienne style années 50.
Il le démarre devant moi avec une mimique désolée. Son engin a un ralenti à 5000 tours. Je ressors mes outils, un coup de tournevis à la vis de butée de boisseau, un coup à la vis d'air et voilà mon KTM avec un ralenti honnête.
Le propriétaire est heureux comme un pape et me propose en récompense d'essayer sa bête. Oh misère, j'ai cru mourir! Plus que quatre vitesses sur cinq, un embrayage qui entraîne comme ce n'est pas permis, je manque de me ratatiner dans le premier virage la...chose n'a pas, mais pas du tout de frein avant, et un frein arrière sur lequel il faut se mettre debout pour ralentir un tout, un tout petit peu. Je rends le KTM avec une mimique évasive, et le proprio repart.
Arrive un second client, avec cette fois un Simson. C'est un engin d'Allemagne de l'Est qui, il y a trois ans, faillit être importé en France. Un petit deux-temps 50 cc trois vitesses, avec un refroidissement par turbine. Laid à faire peur, mais paraît-il solide comme la grande muraille de Chine.
C'est le 50 cc le plus courant en Syrie, normal puisqu'il vient d'Allemagne démocratique et que la Syrie est sous régime néo-socialiste. Le Simson ne marche plus. Son pilote est vraiment désolé car il allait à Adana en Turquie, et qu'il se retrouve comme un gland avec son engin muet. Démontage de bougie, pas d'allumage. A grand-peine, je démonte le carter de turbine pour voir le rupteur d'allumage. Dio cane!
Imaginez une prémolaire de grand-mère de 275 ans, c'est à ça que ressemble le rupteur de la pauvre Simson. En jouant à fond sur le réglage, j'arrive à obtenir que le malheureux moignon de rupteur s'ouvre tout de même un peu. Cela fait, l'étincelle à la bougie est réellement minuscule, mais présente.
Vaillamment, le petit engin repart à la poussette. Son proprio enquille aussitôt la route de la Turquie, je lui signale qu'il faut d'urgence changer son rupteur, il dit oui et s'en va. Bien sûr qu'il ne le fera pas, à quoi bon, puisque ça marche.
Je suis déjà en train d'envisager l'installation d'une boutique de réparation à Salama, lorsque le douanier me hèle: mon visa est accordé, je vais pouvoir franchir la frontière.
Le temps de souscrire une assurance, de faire viser mon carnet de passage en douane, je peux enfin franchir de plein droit la frontière syrienne. Un nouveau monde qui doit être assez extraordinaire, si j'en juge par mes premières vingt-quatre heures en Syrie... Allez, roule...
Mon premier contact avec la route en Syrie est une petite déception. Puce et moi, on s'était entraîné à bien lire les caractères arabes. Jusqu'à 680 mètres par temps de brouillard, on pouvait distinguer sans l'ombre d'une hésitation un Fa d'un Waw, un Ta d'un Ya, un Kaf d'un Lam, bref en passant à 200 à l'heure par beau temps, on aurait pu lire le Coran dans le texte. Hélas! la plupart des panneaux sur les routes principales sont sous-titrées en caractères européens.
En parlant de signalisation, en Arabie, elle n'est pas basée sur la même philosophie qu'en Europe. L’Européen est un perpétuel inquiet, mais l'Arabe, lui, est d'un naturel plus serein.
Aussi, lorsque vous suivez une grande route européenne, vous trouvez, au moins tous les 20-30 kilomètres, même si la route est droite et sans carrefour important, des panneaux qui vous confirment que vous êtes bien sur la route de Paris ou de Pampelune. En Arabie, à quelques exceptions près, il n’y a des indications que lorsqu’elles sont vraiment nécessaires. Si vous suivez une grande route, vous pouvez faire deux cents kilomètres sans voir quoi que ce soit confirmant sa destination. Ceux que vous verrez indiquent où vous allez si vous quittez la route principale, mais où va la principale n’est plus indiqué. Il ne faut pas se tromper au départ et ensuite suivre la route, sans se démoraliser. Les carnets de route de rallyes appellent ça « TDSRP », en clair « tout droit sur route principale ».
De même en ville, les panneaux peuvent être très éloignés les uns des autres. On peut traverser dix carrefours sans voir de panneaux de rappel. Cela signifie, tout simplement, qu’il faut aller TDSRP. Les Arabes qui viennent en Europe doivent se dire que nous mettons un nombre incroyable de panneaux indicateurs inutiles, et ils ont raison. Cela doit venir d’un tempérament inquiet. Cependant, avant d’avoir pris l’habitude, que d’angoisses avons-nous connues, Puce et moi !
Voilà Halab-Alep- notre première grande ville syrienne. Nous y entrons par ce que nous croyons être un faubourg, un enchevêtrement de petites et moyennes rues. Nous croyons bêtement, Puce et moi, que toutes les grandes villes sont faites de boulevards Haussmanesques tracés au cordeau.
Des grands axes de ce tonneau, nous en verrons à Damas, mais Alep ressemble à un village très, très étendu. C’est peut-être pour cela que les touristes, nous compris, ont une attirance toute spéciale pour elle. Un peu intimidé, tenant Puce par la main, because sens interdit, je suis entré dans Alep, avec comme premier objectif de casser une petite dalle et regarder les gens passer.
Tout au long de la rue où se trouve notre restau, la rue Baron, il y a des stations de taxis. A peu près tous les taxis récents sont des grosses Dodge six cylindres jaunes, modèle uniforme et standard, mais personnalisé par chaque propriétaire : galerie de toit à arabesques, pare-pierres chromé, bavettes à falbalas, ce ne sont plus des voitures américaines banales, mais des automobiles orientales, dans toute la ville il n’en est peut-être pas deux pareilles.
Pour une poignée de cerises, ces automobiles vont emmènent au bout du monde. Quarante balles par exemple pour Alep-Damas, près de quatre cents bornes. Comment arriver à de tels prix avec une essence qui coûte tout de même plus de soixante centimes (!!!) le litre ? Le sens pratique : le chauffeur du taxi se met devant sa voiture et crie sa destination. On vient, on discute prix, on fait asseoir le premier client et l’on recommence. On ne part que lorsque la voiture est pleine… dans une Dodge, ça fait le chauffeur et cinq clients… Puce et moi passons une partie de l’après-midi à regarder les gens dans la rue, à écouter les taxis s’égosiller « Ech Cham ! Ech Cham ! » (Damas ! Damas !) ou « Béérouuut ! Béérouuut ! ». j’imagine un instant des taxis parisiens, sur les Champs-Elysées, en train de crier « Lyooon ! Lyooon ! », « Marseiiille ! Marseiiille ! ».
Qui, en France, fait Paris-Lyon en taxi ? C’est bien trop cher, quoique bien sûr bien trop cher divisé par cinq, ça ne fait guère que pas bien cher par tête, mais est-ce que cinq Français qui ne se connaissent pas accepteraient de prendre le même taxi ? De toutes façons, il doit bien exister un truc syndical qui interdit ça chez nous…
Mon idée de taxis collectifs sur Les Champs-Élysées me fait rigoler. Deux gars qui passent à ce moment dans la rue me regardent rire tout seul, rient aussi, et me demandent d’où je viens.
Il se trouve qu’ils sont étudiants en français à l’université d’Alep. Un heure après, je me retrouve chez eux, où je passerai d’ailleurs la nuit suivante. Après une longue soirée où la conversation passera sans complexe de la réalité ou non réalité de Jésus en tant que fils de Dieu –Jésus, pour les musulmans, n’était qu’un prophète- à la regrettable disparition du plus vieux quartier d’Alep, où l’on trouvait, comme on dit, « les femmes dans leur maison ».
Le lendemain matin, Puce et moi décidons de nous mettre en quête de bougies de rechange. Le Simson que j’ai rafistolé la veille à Salama avait une Bosch 260 T1, ce qui me fait penser dans ma grande science du raisonnement, que l’on trouve ces animaux-là en Syrie. Mes deux amis me guident vers le quartier des mécaniciens. Comme chez nous au bon vieux temps, chaque corps de métier est regroupé dans une zone bien précise de la ville.
Le quartier des mécaniciens est particulièrement folklorique : dans les boutiques, mais surtout sur les trottoirs, on trouve des motos, des morceaux de motos, des châssis de voitures, ou de camions, des moteurs démontés ; depuis le Simson le plus rudimentaire jusqu’au diesel à soixante-douze cylindres en X turbo-compressé, tout se fait désosser sans manières, partout, dans tous les coins, avec insouciance et bonne humeur, et pourtant les véhicules marchent en Syrie, j’en ai vu rouler !
De boutique en échoppe, en atelier, je me promène, mon tableau d’équivalence thermique de bougies sous le bras, autant pour visiter que pour trouver mes bougies. En fin de matinée, je trimballe dans mes poches des bougies d’origine pour la Puce, mais continue à faire les boutiques, pour le plaisir.
Les Syriens n’ont pas l’air partisans de la diversité des modèles en matière de motos plus que d’autos, ce qui leur permet, au moins, de ne pas être emmouscaillés avec des stocks de pièces détachées. Chaque proprio personnalise son engin : sacoches multicolores, pare-jambes avant et arrière, porte-bagages en tous genres, le tout non pas d’une rigueur toute fonctionnelle, mais réalisé, tout en courbes, en arabesques, oriental quoà… Côté grosses cylindrées, on ne voit guère que des BSA des années cinquante, transfigurées dans leur parure régionale.
En début d’après-midi, Puce et moi quittons Alep, décidés à nous y arrêter plus longtemps au retour. Damas et, au-delà, la mer Rouge nous attendent. La route est facile, mais nous n’irons pas loin. Deux cents bornes tout au plus parce que la Syrie est la Syrie el hamd Allah…
Le premier plein d’essence en Syrie. Ah, le premier plein en Syrie…
Évidemment, le réservoir de Puce est minuscule, et sa consommation dérisoire, mais j’ai failli mourir de rire en lisant le prix sur le volucompteur : 2 livres quarante, soit, grosso moto, deux francs soixante !
Du coup, je sors toute ma petite monnaie, et paie mon plein avec une brouettée de petites pièces en cuivre.
Le pompiste sourit et, d’un geste large, m’indique le bureau de la station-service où un employé me sert le thé. Au thé succède un Coca Cola offert aussi par la maison. J’en suis à me demander comment un pompiste peut arriver à faire du bénéfice en offrant le thé et le Coca à un client qui achète péniblement trois balles de tisane.
A ce moment, le patron de la station vient me voir, avec à la main toute la mitraille avec laquelle j’ai payé mon plein. L’air gêné, il me demande : « as-tu de l’argent ? ». Tout de même un peu méfiant, je réponds : « oui, pourquoi ? ».
Dans sa main ouverte, il montre ma cuivraille. « Tu sais, si tu es mfalles, fauché, tu peux garder ton argent, ma léch, c’est pas grave ». j’en suis resté baba. C’est tout de même la première fois, où que ce soit, qu’un pompiste me paie deux pots et me propose ensuite de ne pas payer si ça me gêne.
Je le prends par les épaules en rigolant et lui dis sur un ton déclamatoire « motori sriré, laken, maliti kbiré ktir », (ma moto est petite mais ma fortune est grande).
Nous voilà tous les deux partis à rire comme des sacs de noix, et nous boirons encore le thé avant que je reprenne la route. Je crois qu’au long de mes deux passages en Syrie, j’aurais bu autant de thé que Puce a consommé d’essence.
En milieu d’après-midi, nous arrivons à Homs, qui sera la fin prématurée de notre étape : le fils d’un marchand de pneus de Homs, après m’avoir offert le thé, le Coca, le repas, nous supplie, Puce et moi, de passer la soirée et la nuit à Homs.
« A quoi bon arriver à Damas dans la soirée ? En partant tôt demain matin, vous y serez à dix heures. S’il vous plait, restez à Homs ! ».
Nous restons. De la mosquée au grand barrage, en passant par le casino et la vieille cité romaine, nous avons vu Homs. A deux heures du matin, nous étions encore toute une bande de copains, bavardant comme la veille à Alep, de tout, y compris de religion, car la discussion théologique semble ici être un sport national.
Le lendemain matin, un peu embrumés, Puce et moi prenons la route de Damas. Nous ne sommes pas encore habitués à la signalisation syrienne, Puce me conseille de demander notre chemin, mais quelque chose me bloque : je ne sais pas dire « route » en arabe mais seulement « tari’ », chemin.
Or je me dis que si demande à quelqu’un le chemin de Damas, on va me rire au nez. Alors on cafouille un peu, une grande route se présente, nous la prenons en nous disant qu’une si belle route ne peut aller qu’à Damas. Cent vingt kilomètres plus loin, toujours pas de panneau indiquant où va notre route, mais seulement où nous allons si nous la quittons.
Soudain, une sorte de gare routière, puis un guichet. Un petit garçon arrive à toutes jambes en me demandant : « Triptyque, triptyque ».
Ya allah ! Diem perdidi, foin de Damas et de ses lumières, on est à la frontière libanaise !!!
Pouagre, protz et schniaque ! Je regrette vraiment de ne pas encore savoir jurer en arabe. Nos langues européennes comportent beaucoup trop de voyelles, or chacun sait que ce sont les consonnes qui donnent de la puissance aux mots. Un bon juron doit comporter un maximum de consonnes ; les spirantes , chuintantes et occlusives doivent être particulièrement recherchées, car leur prononciation demande un effort physique.
Essayez de dire « O pâle Ophélia, belle comme la neige » sans escamoter les E un jour où vous serez très en colère, ça ne vous satisfera pas. Dites par contre « Crispe ses doigts sur son fémur qui craque avec des cris pareils à des ricanements », vous serez beaucoup plus satisfaits. La langue arabe n’a que trois voyelles, mais est riche en occlusives, spirantes, chuintantes, sifflantes, consonnes qui réclament du souffle et de l’énergie. C’est une langue d’hommes, bien adaptée aux jurons.
Gesticulant, assis sur Puce qui fait le gros dos, je cherche les jurons les plus riches en occlusives pour me calmer les nerfs.
« Putain de bordel de cul de couille de con » est à ce titre assez intéressant, mais je l’avoue, ne me satisfaisait pas sur le moment. Je finis par recouvrer un semblant de calme, et la lecture de la carte m’apprit que je ne m’étais pas trompé de beaucoup.
A vol d’oiseau, je n’étais pas très loin de Damas. Seulement, il n’y a pas beaucoup de routes en Syrie, et la seule solution est de retourner à Homs et repartir vers Damas. Sept heures de route pour rien, tout cela parce qu’une stupide histoire judéo-chrétienne prétend que l’on peut trouver seul le chemin de Damas.
Revenu à Homs, je me décide à demander à un passant « wén ech cham », (où est Damas ?). Le brave homme me regarde et reprend « Tu veux le chemin de Damas ? ». Je lui dis oui en rigolant, il n’a pas l’air de comprendre en quoi c’est amusant. J’ai envie de lui dire « tu ne peux pas comprendre, c’est de l’humour catho » mais à quoi bon, et me voilà cette fois sur le vrai chemin de Damas. Ce n’est que vers cinq heures du soir que Puce et moi entrons finalement dans Damas.
Damas est une grande ville avec de grandes avenues, on a moins envie d’y musarder qu’à Alep. Notre erreur de cap de ce matin va nous coûter deux jours de retard : c’est aujourd’hui jeudi, et le vendredi est férié en pays musulman. Toutes les administrations et toutes les boutiques tenues par de bons musulmans seront fermées, donc pas de visa pour la Jordanie avant samedi, si Dieu veut.
Le lendemain, donc, Puce et moi partons au hasard des rues, nous attendant à les trouver désertes. Mais non ! Une multitude de marchands à la sauvette, profitant de ce que les boutiques sont fermées, installent leur petit commerce sur le trottoir. Les rues commerçantes deviennent un marché aux puces, on y trouve des livres, des fringues d’occasion, des babioles, de vieilles photos de films qui me permettent de voir que Louis de Funès est très populaire en Syrie, des choses, des machins…
Au hasard, je rencontre un quidam francophone –c’est assez courant en Syrie- qui me demande si je n’ai rien à vendre ou à échanger.
Si j’ai du matériel en surplus, pensez ! C’est mon premier grand voyage, et ayant accompli les neuf dixièmes de mon parcours aller, vous pensez que j’avais eu le temps de réaliser que j’avais emmené pas mal de choses inutiles, ou dont j’avais tout simplement la flemme de me servir.
Le gars m’emmène chez lui, m’offre le thé, et nous commençons l’un et l’autre à mettre sur la table nos objets en surplus. Pièce par pièce, nous négocions les échanges. Ceci contre cela…
Ah, non ! En France, ça vaut au moins tant ! Je mens, il le sait aussi bien que moi, mais il fait semblant de sembler me croire et exagère aussi de 300% la valeur de ce qu’il m’offre en échange. Je fais aussi presque semblant de croire aux prix qu’il m’annonce.
Tout en nous livrant à nos tractations, nous discutons de nos pays et de nos religions, en fait je n’ai pas de religion, mais ici on aime tant en parler que je me suis improvisé catholique convaincu et défends de mon mieux la Sainte Trinité, de la vie à Paris, à Damas, du sexe des anges, et nous buvons du thé.
Arrive l’heure du dîner, mon partenaire commercial m’invite, bien entendu. Je suis tout étonné, non qu’il m’invite, mais de découvrir que pour la première fois de ma vie j’ai plaisir à faire du commerce, parce que j’ai l’impression qu’ici, échanger une montre très quelconque contre un poignard bédouin tout aussi quelconque, du moins quand on se trouve à Damas, est en fait un prétexte à bavarder des heures devant une tasse de thé.
A une heure du matin, lorsque je quitte la maison de mon ami, je n’ai plus de montre, plus de pied d’appareil photo, plus de beaucoup de choses, mais je transporte dans un sac plein d’autres choses à la place, et j’ai appris autant de choses sur la Syrie que mon ami en a appris sur l’Europe…
Samedi après-midi, après une nouvelle balade et un passage au consulat du Royaume hachémite de Jordanie, Puce et moi prenons la route d’Amman, qui n’est qu’à 220 km, un demi-saut de Puce à peine. Nous y arrivons en pleine nuit.
Il est assez dangereux de rouler la nuit en Arabie, car les obstacles sont assez nombreux sur les routes. Les camions en panne sont laissés sur place pendant que le chauffeur s’en va chercher des pièces détachées, puis si possible réparés sur le tas.
La nuit, ils sont là, sans éclairage, simplement signalés par une rangée de grosses pierres. Il y a aussi beaucoup de petits ou de gros animaux, tout à fait capables d’envoyer une Puce au tapis. Cela dit, les camionneurs du Moyen Orient sont étonnamment nyctalopes, et roulent très souvent en veilleuses. Or, ils rajoutent un peu partout sur leur camion, sur la cabine, le pare-pierres, des lumières de toutes les couleurs. On a l’impression de croiser des arbres de Noël. C’est magique.
Lorsqu’un chauffeur local voit un véhicule, au loin, arrêté sur le bord de la route, il donne un grand coup de klaxon. Si le conducteur arrêté est en difficulté, il le signale en balançant le bras de haut en bas, paume tournée vers le sol, ce qui signifie « arrête-toi s’il te plait » (ce geste sert aussi à faire de l’auto-stop). Un autre geste plus précis est employé ; bras tendu à l’horizontale, main à plat et doigts écartés, on fait pivoter rapidement le poignet. Cela signifie « je suis en panne ». Si vous faites ce geste, le collègue s’arrêtera toujours. Si vous ne faites aucun geste, il en déduira que grâce à Dieu tout va bien, et passera son chemin sans ralentir.
Si nous arrivons à Amman en pleine nuit, c’est que sur la route de Damas à Amman, on a trouvé Jerash. Une ancienne cité romaine. Comment ? Après être passé à Rome, on avait encore envie de voir une cité romaine ?
C’est qu’en Italie, en Grèce, les antiquailles sont clôturées, guichetées, étiquetées, marchandecartepostalisées et tout ça émousse un peu le choc de les découvrir.
Nous avons trouvé Jerash déserte, mais vraiment déserte, en pleine nature, sans guichets, ni clôture…
Nous y entrons sur la pointe des pneus, et tournons autour des maisons, des temples, sans que personne n’y trouve rien à dire, pour la bonne raison qu’il n’y a personne.
Nous avions l’impression non d’être en train de visiter une antiquaille, mais d’entrer dans une ville dont les habitants auraient tout juste fui à cause d’une mystérieuse épidémie… A moins que ce soit notre arrivée qui les ait effrayés ?
Il n’y avait qu’à rester là sans bouger, allongé sur le sable. Les fantômes sont comme les chats, ils s’enfuient dès qu’ils voient bouger quelque chose d’inconnu, mais si l’on reste immobile, ils finissent toujours par revenir.
Nous avons attendu jusqu’à la nuit noire. « Ils » ne sont pas revenus. Méfiants, « ils » ont attendu de nous voir disparaître au loin…
Arrivés à Amman en pleine nuit, le premier hôtel d’aspect bon marché qui se présente est le bon. Demain, ce sera la descente vers notre sixième mer, la mer Morte.
Allah… Nous allons vers le point le plus bas des terres émergées de notre bonne vieille planète. La route qui y mène descend à n’en plus finir, c’est fantastique de se mettre au point mort, de couper le moteur et de rouler comme poussé par la main de Dieu, en passant les virages le plus vite possible pour conserver son élan afin que le Miséricordieux n’ait pas à pousser trop souvent.
De proche en proche, il y a des contrôles militaires, car cette route mène à Israël la maudite. Pas d’arrêt intempestif, pas de photos, l’armée est partout sur le qui-vive…
La mer Morte, si elle ne paie guère de mine, est vraiment ma mer. Il est vrai que je nage à peine mieux qu’une enclume, et que je grelotte dès que mon environnement descend en dessous de 28° C.
Quand d’aventure –c’est extrêmement rare- je vais monter mes meules à Neptune, je fais ça au crépuscule pour atténuer le choc thermique. C’est donc au coucher de soleil que j’avance vers la mer qui parait-il vous porte. Ouaille ! Si je l’ai, le choc thermique, cette eau est brûlante ! J’avance, j’avance, diable le fond est plein de trucs glissants… Miracle ! J’ai à peine de l’eau jusqu’aux épaules, et mes pieds décollent du fond, je marche dans le vide, je suis Jésus !
Pas commode d’essayer de nager pour de bon, par contre : je n’arrive pas à garder en même temps les bras et les jambes dans l’eau, mais qui veut nager ? je me mets en boule et me laisse flotter comme un ballon de plage dégonflé. C’est super. Dans cette espèce de liquide à peu près à la température du corps, qui me porte sans me tenir nulle part, je me sens comme doit se sentir un fœtus dans le ventre maternel.
Laisse-toi aller, petit : la mer Morte, c’est la mer-mère…
Être un fœtus me plait tant qu’il fait nuit noire quand je me décide à renaître. Il fait tellement sombre que je ne retrouve pas mes frusques. Je vais emprunter une lampe à pétrole à des autochtones qui sont en train de préparer un méchoui sur la plage. Lorsque je la rapporte, bien sûr, « tfaddal » ils m’invitent à partager leur repas. Puis je passe la nuit contre les roues de Puce, qui savoure sa sixième mer.
Au matin, retour à Amman, que nous traversons comme une flèche. Ce que nous voulons maintenant, c’est prendre la route du désert, qui finit à Akaba, au bord de la mer Rouge. Au bout de cette route, nous aurons vu sept mers…
La Desert Highway n’a pas volé son nom : elle est toute droite, à gauche le désert, à droite le désert aussi, à perte de vue. Il fait chaud, très chaud. Tout va très bien tant que l’on roule, mais le soleil guette, et si vous vous arrêtez, il vous saute d’un coup sur les épaules comme un écolier facétieux. Vous vous sentez bien vite très, très fatigué. Qui s’arrêterait, de toutes façons, ailleurs que dans une station-service, où il y a du thé brûlant à boire dans une cabane en bois? Deux petits verres de thé et la soif s’en est allée.
A mi-chemin de la mer rouge, Petra. Une cité nabatéenne taillée dans la masse de la falaise. Le grand truc, parait-il. En fait, ce doit l’être, il y a des grilles, des guichets, même un hôtel moderne à l’entrée du site. Holà. Un hôtel moderne près d’un site touristique, c’est probablement pas pour nous, ça… On verra…
Petra, c’est vraiment le troglodytisme puissance N. C’est vrai, creuser la roche pour s’y faire une niche, c’est si peu sorcier qu’on a eu ça même chez nous, même que ça se pratique encore nonobstant que c’est devenu un peu snob, mais penser qu’avant Obélix et Astérix, alors que le toit de chaume était le summum de la haute technologie gauloise, des gars étaient capables de tailler dans la masse d’une falaise une cité, avec toutes les colonnades, bas reliefs et autres gadgets à la mode à l’époque, ça vous coud un peu les nouilles. Que sont devenus les peuples qui étaient capables de faire ça il y a deux mille ans ?
Il y a des bornes à faire à pied pour visiter Petra. On n’y autorise pas les véhicules à moteur, il y a bien des guides qui vous proposent de vous emmener à dos de mulet, de cheval ou de dromadaire, mais j’ai répugnance à chevaucher quoi que ce soit qui n’ait un moteur ou au moins des pédales. Il est vrai que la seule fois où j’ai voulu chevaucher un animal, c’était une vache, qui paraissait à mes yeux de gamin de onze ans bien plus pratique qu’un cheval, vu qu’elle comporte un guidon pour se tenir, hélas elle n’a pas trouvé ça drôle du tout…
Enfin il fait nuit lorsque l’on sort de la cité de Petra.
Il y a deux guides en train de ranger leur attirail devant l’hôtel touristique, je leur demande s’il y a à proximité un autre hôtel rhis, yaani (littéralement pas cher, c’est-à-dire), oh non, c’est le seul, le prochain est à Maan, cinquante kilomètres, mais celui-ci n’est pas bien cher. C’est une chance. Double-chance en fait, mais je ne le sais pas encore.
Bizarre… je suis dans mon lit d’hôtel à Petra, et j’entends au loin des dizaines de voix qui scandent une sorte de mélopée très courte, sans cesse reprise. C’est à la fois fascinant et inquiétant, à croire qu’un cinéma est en train de jouer en boucle une scène de folklore bédouin de Lawrence d’Arabie. Y’a tout de même pas de cinéma dans cet hôtel…
Si c’était pour de vrai ? Mais… je n’ai pas vu de village autour de Petra… Serait-ce des Bédouins ayant planté le camp pendant la nuit ?
Le lendemain matin, je suis en train de petit-déjeuner, je vois arriver sur un cheval noir, un bédouin magnifique. Grand, mince, avec sa djellabah claire et sa keffieh blanche, il a carrément l’air d’un seigneur.
Surprise, c’est à moi qu’il vient s’adresser, dans un excellent anglais britannique.
- « C’est à vous la moto bleue ? Voudriez-vous la vendre ? ».
Je devrais dire oui, la logique voudrait du moins que je dise oui, ou au moins « peut-être ».
J’ai mis à peu près deux semaines à arriver où je suis. J’ai un mois de vacances, ce serait donc idiot, arrivé à la mer Rouge, de faire demi-tour et refaire le chemin dans l’autre sens. J’ai donc décidé de rester au Moyen Orient jusqu’au dernier moment et de me rapatrier par avion avec la Puce de Damas ou Alep à Paris.
Bien que la petite Puce ne pèse que 75 kg, ça n’est pas économique, ça m’obligera à radiner un peu sur tout dans les quinze jours qui restent. Si je vends la Puce, je palpe une somme ici considérable, j’économise les frais de rapatriement de la moto, pour les quinze jours qui restent, je suis riche comme jamais, oui, mais…
- « Ce n’est pas possible, pour pouvoir venir jusqu’ici avec cette moto, j’ai dû déposer l’équivalent de sa valeur pour avoir un carnet de passages en douane. Si je reviens sans la moto, je ne récupérerai jamais cet argent ».
- « Ne vous inquiétez pas, je peux vous obtenir un certificat de la police disant que la moto a été accidentée et détruite ! »
Ahum… Maintenant il faut que je sache ce que je veux.
- « Si je voulais acheter votre cheval, me le vendriez-vous ?
- Yaaaani… Non, je ne crois pas…
- Eh bien ma moto, pour moi, c’est la même chose.
- Je comprends. Voudriez-vous venir dîner chez moi ce soir ? »
Le soir même, le Moto Club de Wadi Moussa était né. C’est que je n’avais pas rêvé, les mélopées de la nuit précédente, elles venaient de Wadi Moussa, un petit village caché au dessus de la falaise de Petra. C’est la période des mariages, d’où ces fêtes la nuit.
Mon nouveau copain Mohamed Issa Falahat est l’un des deux habitants du village à posséder une moto, une 250 Yamaha DT1, l’autre étant son ami Ahmad qui a une 650 BSA « A 65 ». Nous célébrons donc la création du Moto Club de Wadi Moussa d’une cérémonieuse poignée de main. Ensuite, c’est la longue et apparemment indispensable discussion théologique dans laquelle, entre autres, je fais mon devoir d’occidental en défendant la Sainte Trinité. Enfin, sujet libre jusqu’à très tard dans la nuit. Puis on m’installe dans le meilleur lit : je suis devenu citoyen honoraire du village de Wadi Moussa.
Ce n'est que le lendemain que je découvre vraiment le village. Dans le paysage lunaire qui l’environne, ce village est un petit miracle, tout simplement parce que, comme son nom l’indique, il possède un oued, oh ce n’est ni le Nil, ni la Loire, ni la Durance, un ruisseau bien modeste, mais qui permet de faire pousser des tomates et quelques légumes et fruits en plein désert, d’où l’existence du village et, par le passé, de la cité troglodytique de Petra, qui en fait est sous nos pieds…
Mohamed s’en va à cheval exercer son métier de guide touristique, et me laisse sa maison au village. C’est magique : hier, j’étais un touriste à Petra, aujourd’hui je suis de l’autre côté du miroir, grâce à ma petite moto magique que je ne veux pas vendre.
En marchand jusqu’à la crête de la falaise, je peux observer les touristes dans la vallée, en contrebas. Soupçonnent-ils qu’il y a au dessus de leur tête un village caché d’où viennent les guides qui les accompagnent, les gamins qui leur vendent de l’eau ou du soda, un vrai village où les gens se marient, des enfants naissent, et où il y a même un moto-club ?
Un ancien qui parle assez bien l’anglais, essaie de civiliser mon arabe. C’est que « parler arabe » ne veut rien dire, il y a tant d’arabes différents, ce serait comme dire « il parle latin » d’un gars qui s’exprime en espagnol, en roumain ou même en patois bas-normand. Oui, des mots sont effectivement dérivés du latin, mais ça n’est plus du latin, essayez de parler latin à ce malheureux (et en plus quel latin et avec quel accent ? Celui de Paul 6 ou de l’école française moderne ?) si ce n’est un prof de latin ou un prêtre intégriste, il restera aussi sec que si vous parliez Tagalog.
C’est pareil avec l’arabe. L’arabe reconnu comme le vrai de vrai est celui du Coran, donc en principe celui que parlaient les Qoréïch, la tribu des poètes, il y a bientôt quatorze cents ans, là où est aujourd’hui l’Arabie Saoudite. Le reste n’est que dialecte ! Autant, nous, latins arborons nos dialectes bas-latins comme langues française, italienne, portugaise, espagnole, autant il n’y a pas de langue égyptienne, ni jordanienne, ni libanaise, ni rien. Ce sont des dialectes arabes. Celui que j’ai étudié est à la base du syrien de Damas, à priori compréhensible jusqu’au Liban, la Jordanie et l’Irak.
Mais ici, dans le sud de la Jordanie, près de l’Arabie Saoudite, mon dialecte est jugé très, très vulgaire. Il faudrait peut-être que je me mette à l’Arabe Moderne Unifié que l’on entend à la télé ou à la radio, comme ça je passerais pour très, très snob. Et zutre ! On ne peut pas apprendre tous les dialectes du Moyen Orient pour partir en vacances !
Bon sang le temps passe… Cela fait trois jours que je suis à Wadi Moussa, à ne rien faire de précis, enfin j’ai appris à jouer au tcheddé, un jeu de cartes assez marrant, je regarde le désert en fumant une Gold Star jordanienne arrivée en contrebande d’Arabie Saoudite où elles sont vendues sans taxes.
Un gamin qui repéré un nouveau fumeur dans le village vient m’en proposer tous les jours, je suis un gros client, j’achète par paquets entiers. C’est qu’ici même les kiosques à tabac vendent les cigarettes par paquet ou à l’unité. Si tu demandes à la française « une Gold Star », c’est pas un paquet que l’on va te tendre, c’est une cigarette…
Acheter ses cigarettes une par une, comme Mohamed mon hôte qui a pourtant largement les moyens de les acheter vingt par vingt –pour être possesseur d’une moto et parler couramment anglais, ici, il ne faut pas être né dans une grange- ridicule, hein ? Que de temps perdu !
Ben, finalement, ça n’est peut-être pas si bête : au lieu de sortir vite fait son paquet de sa poche et en allumer une plus par habitude qu’autre chose, il faut attendre d’en avoir suffisamment envie pour se décider à marcher jusqu’au kiosque –il y en a partout, sans compter les marchands à la sauvette, chercher la monnaie, dire bonjour, demander sa cigarette et du feu. Cela rend la tige de huit nettement plus goûteuse, comme marcher jusqu’à une fontaine rend l’eau plus rafraîchissante…
Puce, ma bécane, bouillonne un peu : il y a deux motos beaucoup plus grosses qu’elle dans le village, et le fait d’être venue d’un lointain pays ne lui apporte guère de prestige : la France, pour le quidam local, ce n’est pas un pays, mais une sorte d’abstraction. Vous imaginez-vous en France vous balader avec une moto bizarre et une immatriculation étrange, et dire au passant qui vous demande d’où vous venez que vous arrivez d’une sorte d’abstraction ? Sûr que le mec s’écrierait « oh la vaaaache !… ».
Je suis bien ici. Y’a rien à voir. Quoi ? J’habite au dessus d’un site archéologique mondialement connu et je dis qu’il n’y rien à voir ? Ben oui, pardonnez-moi d’être un béotien de le vieille pierre, mais passé le premier choc, vraiment… Cela ne me fait guère plus d’effet que la tour Eiffel à qui habite le Champ de Mars. Non; J'aime bien les gens d'ici, le rythme, les silences. On ne parle pas du temps qu'il fait histoire de dire quelque chose. Il est vrai qu'il ne change guère. Je crois que je pourrais vivre ici....
" A quoi faire?" me demande la Puce "Guide touristique? "
" Ah oui, bonne remarque. Si on partait vers la mer Rouge? On pourrait y être au crépuscule...."
Nous revoilà sur la route du désert. A peut-être deux cents bornes d'ici, une fraction de saut de Puce, il y a le golfe d'Aqaba, la mer Rouge.
Dans quelques heures, on y sera, on " aura fait " Paris-mer Rouge et vu sept mers. C'est pas qu'on ait jamais douté que ce fût faisable, ça n'a rien de sorcier, juste rouler sud-est au lieu de tourner en rond comme d'habitude.
Pourquoi avoir fait ça? Pour avoir une opinion autre que celle d'un autre sur une partie du monde qui m'intéresse. pour vérifier une bonne fois l'affirmation de mon papa, qu'à terme, n'importe quelle route peut mener n'importe où, à Ouagadougou ou ailleurs....
La route du désert, toute plate et toute droite devient montagneuse, une montagne pâle, aride, toute en formes shadocques, on la croirait sculptée par un dieu fou, puis, alors que la route commence à redescendre, on prend en pleine poire toute la vallée, blanche comme un squelette et avec des montagnes si usées qu'elles ressemblent à des furoncles, ouah, on se dit "y'a qu'un scorpion pour vivre là dedans". En gaffant bien, on arrive à deviner la mer Rouge tout au bout. Ah, t'es là, toi....

J'imagine la joie de Lawrence d'Arabie, le 5 juillet 1917, voyant ce paysage, après deux mois de voyage dans le désert à dos de dromadaire et moultes batailles, cela signifiait que son expédition avit réussi, que la révolte arabe allait prendre les Turcs à rebrousse poil et les chasser d’Aqaba. Ce serait le début de la fin pour l’Empire Ottoman.
Pour Puce et moi, c’était briser la gangue, réaliser que voyager loin n’est vraiment pas sorcier. Y’a pas besoin d’être grand ni fort ni beau ni riche ni d’avoir une moto à propulsion nucléaire. Dans un rien de temps, on sera au bord de la mer Rouge. Allah est grand.
Flutre… Mal calculé mon parcours, en fait pas calculé du tout, je ne calcule guère, j’tombe jamais juste. Le temps de passer le contrôle de police à l’entrée de la ville, il fait nuit quand nous entrons dans Aqaba. Oh, on n’est pas venu voir la mer rouge dans le noir, la Noire, on a déjà donné en Turquie. Bof, il n’y a qu’à se trouver un hôtel, c’est-à-dire-pas-cher et demain, si Dieu veut, il fera jour.
Pardon ? Il y a une auberge de jeunesse ? Holà… Je n’aime pas trop les auberges de jeunesse, c’est bourré de touristes étrangers, on ne se sent pas chez soi, mais bon, on est dans la seule ville de bord de mer de la Jordanie, il faut d’abord être heureux de trouver une piaule à bon marché.
« Tu veux coucher dehors ou dedans ? »
Question aussi douce qu’étrange à l’oreille d’un Parisien. Ya Allah, c’est que nous sommes par la grâce de dieu à 6 ou 700 bornes du tropique du cancer, vous rendez vous compte ? C’est juste un saut de Puce. De Puce d’eau en fait. La politique étant ce qu’elle est, il faut des magouilles infernales pour atteindre d’ici le tropique, étant donné qu’il passe côté est de la mer Rouge entre Médine et la Mecque en Arabie Saoudite –qui ne donne pas de visas de tourisme- et côté ouest au nord de Halaïb en Egypte du sud, mais pour aller en Égypte d’ici il faudrait passer par Israël, genre de plaisanterie à éviter par les temps qui courent…
On est comme qui dirait dans un ulque de sac. Bah, ma léch, ça fait rien, de toutes façons un tropique, c’est bidon, ça n’existe que sur les cartes, on ne peut pas le voir, le toucher, ni se baigner dedans, alors que la mer Rouge, c’est du vrai, de l’eau tanthique, quand on se trempe le cul dans quelque chose, c’est la preuve qu’elle existe ! Demain, on aura la preuve que le mer Rouge n’existe pas que sur les cartes…
En attendant, on va dormir dehors. La cour est vaste, plantée de palmiers auxquels quelques gars ont accroché des hamacs. Le gardien m’amène un lit de camp, que j’installe sous un palmier, je gare la Puce à côté de mon lit, c’est Byzance, hein ma Puce, dormir à ciel ouvert à trois tours de roues de la mer Rouge. On a gagné, hein ? On ne la pas encore vue, cette mer, mais même si demain tu faisais un caprice, je pourrais te pousser jusqu’à elle. On ne la pas vue, mais elle ne peut plus nous échapper. Il faudrait vraiment la main de Dieu lui-même pour nous empêcher d’y parvenir, et encore…
On a bien fait de ne pas y aller cette nuit, c’est encore meilleur comme ça.
POC…
Quelque chose a fait « poc » sur ma citrouille. Quelque chose qui n’est ni dur, ni lourd. Cela a dû tomber du palmier, ça a des fruits les palmiers ? Ben, forcément, tous les arbres ont des fruits, un arbre sans fruit, c’est comme un mec sans thoeube, ça ne se reproduit pas… Cela doit être un fruit qui ne se mange pas, sinon j’en aurais entendu parler. C’est quand même con pour un arbre de faire des fruits qui ne se mangent pas…
Poc…
Sur le bide cette fois. Merde, il a rebondi et il fait tellement noir que je n’arrive pas à trouver ce putain de fruit… Et si ce n’était pas un palmier ? un cocotier ? Ben, non, une noix de coco, ça fait pas « poc !», ça fait « Bong ! » et tu voix trente-six chandelles.
Bon, pas bouger, le prochain qui me tombe dessus, je le chope. Me voilà immobile mais attentif comme un chat aux aguets. Que le temps parait long. Est-ce qu’un chat aux aguets trouve le temps long, ou ses sens sont-ils si affinés qu’il n’a même pas besoin d’être attentif ?
Poc, entre les jambes. Je le tiens. Un truc de la taille d’une olive, mais plus long, sans queue, très lisse. J’étends le bras pour mettre l’éclairage de Puce sur veilleuse, et présente le truc devant le phare. Ben, c’est un fruit beige pâle, oblong, avec une peau toute lisse et brillante, pas vraiment bandant, ça me rappelle rien de bouffable.
D’un coup, je me rappelle une prof de sciences naturelles qui nous disait que l’on reconnait la famille d’un fruit à son noyau. J’ouvre donc mon fruit de bouzingrin… Merde ! Dedans, il y a un noyau de datte. Oh, sans charre hè, les dattes c’est des fruits sombres hyper-sucrés et vachement collants qui poussent dans des boîtes ovales avec un palmier dessiné dessus… Ou alors… Ya Allah !...
« Puce, tu te rends compte ? On est couché sous un dattier !
-Eh ben alors ? C’est dangereux ?
-Ben non, enfin, je crois pas, moins qu’un cocotier en tout cas.
-Alors, on reste où l’on est ?
-Ouais, ouais, on reste où l’on est »
Quand je m’endors, il y a des boîtes de dattes qui flottent au dessus de moi dans un nuage. Des boîtes sarcophargiformes avec un palmier et « Micasar Ja » imprimés sur le couvercle. Ploc. La vie est une merveille. M’en fous de la mer Rouge… Il pleut des dattes, et çà, c’est pas ordinaire…
Puce et moi avons attendu le lendemain pour aller voir la mer Rouge. Nous nous sommes arrêtés avec la mer juste à nos pieds, et j’ai dit à Puce :
« Je t’ai promis sept mers, je te les ai offertes en plus d’une pluie de dattes. Quelle est donc la vérité première que tu m’as promise à Rome ? ».

Puce laissa d’abord s’installer le silence, puis me révéla sa vérité, que ô lecteur, tu as vue écrite blanc sur noir au fil de cette histoire. Elle est révélée dans le Coran dans une soura qui s’appelle, merveilleuse coïncidence, « le voyage dans la nuit ».
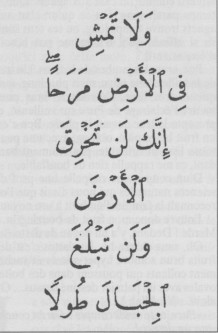
« Ne marche pas orgueilleusement sur la terre, tu ne saurais ni la fendre en deux, ni égaler la hauteur de ses montagnes ».
Dernière édition par cobalt57co le Ven 18 Jan 2013 - 12:43, édité 2 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
De la France à l'Egypte
Monaco, août 1978
Cela fait un bout de temps qu’on ne s’était pas vu, non ? Permettez que je me représente. Pendant trois ans, je fus entre autres dans Moto journal la mauvaise langue de service, le colporteur de ragots. Puis un jour, il y a en gros un an, plus personne, plus rien. Eh bien aujourd’hui, ma revoilà, pour tenter une première : vous raconter une longue histoire en direct, en stéréophonie, et quelquefois même en couleurs.
Bon… Oui… Procédons par ordre : d’abord, quelle histoire ? Voilà : Puce et moi, on a décidé de faire le tour du monde. Holà ! Je vous arrête tout de suite, pas un tour héroïque avec traversée du désert de Gobi sans étape, franchissement de l’océan Pacifique sur un radeau de bambou, je ne suis pas un surhomme aux pectoraux saillants.
Puce n’est ni un dromadaire ni une voiture amphibie, et Moto Journal n’est pas Paris-Match. Non ! Ce qu’on vous propose ; c’est un tour du monde minable, pépère, le genre de chose qu’un prolétaire-moyen-sans-plus peut s’offrir, s’il consent un jour à vendre sa télé enculeur, son salon salle à manger Ségalot, son costard trois pièces cuisine de chez Pacher Peuchère, bref tout ce qui fait que son papa et sa maman se disent « plus de souci à se faire pour lui, maintenant il est installé ».
Voilà. Puce et moi, on a fait ça, sauf pour la télé parce que la nôtre était un vieux machin en noir et blanc que j’avais hérité de mes parents, et que de toutes façons elle ne marchait plus depuis quatre ans. Bref, on a vendu un peu tout ce qui traînait à la maison et on a levé l’ancre.
Bon, les gars, on n’est pas sorti de l’auberge : figurez-vous qu’un gars au troisième rang ne connait pas Puce. Puce, c’est ma moto… Oh ! Pas une grosse, pas un de ces trucs qui vous donnent envie de bomber le torse aux carrefours, parce que les gens doivent se dire : « Peuchère, pour monter sur un engin comme ça, il ne faut pas être une femmelette ! ».
Puce, c’est pas ça : elle est si petite que quand je suis dessus, on ne la voit presque plus. Ce n’est pas la moto à Batman, c’est une puce à roulettes.
Pour l’état civil, voilà ce qu’est Puce. Genre : vélomoteur. Marque : Yamaha. Cylindrée : 72 centimètres cubes. Type : 477 (GT 80). N) dans la série du type : 1267. Carrosserie : solo. Énergie : essence. Puissance : 001 Ch. Places assises : 7 (mais ça, c’est une erreur de l’ordinateur préfectoral). Numéro d’immatriculation : 6676 EG 92. Date de première mise en circulation : 25/07/75. Nom de l’époux : moi.
Maintenant je vais vous dire ce qu’est Puce pour moi : l’être le plus extraordinaire que j’ai jamais rencontré, comme le dit le Reader Indigeste. Figurez-vous qu’un jour de juillet 1975, je suis tombé amoureux de ce petit bout de moto, si, si, vraiment amoureux : alors, je l’ai épousée, et nous sommes partis ensemble, en guise de voyage de noces, voir si la mer Rouge l’est vraiment.
En fait, elle est aussi bleue que les autres, mais par contre, Puce et moi avons découvert qu’on aimait bien voyager ensemble. Ce premier voyage, on vous l’a raconté dans Moto Journal pendant l’hiver 1975/76.
Aussitôt rentré, on a entendu parler du rallye Côte d’Ivoire-Côte d’Azur. Pour sûr, ça risquait de faire un beau voyage, ça aussi. A vrai dire, je n’étais pas très chaud-chaud, mais Puce a tellement insisté que j’ai signé. En fait, ce n’était pas un voyage, c’était un rallye. C’est ainsi qu’on a ramassé une grosse pilule. Puce et moi, on a cru ce qu’on disait dans la brochure, c’est-à-dire qu’on pourrait suivre en père peinard, simplement en roulant moins vite mais plus longtemps que les autres.
Erreur : sur les pistes africaines, qu’elles soient en « tôle ondulée » ou en sable mou, on a le choix entre rouler à fond ou pas du tout. Alors, Puce et moi, on a suivi pendant deux mille et quelques kilomètres, et avant de s’escagasser les osses, on est rentré chez nous.
La pauvre Puce est rentrée d’Afrique dans un état lamentable, une épave de Puce. Moi aussi, puisqu’entres autres souvenirs d’Afrique, j’avais ramené un gadget à la mode qu’on appelle hépatite virale. Une fois remis à neuf, savez-vous ce que j’ai fait ? Lancez-moi des poires blettes, des œufs pourris, videz-moi vos pots de chambre sur la tête, je mérite tout ça et dix fois plus : j’ai mis Puce sous une bâche dans un coin de mon garage, et je l’ai oubliée.
Le bon diable veillait sur nous. Un jour d’été 1977, pour des raisons bien trop compliquées à expliquer, me prend une de ces grandes dégoûtations généralisées que l’on ne peut soigner qu’enfermé chez soi, loin du monde et de ses chimères, en compagnie d’écrits sinistres, tandis qu’un chat noir, trônant sur la plus haute armoire, vous couve de son regard de fer… Ah, pas vous ? Moi, si…
Un jour le Diable m’indiqua la voie, par l’intermédiaire du chat noir, bien évidemment. Je me trouvais dans mon garage en séance de méditation transcendantale. En clair, je graissais une chaîne de moto. Je médite toujours dans ces moments là, parce que ça m’aide à supporter l’odeur dégueulasse de la graisse consistante qui fond, quelquefois même, ça prend feu au dessus, je sais, je chauffe trop vite, mais on n’a pas que ça à faire, tout.
Le chat, attiré par le bruit de friture je suppose, est entré dans le garage pour surveiller la casserole d’un air dégoûté. C’est à ce moment là que ça a pris feu dans la casserole de graisse à chaîne. Le chat a eu peur et il s’est instantanément mis à couvert, l’abri le plus proche étant une bâche en toile cirée, qui recouvrait… Je ne savais plus quoi.
Cela m’a fait tellement rigoler que j’ai presque oublié d’éteindre le feu dans la casserole. Après ça, j’ai regardé du côté du chat. Vous savez, si vous vous payez la tête d’un chat, il s’en rend très bien compte, et il n’aime pas ça : Belzébuth-à-moustaches me regardait d’un air mauvais, encore à moitié caché sous la bâche. Lorsqu’il l’a relevée pour en sortir, avec ce mouvement brusque de la tête qui n’appartient qu’aux chats, j’ai vu et j’ai dit : « Euréka ».
J’ai vu… le pneu avant de Puce, ma petite bécane oubliée. La conclusion était évidente : j’avais découvert le E= MC2 de la vie en général : il y a des moments où rien ne va, où tout semble prendre un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues. Les scientifiques appellent cela « loi de l’emmerdouillement maximum ».
Cette loi s’énonce par l’équation suivante : 1K/2MR+1K/4MR2+K/8MR2+1K/16MR2… Ceci en progression constante jusqu’à l’infini. On conçoit assez facilement que lorsque la loi s’applique, la marge de manœuvre est extrêmement réduite, voire nulle, puisque l’on arrive au postulat que 1K/MR, cas que les scientifiques appellent couramment « seuil d’emmerdouillement intégral ». Seulement, ce que je venais de découvrir est que si 1K/1 MR2, il va de soi que 0/1K=0 mais que 1K/0=
Ce n’est donc pas le K (cas) qu’il faut supprimer mais le diviseur. En partant, par exemple…
Lumineux ! Il suffisait de remettre ma Puce en état, de m’asseoir sur son dos et à nouveau elle deviendrait Pégase.
Une maxime, probablement apocryphe, de Confucius dit : « Ne vous pressez pas, il est déjà trop tard ». J’en ai fait par avance la philosophie de ce voyage. Je ne boufferai pas 1500 kilomètres par jour, sauf si, d’aventure, je me trouve pris dans un feu de brousse.
On va faire ça kool, à petit pas, en s’arrêtant le temps qu’on voudra dans les endroits qui nous plaisent. L’ennemi du voyage, c’est le temps. J’ai donc mis du sable dans le boîtier de ma montre.
En dehors des liens affectifs que nous pouvons avoir, la Puce et moi, c’est en bonne partie pour cela que je pars avec un 80 cc : cette petite bête se conduit par transmission de pensée, elle use une chaîne tous les cent ans, un pneu tous les demi-siècles, et ne croque guère plus d’essence qu’un briquet tempête.
Sérieusement, les gars, qu’aurais-je été faire d’un gros machin avec des chevaux, où trouver les chaînes, les pneus, les plaquettes de frein, tous les trucs dont ces gros animaux sont friands ? Non, qui voudra rigolera, mais je trouve ma Puce parfaitement adaptée à ce genre de voyage. Si ça rate, s’il nous arrive un pépin quelque part, hébin c’est qu’on aura pas eu de bol.
Le Caire, septembre 1978
Aujourd’hui, Puce et moi, on est au Caire, en Égypte. Comment sommes-nous arrivés en Égypte ? La réponse est claire comme de l’eau de feu et lumineuse comme le soleil du matin sur la pyramide de Keops : par hasard.
Par pur et simple hasard, parce que la Turquie qui aura toujours trois métros de retard sur l’histoire se figure encore que les citoyens de républiques démocratiques sont d’espèces de monstres aux pieds fourchus qui hurlent à la lune en mangeant des petits enfants.
Autant vous dire tout de suite pour que vous ne me demandiez pas par la suite pourquoi je contourne tel ou tel pays, je suis depuis peu, citoyen de la République démocratique du Vietnam. Pour nous rendre en Orient, Puce et moi, nous avons concocté un itinéraire 100% terrestre via la Suisse, l’Autriche, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie et la Syrie, que nous avons attaqué pendant les vacances d’août.
Je ne vais pas vous barber avec l’Europe ; Nous avons traversé Genève, la ville aux mille horloges (comment je le sais ? A minuit, je compte les coups et divise par douze), la Suisse, l’Autriche.
Nous n’y sommes pas restés longtemps, parce qu’il pleuvait et qu’il y avait tout plein de montagnes. Je n’aime pas la pluie et Puce n’aime les montagnes que lorsqu’elles descendent, or les montagnes autrichiennes montent beaucoup.
En Yougoslavie, on a joué aux touristes Allemands, ce qui n’est pas difficile vu que rien n’est cher. En Bulgarie, on a eu la chance de rencontrer un journaliste Bulgare francophone en congé de maladie, qui nous a fait découvrir les deux faces du socialisme.
Ensuite, on pensait transiter par la Turquie vers la Syrie. La Turquie n’a pas voulu de nous, on a pensé aller en Grèce, puis en Syrie par ferry-boat, mais le consulat de Syrie en Bulgarie ne voulait pas nous donner de visa sans l’autorisation du consulat Vietnam, autorisation que le dit consulat Viet me disait de retourner demander à Paris. On a donc fini par aller en Grèce, mais pour prendre le ferry pour l'Égypte.
L'Égypte, on y est aujourd’hui. Je regarde en ce moment, sur la carte, le trajet qu’on a suivi, Puce et moi : Paris, Nîmes, Marseille, Monaco, Genève, Zürich, Innsbruck, Zagreb, Dubrovnik, Titograd, Skopje, Sofia, Salonique, Athènes, Alexandrie, Le Caire, ça ressemble aux louvoiements d’un poivrot en bordée.
Pas très étonnant au mois d’août, nous étions sept motos venant de France dans le ferry Athènes-Alexandrie : deux Yam XT 500 de Lille, une Guzzi V7 de Paris, trois BMW, une d’Orléans et deux de Castres, plus ma Puce unique et préférée. Nous étions déjà tombés, avant même de fouler le sol Égyptien, sous le feu roulant de dizaines de transitaires plus ou moins bidons, qui proposaient de nous aider à dédouaner nos motos, pour des prix variant de 100 à 300 francs.
C’est ma première surprise : ça « sent » plus l’Afrique que l’Arabie. Eh oui, on parle arabe, ici, mais on est sur le continent africain…
Prévoyant que ça allait être dur, on a vite fait fondé entre nous le Moto-Club du port d’Alexandrie pour affronter l’ennemi. En fait on a été plutôt brillant. En l’espace de cinq heures, on a dédouané cinq motos sur sept, celles qui avaient des carnets de passage en douane, le passeport des motos. Les deux autres ont dû attendre le lendemain pour avoir l’aide du consulat de France, puisque c’était le 15 août. Ma Puce, de 6676 EG 92 est devenue de par la loi égyptienne « ALX 10628 ». Je ne vous l’écris pas en Arabe, sinon à la composition, ils vont perdre leurs cheveux, notons juste qu’Alexandrie n’existe pas, c’est « El Iskandria ». Avec les deux XT 500 (entre Yam, pensez) et la BM d’Orléans, on est alors se faire une grande bouffe à Alexandrie, puis, les trois grosses ensemble, Puce et moi séparément, on a mis le cap sur le Caire.
La route est correcte, de temps en temps bien sûr, il y a des trous, de gros trous, même, mais vraiment pas de quoi s’inquiéter. Le plus rigolo est une habitude de conduite qu’ont les Égyptiens : ils aiment rouler en quinconce. Il y a les Égyptiens de gauche et les Égyptiens de droite, c’est simple.
Au début, on trouve ça amusant, ça fait des chicanes, ça brise la monotonie des lignes droites, mais ça présente un inconvénient : du fait de la circulation en quinconce, les gens voient des chicanes partout, et si vous déboîtez à gauche à l’avance pour doubler, il se peut très bien que quelqu’un arrive par derrière, vous double à droite et vous fasse une queue de poisson pour doubler ensuite le véhicule que vous alliez vous-même doubler. Évidemment, avec ce style de conduite, il n’est pas tellement rare que ça cartonne, en fait cela cartonne même plutôt beaucoup.
A mi-chemin du Caire, psscht ! Crevaison. Démontage de roue, deux muletiers viennent m’aider sans que je leur demande, ça a l ‘air sympa, ça… Changement de chambre à air, au moment de repartir, je remercie chaleureusement mes muletiers mais, à leur mine renfrognée, je comprends que ce n’est pas vraiment ça qu’ils veulent. Des sous ! Des sous !
En fait, pendant les premiers jours de mon séjour en Égypte, je n’aurai pas fini d’en sortir. Autant vous le dire tout de suite, l'Égypte est un drôle de pays, au fond tous les pays sont, à leur façon, de drôles de pays, sinon ce ne seraient pas des pays du tout, pas vrai ?
L'Égypte, je l’aime et je la déteste, les Égyptiens, j’ai parfois envie de les serrer dans mes bras, parfois de leur balancer du Napalm. Ceci, je vais essayer de vous l’expliquer peu à peu. Après avoir contourné de loin un camion de Coca Cola retourné en travers de la route, avec la trouille de crever à nouveau, on est arrivé au Caire, Puce et moi. On se congratulait « tu te rends compte ? Le Caire ! » Puce était contente, elle aussi, d’être là.
Remarquez, elle a vite déchanté, la Pucette, lorsqu’il lui a fallu craindre pour ses osses ; la circulation au Caire, est Dia-bo-li-que ! D’abord, il y a du sable partout, on a la figure perpétuellement pleine de sable, collé par du gazole, car les camions, ici, sont réglés chaque fois que le prophète perd une dent. Une heure de circulation, et vous êtes noir comme Bokassa 1er.
T-shirts blancs, s’abstenir. Je vous conseille plutôt la couleur gas-oil. Ensuite il y a le bruit, ah ! les klaxons ! Ici, on klaxonne en permanence, et principalement quand ça ne sert à rien. Si un Égyptien voyait soudain la main de Dieu fendre la terre en deux devant ses roues, il commencerait par klaxonner au cas où.
Les encombrements : pour remonter l’avenue Kasr el Nil, longue de peut-être 2 km, à moto, il faut une demi-heure si le vent est favorable.
Au Caire, il y a des feux rouges, mais leur signification n’est apparemment pas conforme aux codes internationaux : le vert signifie passez, l’orange continuez à passer, et le rouge passez quand même, sans blague ! Même que ça a des côtés assez sympas, pour un nouveau venu, de griller un feu rouge à fond sous l’œil indifférent des flics de faction. Par contre, il est évident que dans ces conditions ça cartonne souvent et parfois très fort.
Histoire de se roder, on en a pris une, on a mordu la poussière. Remarquez, on aurait dû se méfier, en fait au début on s’est méfié. « Les dangers de la circulation au Caire sont considérables », dit le manuel du Caire publié par l’université américaine. Cela, on le savait.
Ici, il faut considérer tout conducteur de quoi que ce soit, tout piéton comme un ennemi féroce qui cherche à vous mettre par terre par tous les moyens. On l’a su, manque de chance on l’a oublié assez longtemps pour qu’une bagnole nous fasse demi-tour sous le nez, sur une grande avenue, et qu’on se retrouve par terre.
Puce n’a pas grand-chose, un clignotant en huit, les supports de phare de guingois, des petits horions sans importance par ci par là, moi idem, j’avais de petits bleus dans tous les coins, mais aussi un gros orteil gauche comme une chambre à air de camion.
J’ai laissé glisser pendant trois jours, et comme ça enflait plutôt que de désenfler, je suis allé voir « el tabib » qui m’a passé aux rayons X, c’est une petite fracture sans déplacement de rien du tout, ce n’est pas ça qui va nous empêcher de tailler la route. Évidemment, avec ce gros orteil en point de suspension, impossible de monter les vitesses du pied gauche.
Depuis cet accident, j’étais obligé de les passer à la main, c’est pas que ça me dérange outre mesure, sur ma Puce si petite il n’y a pas à se baisser beaucoup, mais le problème est que si je change de vitesse à la main, je ne peux pas débrayer, vu que comme sur toute moto civilisée, le sélecteur de ma Puce est à gauche. Or, étant donné qu’il me faut garder mon pansement de course pendant trois semaines, je ne m’imaginais guère en train de jouer au charcutier en passant pendant trois semaines mes rapports sans débrayer.
J’ai dû inventer un truc. Cette géniale création, c’est le Fred-o-matic, le passage des vitesses au tableau de bord. C’est un câble actionné au guidon qui permet de soulever le sélecteur. Oh, d’accord, je suppose que douze mille trois cent cinquante quatre éclopés au moins y ont pensé avant moi, le fait est que ça marche merveilleusement bien, on met un peu plus de temps à monter les vitesses, mais généralement, en cas de vraie urgence, c’est plutôt de les descendre dont on a besoin. Donc impeccable.
J’ai testé le système aujourd’hui dans les encombrements du Caire, et je vous le garantis : le Fred-o-matic est le Nirvana des unijambistes temporaires ou non. Nantis de ce merveilleux système, Puce et moi allons pouvoir finir notre entrevue (notre bataille ???) avec Le Caire, passant nos vitesses en tirant sur une poignée de chasse d’eau recyclée.
Y’a pas, il faut que je vous parle encore du Caire, sûr que c’est parce que je l’ai traitée par-dessus la jambe qu’elle m’a fait une vacherie. Qu’est-ce que Le Caire ?
C’est un gros choc quand on arrive de Grèce. Si vous allez d’Europe vers le Moyen Orient, vous passez par la Turquie qui en un sens vous préacclimate. De Grèce en Égypte, vous passez directement d’un continent à un autre très différent.
Il y a tout à coup tant de bruit, de choses à regarder et à comprendre en même temps, qu’on se sent dans la peau d’un gamin de huitième à qui on ferait boire trois verres de mousseux avant de lui dire, en lui fichant un coup de règle sur les doigts : « Voilà une équation du second degré à trois inconnues (en admettant que ça existe, je ne le sais pas plus que toi, non, pas toi, toi…), tu as trente secondes pour la résoudre ».
Une ville incroyablement vivante, où il y a un commerce au mètre carré, mais où en beaucoup d’endroits, les immeubles ont l’air abandonnés, en ruines. Une ville où en l’espace d’une demi-heure, on peut être abordé successivement par un coraniste désireux de vous aider à comprendre la parole de dieu, la vraie, celle du coran, et vous invitera des soirs et des soirs à dîner chez lui pour après vous expliquer l’Ecriture, sans jamais s’énerver sur votre inertie, et dix individus apparemment très sympas qui ne veulent que vous faire changer de l’argent au noir à un taux pas intéressant du tout, vous vendre je ne sais quel truc bizarre et éventuellement sans valeur ou simplement vous escroquer des ronds sous un prétexte plus ou moins fumeux.
Le Caire est immense : de Héliopolis à Dokki, ça doit fichtrement bien faire sa trente ou quarantaine de bornes ; faubourgs ou centre, c’est du pareil au même, c’est une ville effroyablement tassée autour de son artère aorte : le Nil.
Ici, l’eau est le sang. Mis à part dans les restaus pour milliardaires, elle est toujours tiède, mais comme ici on n’arrête pas de respirer de la poussière et de mâchonner du sable, elle cote plus qu’un Chivas Regal de cent ans d’âge.
De temps en temps, trois ou quatre fois par semaine, les robinets affichent rupture de stock, mayye ma fish, y’a plus d’eau. Alors, on attend, quand elle revient on en boit même si l’on n’a pas soif, parce qu’ici, si elle s’arrêtait pour de bon, y’aurait plus qu’à se coucher par terre. Ailleurs aussi, j’y pense, mais ici on s’en rend compte…
Donc, Le Caire est grande, très grande, mais on s’y perd peu, parce que finalement, pour ne pas s’égarer, il suffit de savoir de quel côté se trouve le Nil, y retourner, puis le suivre dans un sens ou dans l’autre, rien n’en est jamais très loin…
Cela dit, si la fourmilière du Caire est passionnante, Puce et moi avions quelque besoin d’un peu de calme, c’est pour ça qu’on est parti vers le désert.
Le Caire, capitale de l'Égypte. Du Caire au désert, combien y-a-t-il de kilomètres ? Perdu : pas un. Le Caire est bâtie sur le sable, c’est peut-être pour cela qu’elle dure depuis si longtemps. Au Caire, il faut vider sans cesse ses chaussures, toujours pleines de sable. Alors, Puce et moi, à peine sortis du Caire, on s’est retrouvé dans le désert sans s’en être vraiment rendu compte.
Il faisait nuit, on a suivi une route toute sombre, ici on semble aimer le bitume bien noir. Au bout d’un moment, on a senti un vide, parce qu’il n’y avait plus, ou presque plus de klaxons. A un carrefour, on a tourné à gauche, au bout de deux kilomètres on est passé devant les trois pyramides de Giza, deux bornes après la route continuait sans aucun éclairage, on était obligé de rouler tout doucement, car la route décrit des virages on ne sait trop pourquoi et avec un éclairage de moto, surtout de petite moto, on ne les voit guère que lorsqu’on se retrouve les roues dans le sable. Tout à coup, plus de route. Cela devait être le désert…
En fait, le désert est une vue de l’esprit. On vous le montre sur une carte, on vous dit : « là, c’est le désert ». Manque de chance, si vous y allez, ce n’est plus le désert puisque vous y êtes. Blague à part, tous les déserts que j’ai pu voir jusqu’ici étaient fichtrement fréquentés. Celui-là aussi. J’y ai rencontré des chameaux, pardon des dromadaires, des chevaux, des camions, des chiens à profusion, de grosses fourmis assez impressionnantes, et, animaux curieux parmi tous, des Égyptiens.
Ma tête à couper que ça existe, j’en ai vu. Comment les reconnaître ? Très simple : si vous voyez un animal évoluer sur le dos d’un autre, l’animal chevauché pouvant être un dromadaire, un cheval, un âne, une moto tchèque, l’animal chevauchant ne peut être qu’un Égyptien ou un touriste étranger.
Pour distinguer l’un ou l’autre, rien de plus simple : criez « hello ! » si le spécimen répond, c’est un Égyptien. Sinon, c’est un touriste ou un Égyptien sourd et muet. Les Égyptiens aiment énormément parler, même lorsque leur interlocuteur étranger montre des signes de saturation auditoire aussi évidents que la politesse le permet.
Aussi, alors que je suis chez nous réputé bavard, dois-je parfois ici me murer dans un silence têtu et impoli, quitte à passer pour une tête de mule. C’est spécialement choquant quand on a fréquenté les Arabes du moyen orient, qui connaissent la valeur du silence.
Un exemple particulièrement cruel : hier on est allé à Sakhara à dos de dromadaire avec mon p’tit pote Attaya. Un sacré personnage, Attaya, son père étant mort, à quatorze ans il est chef de famille, et pour de bon, hein, il faut l’entendre chez lui donner des ordres à sa mère.
D’habitude, Attaya fait le taxi-dromadaire pour les touristes devant les pyramides. Comme je voulais « faire du désert » et que Puce n’aime pas le sable, avec Attaya, on a pris deux dromadaires et on est parti ensemble toute la journée. Il m’a fait un prix acceptable, parce qu’il aime mieux faire une grande virée que poireauter toute la journée pour vendre des balades autour des trois pyramides.
On n’est reparti de Sakhara que la nuit tombée, en s’arrêtant pour dormir dans le désert.
C’était la pleine lune. On s’est assis dans les dunes à regarder le ciel. On entr’apercevait les pyramides de Giza, et entr’entendait le muezzin d’un village, alors qu’à priori ce n’était pas l’heure d’une prière.
C’est fou ce que l’on peut entendre les choses de loin la nuit dans le désert. Parole, j’étais halluciné. Le désert, les pyramides dans le clair de lune, les dromadaires accroupis qui ruminent, Attaya avec sa gallabia qui flotte au vent, c’est des scènes de cinoche, des photos sur national Géographic, ça n’existe pas vraiment, mais là, crac, j’y étais, en plein.
Je devais m’accrocher au sable pour ne pas m’envoler, et me retrouver tout à coup dans mon plumard à Paris, brassant l’air alentour pour trouver l’interrupteur de la lampe de chevet, et me retrouvant tout à coup dans ma chambre habituelle. Nom d’un chien, qu’est-ce que l’on peut faire comme rêves idiots…
C’était tellement dingue, tellement fragile tout ça, que j’avais terriblement peur qu’un bruit me réveille, et je n’arrivais pas à faire taire ce fichu gamin. J’ai eu beau lui dire, « écoute, c’est tellement dingue ce que je ressens maintenant, men fadlak, laisse-moi un moment de silence, que j’en profite vraiment », lui croyait que je boudais et me répétait toutes les trois minutes « Pourquoi ne dis-tu rien ? ».

En fin de compte, je crois que c’est cela que je ramènerai d’Egypte : l’impression d’une grande incompréhension mutuelle. Cela ne veut pas dire qu’avec les gens d’ici on se tire des balles, je crois même qu’on s’aime bien, il y a des moments où l’on a simultanément ce geste typique d’ici de se coller la main contre la main, coude fléchi, un peu comme si on voulait jouer au bras de fer. Cela veut dire : elle est bien bonne, t’es un pote, on se comprend.
En fait, on ne se comprend qu’un petit peu, un tout petit peu, grâce à Dieu ça suffit pour que l’on soit content de se connaître, mais pour vraiment se comprendre, il faudrait probablement être né au même endroit dans les mêmes circonstances, être allé à la même école, avoir eu les mêmes emmerdes et les mêmes joies, en fin de compte pour bien comprendre l’autre, il faudrait être l’autre.
« Tout comprendre, ce serait tout pardonner » disait Mme de Staël au temps du roi Soleil. Gonzesse, va. Si l’on a quelque chose à pardonner, c’est qu’on n’a rien compris. M’en voudrez vous beaucoup si je vous dis que je ne suis qu’un seul, et que je n’ai pas compris l'Égypte ?
Et pourtant…
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le dessein de plaire à Dieu et pour affermir leur âme ressemblent à un jardin planté sur une colline. Si une forte pluie l’atteint, il donnera le double de fruits. Sinon la rosée y suppléera »
Le Coran.
Cela ne faisait pas bien longtemps que Puce et moi avions élu domicile aux confins du désert, dans une petite cambuse derrière les pyramides de Giza louée à la journée, dont le patron ne fait pas trop la tronche lorsque je mets ma Pucinette favorite dans la chambre pour lui régler l’allumage ou simplement pour éviter que les chiens de désert, il y en a partout, lui pissent sur les pneus.
Nous étions arrivés pas bien riches mais peu soucieux, conscients qu’Allah était avec nous dans notre voyage, et ne manquerait pas d’inciter notre canard favori à nous envoyer quelque monnaie qui nous permette de demeurer enfants prodigues.
L'Égypte nous accueillit à grands coups de « Welcome » et de « Bienvenus » et nous estampa tout ce qu’elle pouvait avec renforts de « tu es mon ami, mon frère, ce qui est à moi est à toi » et tout le toutim. Seulement, l’ami, le frère payait deux ou trois fois le prix raisonnable de chaque chose, et encore quand on trouvait le moyen de lui rendre la monnaie, bien souvent c’était « demain la monnaie » le lendemain on avait oublié…
Paranoïa : un prétendu-étudiant sympa comme tout discute avec toi « C’est vrai, ici, il y a beaucoup de gens qui ne s’intéressent qu’à l’argent ». Tu lui paies un pot. « Attends je vais aller discuter le prix pour toi, je connais les Égyptiens, tu penses », et Ahmed ou Mohammed soit disparaît avec ton billet de dix livres, soit te fait payer double-prix, cinquante pour cent de commission pour lui. Ce n’est pas systématique, bien sûr, rien ne l’est nulle part grâce à Dieu. Disons que c’était assez fréquent pour que Puce et moi, regardions chaque nouveau venu en nous disant : « Par quel foutu moyen va-t-il essayer de nous tirer du fric ? ».
Évidemment, à ce train-là, les 660 balles de chez nous qu’il nous restait en arrivant au Caire ont vite été épuisés, et nos sous à venir étaient égarés dans un tiroir de la banque nationale d'Égypte et d’une autre dont j’ai oublié le nom.
Bref, au bout d’une dizaine de jours, on s’est retrouvé fauché. C’est là que l’on a découvert des tas de choses. D’abord que l’on peut faire un repas (végétarien bien sûr) au Caire pour dix piastres, 70 centimes de chez nous au change noir. D’autre part, on s’est aperçu qu’avant, on était bien trop riche pour que les gens alentour nous prennent pour autre chose que des extraterrestres.
Un soir, j’ai ouvert mon portefeuille et je l’ai montré à Adel, l’un des gars du bistrot-restau du coin où l’on m’arnaquait à tour de bras. Dedans, il y avait 25 piastres. J’ai dit à Adel, et c’était vrai : « Voilà, c’est tout ce qu’il me reste ». Adel, je vous le jure, a changé de visage. Il m’a dit : « Maintenant, tu manges avec nous, si tu as besoin d’argent pour payer ta chambre, pour l’essence de ta moto, dis-le nous », il a montré les yeux du doigt, ici ça veut dire « à la vie, à la mort ».
J’ai accepté cette aide, je pensais que ça durerait un jour ou deux, le temps que mes sous arrivent ou que mes bistrotiers (Adel plus deux Ahmad) se lassent d’un étranger sans le sou.
Cela a duré deux semaines. J’ai mangé, j’ai mis de l’essence dans le réservoir de ma Puce grâce à eux. Ces gars-là gagnent 30 livres (trois cents francs au change officiel) par mois, plus les pourboires. C’est au fond normal qu’ils estampent les touristes qui sont suffisamment riches pour venir en Égypte, non ?
Fouille jusqu’au tréfonds de ton âme, toi, oui toi, là. Tu gagnes trente sacs par mois et tu vois un touriste venu de tu ne sais où demander un cola et le payer avec un billet de 50 sacs parce que comme par hasard il n’a pas la monnaie. Les touristes n’ont jamais la monnaie. Aurais-tu des remords à l’escroquer un peu ?
Pour ma part, maintenant, j’ai un peu mauvaise conscience à râler quand on cherche à m’estamper. Il va être temps que je m’en aille, maintenant dans chaque estampeur du Caire ou de sa banlieue, je vois un Adel ou un Ahmad, qui gagne peau de zeubi et qui te prêtera ses sous, à toi qui le traitais de marchand de melons parce qu’il te rabiotait une vingtaine de fichues piastres.
Quand tu commences à voir un ami en celui qui est pour le moment ton adversaire, la vie devient rapidement déchirante, presque impossible.
Si tu manges dans l’assiette du chien, tu deviens chien…
Cardinal Belfigo.
C’était il y a quelques jours, avant que mes sous n’arrivent. En voyant les gens d’ici vivre, travailler, je les avais à quelques exceptions près trouvés bien mous.
Souvent, ici, sur douze heures ou plus de boulot théorique, on en passe les deux tiers à glander sur sa chaise. La semaine dernière, je me suis aperçus que, moi aussi, je ne fichais pas grand-chose, que je faisais des siestes interminables, que je me sentais d’envie flagrante de rien. La chaleur ? Oh, bien sûr, ça coupe un peu les pattes, mais on s’y fait.
Soudain, un jour, un voisin qui fêtait je ne sais quoi, m’a convié à un méchoui où j’ai bouffé (pas mangé, bouffé) de l’agneau rôti. Dès la première bouchée, j’ai senti dans ma tripaille un chant de Noël. Gloria, Alléluia…
C’est là que je me suis rendu compte du fait que je n’avais pas mangé de viande depuis près de deux semaines, parce que je mangeais avec des Égyptiens moyens et donc comme eux. La viande ici est trop chère, c’est tout.
Si l'Égyptien moyen ne mange que de la salade, des boulettes aux fèves, des fayots, ce n’est pas pour le folklore, pour faire de jolis plats tout en vert et en rouge, c’est parce qu’il n’a pas le fric pour se taper ces viandes rôties qui vous font chanter l’estomac.
Si Puce et moi ne nous étions pas retrouvés fauchés, on serait partis en se disant, la cuisine égyptienne, c’est joli, c’est bon, c’est écologique. Manque de chance. C’est aussi amolissant. L’âme, en langage scientifique, s’appelle le cerveau et se nourrit de protéines…
Nous voilà renfloués financièrement, mais en dehors de cela, les pronostics sont blêmes : il semblerait bien qu’en optant pour partir vers l'Égypte et non pas en Syrie, nous nous soyons collés dans un cul de sac.
Les accords de paix entre l'Égypte et Israël ont mis l'Égypte au ban de la Ligue Arabe. Aucun bateau régulier ne veut nous emmener l'Égypte dans la Péninsule Arabique, ni au Pakistan, ni rien, apparemment. On nous suggère d’aller à Suez ou Port Saïd pour faire du bateau-stop, sans garantie. On va essayer, sinon, il faudra retourner en Europe pour trouver un autre chemin.
Giza va me manquer, enfin les copains du coin. J’aimais bien partir à dromadaire, avec Attaya jusqu’à la nuit et dormir dans le désert. C’est un moyen de transport folklo, le dromadaire, ne serait-ce qu’à cause de sa hauteur de selle, pas loin de deux mètres, ceux qui trouvent certaines motos trop hautes devraient y penser à deux fois.
Le touriste moyen dit que le dromadaire est très inconfortable. Ceux qui disent ça ne font pas de moto.
Disons… Disons que ce n’est pas très confortable. A basse vitesse, ça ondule très fortement d’avant en arrière, mais le mouvement s’amortit très bien par un mouvement synchrone du pilote. A moyenne vitesse, la situation se complique : on a la sensation d’être en train de descendre un escalier au ralenti avec une moto sans suspensions. A grande vitesse, on dispose d’étriers placés en arrière de la colonne de direction de la machine, qui permettent de se désolidariser totalement ou presque de la partie mécanique. C’est astucieux mais fatigant pour les cuisses.
Autre chose, le dromadaire est un animal absolument passionnant par le nombre de bruits incongrus qu’il peut émettre : des rots invraisemblables, des pets fantastiques et toute une gamme de gargouillements d’une variété inconcevable.
Le dromadaire est le moyen de transport complet par excellence, capable de remplacer simultanément moto et mini-cassette. On le dit très sobre. En fait, il passe son temps à bouffer et à boire. S’il ne mange pas, il rumine, s’il ne rumine pas, il boit, s’il ne fait pas l’un des trois, il est mort. Étonnez-vous après ça que le dromadaire puisse passer sept jours sans manger ni boire, il passe son temps à faire des réserves. Le dromadaire, c’est la caisse d'épargne du désert.
Penser que je vis derrière les pyramides de Giza, la chaipucombientième merveille du monde. Ben les gars, ça ne me fait ni chaud ni froid. J’trouve pas ça beau, les pyramides. Nul même.
Je me souviens d’un architecte italien, probablement un cousin du cardinal Belfigo, qui a dit : « l’architecture est là pour servir l’homme et le mettre en valeur ». Alors ces grands machins de plus de cent mètres de haut dont même aujourd’hui on ne comprend pas trop par quelle acrobatie technique ils ont pu être construits, quels hommes ont-ils servis ?
Hein ? c’était pour planquer la charogne d’un dictateur ? Waaaah la crise, eh !
Ben ouais, je suis allé faire un tour dedans, y’a que des couloirs et des cagibis et ça chmoute le renfermé. Blague à part, les pyramides n’ont pas même empêché les pharaons morts de se faire piquer leur portefeuille.
Il y a quelques jours, Attaya est venu me voir : « il faut que tu viennes aux pyramides cette nuit, il va y avoir un son et lumière exceptionnel en français ».
Avec des copains d’Attaya et deux motards français, on y est allé en bande, en resquillant, bien sûr. Je me demandais en quel honneur le son et lumière de Giza se mettait à parler la langue de Champollion. Je l’entendais la nuit de chez moi, mais toujours en godon.
Le spectacle a commencé très très en retard, et comme les copains s’ennuyaient, on a commencé une partie de machin chouette à cloche pied. C’est un jeu local, un peu dans le style rugby, mais on se déplace à cloche-pied mains dans le dos et l’on ne plaque pas, on fait tomber l’adversaire à coups d’épaule ou de poitrine. Un joueur qui tombe est éliminé, et l’équipe entière perd une manche si son « chef » mord la poussière. Il faut donc à la fois attaquer et garder une défense autour du chef.
On avait fait pas mal de manches et consécutivement bouffé pas mal de sable quand finalement, on a vu arriver des autobus climatisés à la queue leu-leu. Ya salam ! Des autobus climatisés, tout modernes, et tout blancs et tout propres. Cela devait être des gens drôlement riches et drôlement importants… Ils portaient tous des maillots blancs avec « Mermoz » écrit dessus.
Le commentaire du son et lumière m’a hérissé : il paraîtrait que les mecs qui ont construit les pyramides étaient heureux comme des papes de faire ce boulot à l’œil par dévotion envers leur souverain et patati et patata, alors là permettez-moi d’avoir des doutes.
La dévotion entretenue à coups de pied au cul n’est plus tellement de la dévotion. Ma fibre syndicaliste CGT s’est éveillée, et à la fin du truc, on s’est mis à beugler « menteurs, remboursez ! ».
Un spectateur Mermoz nous a demandé ce qu’on faisait en Égypte si on n’aimait pas les pyramides.
« Ben voyons, on est venu pour jouer au machin chouette à cloche pied ! ».
Alexandrie, fin septembre
Aïe.. Karpov avance son roi en E5 et me regarde en souriant : je suis mat en six coups, c’est bien fait pour moi, quand on est un gamin débutant, on ne joue pas aux échecs avec un champion du monde.
Mais non, les gars, je ne suis pas aux Philippines en train de disputer les championnats du monde d’échecs, mais c’est du pareil au même : j’ai voulu jouer aux échecs avec le monde, et ce vachard-là m’a fait mat en six coups, six coups également six pays.
En face de moi, il n’y a pas Anatoli Karpov, il y a le monde qui m’a bien eu : pour n’avoir pas lu le Monde (le journal) diplomatique, j’ai perdu la partie. L'Égypte est un cul-de-sac, Puce et moi avons écumé tous les agents de voyages et bistrots de marins de Suez, Ismaïla, Port Saïd, Alexandrie, pas moyen de se faire embarquer pour où que ce soit d’intéressant pour nous. Il faut au moins retourner en Grèce, tant qu’à faire autant revenir à Paris et repartir à zéro…
Dernière édition par cobalt57co le Ven 18 Jan 2013 - 13:09, édité 3 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
De la France à la Grèce
Marseille, mi-novembre
C’est en montant mes clous dans le chambre de mon une étoile anciennes normes que je me suis rendu compte que c’était reparti, hé oui, parce que mes clous, c’étaient mon sac à dos et les deux sacoches en polyester de Puce, vous savez, ces machins dernier cri : on tourne une clé pour les débloquer de leur support et on les emmène comme des valises.
Pendant quatre mois, chaque fois que je changeais de crèche, j’ai trimballé ces trucs dans ma nouvelle antre, après avoir prudemment enchaîné ma Pupuce préférée.
Pendant un mois et demi, je ne l’ai plus fait ; ce soir, je me suis tout à coup arrêté au milieu de l’escalier… Nom de Dieu ! Le sac à dos… Les sacoches… C’est reparti ! Cela m’a fait rire, un client qui descendait l’escalier m’a regardé en biais : « encore eing qui force sur le pastisse ! » doit-il se dire. Tant pis pour l’étonné de l’escalier. Je ris, c’est reparti !
J’entends une question judicieuse : qu’est-ce qui est repart ? Eh bien une tentative de tour du monde sur une Yam GT 80, ou, soyons plus réaliste, une tentative de bien vous faire rigoler en tentant de faire le tour du monde, OK ?
La politique internationale étant ce qu’elle est, ne cassez pas les chaises en hurlant « remboursez !» si ça cafouille, ma première tentative, qui n’a pas dépassé l'Égypte, m’a fait comprendre que dans le fait de tenter un tour du monde, le plus difficile n’est pas de tailler la route, mais bel et bien de faire comprendre au consulat de tel ou tel pays que vous n’êtes pas un espion ou un contre-espion communiste ou anti-communiste, sioniste ou anti-sioniste, montrouducutiste ou anti-montrouducutiste, vous savez, l’histoire des « ptiboutistes » et des « groboutistes » sur le problème des œufs à la coque dans les « voyages de Gulliver », y’a pas que dans Swift qu’on la trouve, jarnilogique.
Je voudrais tenir dans ma main le fichu enfant de Marie qui a inventé le passeport. La peste soit du chien galeux et pestilentiel, j’en ferais des miettes si petites que les moineaux n’auront pas la patience de s’en servir comme becquée. Quant à celui qui a eu l’idée de créer le « visa », hyène puante, cafard aux reflets malsains : torsion du nez et des dents, enfoncement du petit bout de bois dans les oreilles et à la trappe !
Au départ est l’homme, un bipède androïde comme son nom l’indique, né avec une faute originelle que voici : à l’instar d’autres animaux tels que le mouton et la fourmi, il a un instinct bizarre : l’instinct grégaire, qui fait que des animaux de même espèce se regroupent pour faire face à un ennemi commun, au lieu de l’affronter en combat singulier.
Cette attitude présuppose que l’animal grégaire est faible et vulnérable, en tout cas pas autonome. Bref…
Chez l’homme, l’instinct grégaire s’est à ce point dévoyé qu’il est capable de dresser, pour des raisons plus ou moins fumeuses (il n’y a qu’à lire l’histoire) des continents entiers contre d’autres. Cette guerre est permanente.
Lorsqu’elle n’est pas fraîche et joyeuse, avec tambours, trompettes et boyaux collés contre les murs, elle devient guerre diplomatique.
Ce dernier style de guerre, pour le pauvre gland comme vous ou moi, se matérialise, dès que l’on veut remuer pied ou patte, par la guerre des visas. Qu’est-ce ? (à savon). Supposons que vous vous pointiez à la frontière d’un pays X, ou vous n’avez ni tué, ni volé, peut-être même que vous n’y êtes jamais venu avant, ou sinon nous admettrons que, auparavant, vous n’y avez ni tué ni volé, ni même pissé sur le portrait de roi-président-dictateur-empereur-prince-petit père du peuple (rayez les mentions inutiles) ni même attenté à la pudeur sur la personne d’un ou d’une fils ou fille du pays (ou si oui, ça s’est pas su, kif-kif). Bref, vous arrivez blanc comme neige.
C’est là que le portier du pays va regarder votre passeport d’un air plus ou moins dédaigneux, et selon qu’il soit bleu, vert, rouge, brun, jaune ou violet métallisé, vous dire que les relations diplomatiques de votre pays étant ce qu’elles sont avec celui où vous voulez aller, vous êtes autorisé/non autorisé à vous y faire voir. Et tac.
Que voulez-vous que la bonne y fasse ? Il faudrait abolir, interdire, réprimer cet instinct grégaire dévoyé, il faudrait qu’un homme donné n’ait d’ennemis que les siens propres, pas ceux qu’on lui impose comme tels. Et tac ! Je provoque la guerre des non-grégaires contre les grégaires. Une de plus ! Il est bien évident que les titulaires de passeports grégaires n’auront plus droit d’entrée dans les pays non-grégaires. Vous voyez, c’est facile !!!
C’est par une série d’embrouillades de ce genre que je me suis fait avoir, parce que quand j’étais gosse, j’ai appris l’aventure dans les albums de Tintin, vous savez le genre « avec de bonnes intentions on y arrive toujours ». Eh ben mon cul…
Tintin, lui, passe les frontières sans visa (sauf une fois dans « au pays de l’or noir »), prend bateaux et avions sans réserver ni payer le billet, le fric lui tombe du ciel, et lorsque d’aventure, un méchant s’enfuit sur une moto de course, il y a toujours un Piper Comanche qui traîne à deux pas de là, avec le plein de benzine, les clés sur le tableau de bord, la check-list déjà faite, l’autorisation de décollage déjà donnée et le mode d’emploi dans le vide poche.
Eh merde ! Nous autres qu’on joue pas dans les bandes dessinées, quand on se casse le nez à une frontière, on l’a saumâtre, pas vrai, Thierry et Hugues, les deux 500 XT de Pierrefonds (Oise) qui auraient bien voulu passer d'Égypte en Libye ? Grosse bise, les gars, on se recroisera bien quelque part.
Expliquez-moi, par exemple (cas spécialement débile) pourquoi la Birmanie vous accorde sept jours de passage à la condition expresse que vous veniez par avion ? Je passe sur l’Arabie Saoudite qui ne reçoit que pour affaires ou en transit (donc nécessité d’obtenir un visa pour un émirat du Golfe persique, et aucun d’eux ne souhaite voir des touristes), l’Irak qui refuse les visas sans les refuser (l’autorisation de Bagdad n’arrive jamais, du moins quand on la demande à Paris). C’est pas évident, tout ça…
Pour la première tentative, je suis parti sans visas d’avance pour la partie arabe et asiatique du parcours : comme les visas se périment généralement au bout d’un à trois mois, ça aurait imposé une sorte de programme de voyage, ce que je n’aimais pas. Cette technique n’a pas payé.
Cette fois, je pars avec un visa pour la Syrie, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan et l’Inde. Cela fait des pages multicolores sur mon passeport. Espérons aussi que ça porte bonheur.
Ponte di Nava, lundi
Me voilà en Italie, les gnaces, à Ponte di Nava, un chouette petit bled de montagne. Je m’y suis arrêté cette nuit, parce que je me traînais vraiment trop à cause du brouillard et de mon moteur en rodage.
Ah oui, j’avais oublié de vous dire ça. A la suite d’un glaçage de cylindre un peu trop appuyé, j’ai pris mon premier départ avec un jeu piston-cylindre démentiel. En ayant un peu marre d’être poursuivi par une casserole, lors de mon passage à Sète, je me suis offert un réalésage et une révision générale chez mes potes Garry Carrera et Guy Bertrand histoire de fêter les 25 000 bornes de la Puce et d’être tranquille le reste du chemin, si Dieu veut.
Après ça, j’ai tranquillement suivi la côte d’Azur, Marseille, Monaco, San Remo, j’étais en Italie… L’Italie… je compte y demeurer deux ou trois semaines et je vais beaucoup vous en parler. Faisons tout de suite une mise au point : j’aime l’Italie. Je m’y sens bien, alors ne comptez surtout pas sur moi pour vous en parler objectivement, ni vous parler objectivement de quoi que ce soit, d’ailleurs.
L’un des plus grands penseurs de la civilisation latine le cardinal Belfigo, a dit : « l’objectivité est le refuge des sans-esprit ». Comme il avait raison, ce cher cardinal, sûr qu’il aurait été pape un jour s’il n’avait été embringué dans une étrange affaire de mœurs : lui au moins ne serait pas mort comme certain au bout d’un rien.
Il avait comme on dit, une santé de fer. Enfin, bref, je vous aurais prévenus. D’abord et avant de vous raconter ce qui se passe ici, je voudrais mettre fin à une légende qui a la vie dure : celle qui veut que l’Italie ait la forme d’une botte. C’est absolument faux, il est bien évident que ceux qui racontent cela n’y sont jamais allés et le prétendent par jalousie.
En vérité, l’Italie ressemble à un os de côtelette après un repas hâtif. Deux ouvrages de notoriété font d’ailleurs état de cette particularité physique. Je veux parler du « De rerum natura » de Lucrèce et « je sais cuisiner » de Ginette Mathiot.
Pourquoi j’aime l’Italie ? Parce que rien n’y est jamais tout à fait sérieux. J’ai presque toujours l’impression que les Italiens s’amusent à être ce qu’ils sont, que la vie ici est une sorte de comédie improvisée où l’on tient un rôle, mais ans y croire vraiment.
Cela donne une liberté de comportement assez merveilleuse. Exemple : vous vous baladez à moto en pleine tempête de neige, gelé, transi, perclus, vous vous arrêtez à une station-service, et le pompiste vous demande si vous n’avez pas froid à moto.
Évidemment, vous répondez « oh non, pas du tout, je ne peux d’ailleurs rouler qu’à moto, je ne supporte pas la chaleur, ça me tue ». Seulement, si vous dites ça en France, vous êtes obligés de rire, et votre interlocuteur aussi s’il n’est pas trop mal luné.
En Italie, en Angleterre aussi d’ailleurs, il vous est loisible de décréter ça sur un ton tout à fait sérieux, et votre vis-à-vis hochera la tête d’un air solennel, tant ce que vous avez dit est sage et bien raisonné. Il est difficile de faire rire un Français en colère.
Avec un Italien, c’est plutôt facile, car la vie n’est en fin de compte qu’une vaste farce, et, ici, on s’en rend un peu mieux compte. Je suis dans un restauroute, derrière moi, il y a un autochtone, probablement un voyageur de commerce, qui raconte une mésaventure qui lui est arrivée lors d’un voyage à Bucarest en Roumanie. Ses bagages ont été égarés, il s’est retrouvé pendant quatre jours obligé de laver ses chaussettes dans le lavabo de l’hôtel et tutti quanti.
Le gars, c’est un bourgeois italien type, la cinquantaine, poivre et sel, costard-cratouze, loqué par Marzotti, et tout. Il raconte ça comme une bonne blague, apparemment ça l’a bien fait marrer, même si, sur le coup, il a dû hurler, tempêter, menacer d’un scandale diplomatique, mais sans trop y croire en lui-même, parce que pour un Italien rien n’est jamais tout à fait sérieux ; sérieux et ennui sont cousins germains.
Ben tiens, justement, le voilà qui parle de l’Allemagne, des hôtels où il ne manque pas un détail, du bain moussant au cure-dents électronique « Ah ça, ils sont organisés, sono tedeschi, ils sont allemands, quoi ».
On parle d’un autre monde. Je vais essayer, peu à peu, de vous faire comprendre pourquoi j’aime tant l’Italie. On va nager dans l’irrationnel, le cadavre de Descartes va se remettre à puer. Pour ça, je vais m’enfoncer plus profond dans l’Italie. La veine ne me lâche pas, il fait froid, mais très beau. Cela va être un vieux pied de faire des zigs et des zags sur cette route de montagne à moitié déserte…
Turin, mardi soir
Hébin, c’est pas vraiment la performance : j’ai dû faire cent trente bornes aujourd’hui. Trois raisons à cela : d’abord je me suis levé à midi et il fait nuit à 17 heures, ensuite il fait froid en montagne en novembre, enfin nous sommes en Italie.
Vers trois heures et demie, je me suis arrêté dans un restauroute, histoire de casser une croûte en vitesse. Vous savez ce que sont souvent les restauroutes chez nous, des machins à l’américaine qui ressemblent à des morgues.
Là, malgré la façade moderne, c’était un truc sympa style restau de campagne. Comme il se faisait tard, le patron m’a fait un pot-pourri de ce qui restait en cuisine. C’était un bon pot-pourri. Au bout de cinq minutes, après m’avoir soigneusement évalué de sous une table, le chat de la maison est venu partager mon repas.
Apparemment, ça a fait plaisir au patron que je fraternise avec Moustache, le voilà qui m’invite à sa table, ouvre une nouvelle bouteille de Lambrusco, me tend son assiette de fromage « tiens, prends-en, ça donne soif », et de me verser une autre rasade de pinard.
On s’est retrouvé à une dizaine autour de la table, le patron, sa femme, le garçon, le toubib du village, deux routiers et quelques habitués, à se conter nos aventures respectives. A la française, je propose d’offrir le digestif ; le patron fait les gros yeux et me dit, comme s’il était en colère (eh oui, ce fameux « comme si »)
« Ici, tu es chez moi. Ce que tu bois, c’est moi qui l’offre ». Il m’offrira la grappa avant que je m’en aille.
« Va doucement, sois prudent ! ». Je salue tout le monde d’un coup de corne de brume. Tiens, oui, échaudé par mon accident au Caire, j’ai offert à Puce une corne de brume de bateau à gaz liquéfié, un truc génial qui fait des « Poooaaah » tels que les gens que je corne sont persuadés qu’ils vont se faire aborder par le Titanic, évidemment après, ils sont un peu frustrés lorsqu’ils voient passer le radeau de la Méduse, mais ils se poussent, et c’est ça qui compte.
Bref, vous commencez à voir pourquoi j’aime tant l’Italie ? C’est un pays qui a su rester humain. En France, au moins dans les grandes villes, ça fait bien, ça fait sérieux, ça fait crédible de faire une gueule de contrôleur des contributions, d’avoir l’air de passer au dessus des sentiments humains et donc vulgaires.
Et bien merde ; la dignité, c’est autre chose que d’avoir l’air perpétuellement constipé comme Giscard. De ce côté-là, je dois dire (et ce n’est pas pour vous faire mousser, bande de brêles) que les motards sont tout de même moins cons que la moyenne. Peut-être pour avoir eu souvent froid, pour s’être retrouvés gelés, perdus en pleine nuit dans un bled aux lumières éteintes, ou bien en rade sous la flotte ou la neige, les doigts raides comme des bambous, les pieds comme du béton sauf que ça fait « glourk-glourk » quand on danse d’un pied sur l’autre pour se réchauffer.
Dans ces moments-là, soit on trouve un collègue qui vous sort de la solitude (le pire n’est pas tellement d’avoir froid, c’est d’être seul), soit, imaginatif, on se dit que ce serait bien d’avoir quelqu’un pour tendre la louche, et que, à la première occasion, on sera celui-là.
Excusez-moi les mecs si je vous fais tartir avec mes salades, mais je trouve que c’est fantastique un monde amical, solidaire, et je crois que lorsque l’on a froid quand il fait froid, quand on est mouillé lorsqu’il pleut, on a une petite chance de rester un petit peu plus humain, profitons-en…
Milan, samedi
Waoutch les gars, je crois que j'ai mérité Milan. Bon Dieu, quel calvaire! Un froid de moto-canard, un brouillard à tailler au burin, il a fallu que je m'arrête deux grandes fois pour dégeler un peu.
Faut dire que je suis fringué comme l'as de pique. Des tenues de froid, j'en ai, mais vu le manque de place dans les sacoches de la Puce, j'ai tout juste emporté une combinaison de pluie. Que voulez-vous, c'est ridicule, mais je tiens à mes vieilles fringues de mauvais temps comme une arrière grand-mère à sa robe de mariée. Je pourrais vous en raconter chaque trou et chaque éraflure.
Alors, j'ai emmené le minimum pour ne pas avoir à en abandonner en route quand il fera plus chaud. Enfin, je suis arrivé à Milan. Italie oblige, je me suis tout de suite retrouvé en famille, une famille que je ne connaissais pas dix minutes avant.
A l'origine, un Milanais de mon âge avec qui j'avais bavardé une après-midi en Égypte et qui m'avait dit "si tu passes à Milan, viens me voir, tu seras mon hôte et je te ferai connaître ma ville".
Stefano n'est pas un motard, c'est simplement un mec sympa, le genre à ruiner l'industrie hôtelière, un gars comme il y en a pas mal en Italie et en Angleterre. Avec ceux-là, il faut s'attendre à chaque minute à recevoir un coup de grelot "salut, je suis à Paris, j'arrive" ou encore "salut, je suis un ami d'un tel, il m'a dit que je pouvais passer chez toi" mais de la même façon, on peut débarquer chez eux sans crier gare, il y a toujours un coin libre pour le fils prodigue.
Sur la route, j'ai croisé une moto, une 125 Honda verte avec un guidon à moustaches, pensez si on s'est salué haut et fort! Ici, les motos passent l'hiver au garage, c'est peut-être pour ça que quand on dit à un Italien que les chromes des machines italiennes rouillent à une vitesse égale à V, il n'est pas rare qu'il vous regarde d'un air totalement incrédule. Remarquez qu'il n'est pas non plus très logique de faire de la moto par mauvais temps... Enfin...
A quoi ressemble Milan? Pour le moment, avant tout, à une grande ville où il fait froid et il pleut. En dehors de cela, disons que c'est une grande ville moderne, où passé et présent, ancien et nouveau arrivent à cohabiter sans trop se bousculer l'un l'autre. Cela s'est modernisé avec un certain sens de l'harmonie. Ce n'est pas dans le vieux Milan que l'on a construit la tour Montparnasse, merci.
Au début de cette histoire, quand j'étais en Égypte, je vous ai dit avoir trouvés ridicules les pyramides, tout simplement elles n'avaient pas été crées pour l'homme, mais pour des dieux, pire encore pour des cadavres d'hommes qui se prenaient pour des dieux.
Ces dieux-là sont morts, et maintenant on se retrouve gros-jean, avec des tas de cailloux de 14O mètres de haut, que l'on montre aux touristes pour faire voir jusqu'à quel point on a pu être con. Je me méfie du gigantisme, des pyramides, de la Tour Eiffel, de la Tour Montparnasse, des motos de 35O kg, à force de vouloir être le plus ceci ou cela, on finit par oublier la finalité de la chose, à construire, et se retrouver être le plus...
Vous m'avez compris. Eurêka! Les Italiens font les villes comme ils font les motos: c'est pas parfait, il y a des pannes d'électricité, parfois la peinture s'écaille, mais c'est beau, harmonieux, manifestement conçu pour l'homme et on a joie à fréquenter. Un jour, faites une petite cavalcade sur une 3 1/2 Morini Sport, une Ducati 9OO SS, ou une Guzzi Le Mans, et même si vous n'achetez pas, vous me comprendrez.
Cela dit, il y a des exceptions: il y a un quartier de Milan fait d'immeubles hauts et prétentieux, raides lisses et guindés comme des moteurs de 1OOO Laverda. C'est le quartier "noir" de Milan, et on appelle ça l'architecture fasciste. Il faut de tout pour faire un pays, faut croire. J'aime bien Milan, mais sans plus. C'est une ville d'affaires, donc on marche vite dans les rues; Milan, c'est la plus sérieuse des villes d'Italie.
Modéne, mardi matin
Y'a pas, ça se gâte. Je suis parti de Milan, hier midi, eh oui, le temps de déjeuner, de bavarder, de dire au revoir, ça passe vite, la mamma de Stefano a écrasé une larme. Elle avait toujours rêvé d'une famille nombreuse, elle n'a eu qu'un fils avant de perdre son mari.
" Avec toi-snif- j'avais l'impression d'en avoir un second".
Quand j'ai pris la route, il n'y avait pour une fois pas de brouillard sur Milan. Sûr que c'est pour ça qu'il s'est mis à pleuvoir, dru, dru, dru. Bah, le jour, ce n'est pas la mort, mais sitôt la nuit tombée, les lunettes mouillées, les phares des voitures d'en face, enfin vous saisissez...
A quarante bornes d'ici, mon filament de code a claqué, j'ai eu la flemme de m'arrêter sous la pluie, je suis arrivé ici en suivant les feux rouges d'une bagnole.
Coup de bol, le premier hôtel que j'ai trouvé était bien et pas cher. J'ai mis mes sapes à sécher et dodo, bercé par le bruit de la pluie au dehors. J'aime beaucoup le bruit de la pluie quand je ne suis pas dessous. Ce matin en me réveillant, le temps de réaliser où j'étais, j'ai tendu l'oreille, je n'ai pas entendu la pluie et je m'en suis réjoui. J'ai eu tort. Il ne pleut plus, d'accord, mais c'est parce qu'il neige...
Bologne, mardi soir
C'est tout de même un pays sympa, l'Italie, y'a pas. Après avoir déneigé la Puce, je suis parti sur Bologne, pour aller visiter les collègues de Motosprint. Cela neigeait toujours dru, mais la route n'était pas bien méchante. Ce n'est pas bien difficile de rouler sur la neige, surtout avec une moto petite et légère.
Le pire au fond, ce sont les automobilistes qui se traînent et paniquent pour un rien.. Pour tout arranger, je me suis complètement embrouillé dans les environs de Bologne. Un panneau, Bologne 18 km. Des tours, des détours, ah, un panneau, coup de gant sur les lunettes, Bologne 38 km.
Un quart d'heure plus tard, on a failli se faire emplâtrer par une 5OO Fiat qui balayait bizarrement la route tous freins bloqués. Alors, Puce et moi, on s'est arrêté dans un bistrot pour de refaire une santé.
C'est toujours rigolo quand on vient de rouler dans le froid et que l'on entre dans un bistrot bien chaud, tout, mais tout, se couvre de buée, trois secondes après être entré on est aveugle jusqu'à la cérémonie de l'essuyage des lunettes recto-verso.
Chaque coup, pendant un moment, on croit que ça va sécher tout seul. Macache, il faut toujours sortir le mouchoir... L'ambiance chaude du bistrot m'enveloppe, je me réchauffe les mains sur la tasse de caffè con grappa, je tremble un peu, les clients m'apostrophent "[/i]mais d'où viens-tu et où vas-tu par un temps pareil? De France? A Rome? Madonna! Sur ce motorino? Tiens, prends un coup de blanc[/i]".
Un moustachu barbu me touche le bras "[/i]viens manger chez moi[/i]". Il monte dans son coupé Lancia, moi sur la Puce et l'on part dans la campagne. Au bout de quelques bornes, on passe une double grille de fer forgé, une allée de 2OO mètres de long, avec au bout... Disons une très grande et jolie villa. On pousse la porte. "Maman! J'ai emmené un invité!"
Et me voilà de nouveau en famille... "Veux-tu coucher ici ce soir? Tiens, goûte un peu ça: c'est chez nous qu'on le récolte". Maintenant, vous devez comprendre pourquoi j'aime à ce point l'Italie? Est-ce qu'elle est gentille avec moi parce que je l'aime, ou vice versa?
Viterbo, mercredi midi.
Je pensais aller directement de Bologne à Rome, mais je me suis arrêté pour la nuit à Acqua pendente. Je ne voulais pas arriver de nuit à Rome, parce que Rome, ce n'est pas pareil! Fellini, le cinéaste, qui le connait bien, en a dit: "Tu peux dire n'importe quoi d'elle, elle te recevra toujours comme un fils et un amant".
Rigolez si vous voulez, mais c'est vrai que Rome est ma mère et ma maîtresse: par le passé, quand mon boulot me faisait caguer, quand j'en avais marre de Paris, j'allais me réfugier dans ses bras.
Là j'avais une autre famille, d'autres amis. J'avais pris Rome comme on prend une maîtresse, quand on en a marre de voir toujours les mêmes têtes, ou comme on va voir ses parents qui se sont installés au loin, en dehors du temps, parce que là-bas c'est chaud, c'est tendre et que personne ne viendra vous y casser les pieds.
Excusez-moi, mais les spaghetti al sugo vont refroidir. Vous savez, j'ai connu un Italien qui n'aimait ni les spaghetti, ni les tortellini, ni les fettucine, ni les rigatoni, ni les cannolichi, ni les penne... Poverino! Il est mort à peine sevré...
Bon... Burp!...Pardon. Sur la route de Bologne à Florence, il s'est produit un miracle, un vrai, si! Depuis Milan, la Puce et moi, on s'était cogné un temps schifoso, moche quoi! Départ de Bologne, j'avais bavardé avec un camionneur, à la cantine d'une usine de céramiques où l'on m'avait invité à boire un coup.
"Tu vas voir, sitôt passé la montagne, il fait beau!".
Puce et moi, on est parti avec le brouillard et la neige, le kâkâ, quoâ.. Négligeant l'autoroute et ses charmes frelatés, on a pris la route de Pistoia. Cela a été la zone. Un brouillard épais comme une bière irlandaise, des paquets de neige à moitié tassée partout, gelés et navigant au radar, on est arrivé au tunnel du passo della colina, 972 m.
Dans le tunnel, j'ai tout à coup senti qu'il faisait plus chaud. Pas un peu, beaucoup! Quand on a vu le bout du tunnel, devinez ce qu'on a vu, Puce et moi? Un ciel clair! De l'autre côté, macache brouillard, une route sèche, du soleil et un temps tiède. On avait quitté l'Italie du nord, c'était la Toscane qui nous disait bonjour.
Quand on est reparti d'Acquapendente, il a plu à seaux, mais quand il fait tiède, une averse n'est guère qu'une petite niche entre amis. Maintenant, je vais prendre la route, à 8O bornes d'ici, il y a Rome. Rome notre mère, notre amante à Puce et moi. Ne vous affolez pas si on reste quelques temps sans vous écrire, on a beaucoup de rendez-vous secrets là-bas. Ci vediamo, belli...
Le Pirée, samedi
Eh bien, ça se précipite: après avoir plutôt agréablement traîné en Italie, ma Yam de Puce et moi sommes déjà au Pirée, dans le bateau qui va nous emmener, si Dieu le veut, à El Attakia, en Syrie. Cela va faire deux bateaux la même semaine.
A Ancone, sur la côte adriatique italienne, il y a trois jours, on a embarqué dans le "traguetto" Ancone-Patrai (Grèce) en pleine banqueroute: il ne nous restait pour tout viatique que 2OO grammes de fromage fondu "Bel paese", un pain d'une livre et le plein d'essence de la Puce.
On a tubé d'Ancone à un copain pour qu'il nous envoie quelque menue monnaie à Athènes, il n'y avait plus qu'à espérer.
Ce bateau Ancone-Patrai, on l'avait déjà pris Puce et moi, lors de notre voyage de noces en Jordanie en 1975. C'était alors un machin assez détestable, surpeuplé, demi-snob, une espèce de train de banlieue qui se prendrait pour l'Orient Express.
Cette fois-ci, en plein hiver, c'était plutôt sympa. Il y avait une majorité de camionneurs Grecs, Anglais et aussi un Français qui allait livrer 25 tonnes de Picsou Magazine à Athènes.
Trente-six heures de traversée sans problème, qui m'ont permis de vérifier une chose: c'est vrai que les Grecs aiment danser. Quand on vient passer ses vacances au pays de Srtaton de Sardes, on peut se demander si les Grecs dansent pour le plaisir ou pour le touriste; là, en plein hiver, dans ce barlu plein de prolétaires, il n'y avait pas de gentils organisateurs, mais jusqu'à trois heures du matin, ça a guinché démentiellement, le sirtaki, le hassapiko et tout le tremblement.

Je n'oublierai jamais un camionneur, petit et sec qui dansait, mazette! Comme Zorba dans le bouquin fabuleux de Nikos Karantzaki, et attention, les danses grecques, ce ne sont pas des trémoussements mesquins, il y a des figures hautement acrobatiques, je ne sais pas comment il a fait, mon routier, pour ne pas se mettre en morceaux, avec le roulis du bateau. Moi, je le regardais comme un con, en sirotant mon ouzo offert par un camionneur anglais qui avait tellement l'accent cockney qu'on eût dit qu'il le faisait exprès.
Puce et moi avons sacrément fait la tronche en biglant les horaires de notre bateau: arrivée en Grèce à 23 heures. Comme on n'avait pas un fifrelin pour payer l'hôtel et plus d'éclairage à l'avant depuis Monte Labbate, près de Pesaro, ça promettait une nuit à l'hôtel des courants d'air.
Heureusement, les routiers sont sympas, j'ai roupillé dans la couchette de secours d'un 38 tonnes qui attendait son passage en douane. J'avais beaucoup bavardé sur le bateau avec ces routiers au long cours.
Sacrée race, ils ont un côté bédouin, ces gars-là; ils aiment leur métier, leur liberté, comme des fous. "J'ai été marié pendant 6 ans, me disait l'un d'eux, à l'époque je faisais souvent la Russie, je restais parti un mois. Un jour, ma femme m'a dit: c'est moi ou ton camion. J'ai gardé le camion et, maintenant, je suis libre, un jour ici, un jour là...".
Je regardais mon routier pendant qu'une phrase me trottait dans la tête, la phrase-clé que Mowgli prononçait dans "[i]Le Livre de la Jungle" pour se faire reconnaître des autres animaux de la forêt: "Nous sommes du même sang, toi et moi".
J'ai eu envie de le serrer dans mes bras, ce gros moustachu et de l'appeler "frère". Je lui ai flanqué une grande claque sur l'épaule et on a repris une tournée d'Ouzo...
Au petit matin, quand je me suis extrait de la cabine du Volvo, il pleuviotait sordide, mais le temps était doux. Puce et moi, on a pris la route Patrai-Athènes, piano-piano sur la poignée de gaz, on avait tout juste assez de coco pour arriver à Athènes, 22O km.
Pourvu, pourvu que les copains aient répondu "présent" et qu'on trouve un peu de fric à la poste restante, sinon, on n'a pas une fichue drachme en poche...
Elle est jolie cette route Patrai-Athènes, comme beaucoup de routes grecques, elle passe son temps à jouer à cache-cache avec la mer. Au bout d'une centaine de kilomètres, Zeus a fini par remballer son arrosoir, pour le restant du chemin on a eu droit à un chouette soleil qui nous a fait oublier la retraite de Russie de Rome à Ancone.
A flanc de montagne, avec la mer toute bleue, toute douce à nos pieds, on se laissait glisser, le nez au soleil, Puce zonzonnant doucement à cinq mille tours et soixante à l'heure.
On avait l'impression cent fois heureuse que cette fois on avait laissé l'hiver derrière nous, la route nous a paru courte, courte...
On ne s'est même pas perdu à l'entrée d'Athènes. On est allé direct à la poste de la place Omonia, Allah akbar! les copains ne nous avaient pas oublié, les sous étaient là...
J'ai enfourné fébrilement les talbins de mille drachmes et direction le premier restaurant. Trois jours de pain et de fromage, aïe, aïe! Justement, le patron du restau était en train de sortir de la broche un gros quartier d'agneau rôti. Cela a été la féria des papilles gustatives.
Malgré tout, je n'étais pas trop fier en allant à l'agence de voyages, les bateaux Grèce-Syrie sont plutôt rares et je risquais d'avoir à attendre une dizaine de jours à Athènes. La vie y est plutôt chère et même en vivant à l'économie, dix jours, c'était bien long.
Dieu a encore été grand: un bateau qui aurait dû partir pour El Atakia le matin, avait été retardé et partait le lendemain matin! Il y a des jours comme ça, où l'on a , comme dirait Raymond Oliver, le cul bordé de nouilles.
C'est ainsi que Puce et moi nous retrouvons aujourd'hui dans un somptueux dortoir de troisième classe à bord du "Sol Phryne"; malgré sa jolie peinture, il est quelque peu rance, ce barbu. Enfin, avec l'aide de Dieu, il arrivera peut-être à nous traîner jusqu'en terre arabe, Puce et moi...
Dernière édition par cobalt57co le Ven 18 Jan 2013 - 13:27, édité 1 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Syrie et Jordanie
El Atakia, mercredi
Évidemment, il a bien fallu un peu de déveine pour corser un peu la chose. Je trouvais notre barbu pas franc du collier, en fait, on s'est retrouvé avec le moteur droit HS.
On a perdu deux jours, pendant lesquels il a bien fallu manger au tarif du bord. Ensuite, il y avait des machines à sous à bord, et le démon du jeu m'a pris aux tripes.
Enfin, la douane syrienne a ratiboisé le reste de mes sous, il a même fallu que je donne mon réveille-matin pour finir de cigler l'addition. Je me suis retrouvé à El Atakia à deux heures du matin sans un rond en poche. J'ai donc élu domicile pour la nuit dans la gare routière. Fait pas chaud, chaud, là-dedans.
Je m'étais plus ou moins bien installé pour dormir sur l'un des bancs de bois, le moins exposé aux courants d'air, lorsqu'un flic est arrivé, un pistolet sans étui à la ceinture. Chez nous la simple vue d'un bourreman me donne de l'urticaire, mais ici, c'est la Syrie, c'est pas pareil.
Le poulet en question doit avoir une cinquantaine d'années et une bonne tête. Il s'approche de moi " ne laisse pas ta moto dehors, mets-là à l'intérieur". Puce se retrouve donc à trôner entre deux bancs de la gare routière.
Je sors ma machine à photos pour immortaliser la scène et demande à mon flic de poser devant elle. Plaoutch, coup de flash... "Quand les fais-tu développer, tes photos?".
Ah... ça, c'est le problème. Mes couleurs évidemment, c'est à Paris qu'elles sont développées, c'est pareil pour tous les touristes de passage. Clic-clac, on snapshote l'autochtone à tour de manivelle, on lui vole son image mais lui, le photographié, n'en voit jamais la couleur.
C'est déshonnête, c'est abject, c'est du vol ektachromique et manifeste. De remords, je sors le grand jeu, le joujou extra qui rendrait un juif ultrasionniste populaire à la Mecque: j'ai nommé Sa Majesté le Polaroïd. L'arme absolue! Le truc imparable. Le schmilblick technico-pictural qui fait trembler l'Islam sur ses fondements les mieux établis.
Le Coran, base de la religion musulmane a été écrit au sixième siècle, époque où la plupart des religions existantes baignaient dans l'iconophilie la plus débridée. Par réaction probablement, le Coran, ou peut-être bien seulement la tradition musulmane ont banni la reproduction du visage humain.
Progressivement, la soif d'immortalité que beaucoup d'entre nous dissimulent soigneusement dans le 17ième repli de leur subconscient, coincé entre la Porsche Carrera Turbo ou la Suzuki Bimota et les photos découpées dans Playboy, plus l'invention des cartes d'identité et autres passeports, ont fait progressivement tomber ce ban.
13OO ans de prohibition iconique, ça frustre, ça madame! Les pays arabes modernes se sont tout-à-coup senti une boulimie de photographies. Déjà, la photo "normale" a un côté magique pour le profane qui ignore les vertus de l'hyposulfite, alors vous pensez, le Polaroïd!
Vous sauriez changer les pierres en or que vous n'auriez guère plus de succès. En Égypte, j'étais obligé de cacher soigneusement mon ustensile lorsqu'il était chargé, sinon chaque fois que je rentrais de promenade, il manquait des vues dans la boîte magique. Or mon polar à moi ce n'est pas un tout automatique comme on fait maintenant, c'est un supersport à boîte manuelle à dix vitesses dont sept synchronisées, diaphragme manuel de 3,8 à 64, double carburateur, télémètre couplé, minuterie incorporée et eau chaude à tous les étages. Les ulemas les plus savants y perdaient leur couffic, oubliaient d'actionner le frein à rétropédalage, et les foutues graphies qu'ils sortaient de ma boîte magique avaient l'aspect rébarbatif de peintures de Boronali, alors qu'elles étaient censées représenter l'oncle Abd el Aziz el Absi, tenant dans ses bras son neveu Ibn el Rachid el Seoud, dans le salon du grand-père Muhammad Mamoun ben Muhammad Mumir Abdelwa hab el Sarminy.
Cela ne faisait qu'augmenter mon prestige, puisque j'étais le seul à pouvoir dominer la machine qui reproduit les visages mais, évidemment, ça faisait monter mes notes de films au point que le budget militaire des États-Unis et de l'URSS réunis, en comparaison, c'étaient les dépenses en achat de revues cochonnes d'un pasteur protestant du temps de Martin Luther.
Par contre, côté popularité... Je m'étonne qu'on ne m'ait pas élevé une pyramide. Évidemment, du temps de Keops, ça revenait moins cher à construire, puisque l'on payait les ouvriers à coup de pieds dans les meules.
Enfin... Avec le flicard de Lattaquié, ça a marché en plein. Lorsqu'il s'est admiré en 8X11 cm, en couleurs et en uniforme, il n'a pas pu contenir son émotion: il m'a regardé d'un air bouleversé et a sorti son portefeuille pour acheter la photo, ton prix sera le mien!

Je lui ai expliqué que je ne les faisais payer qu'aux touristes Américains ou Allemands, alors ça a été le délire. Il m'a serré dans ses bras (une accolade de flic, il faut être ici pour voir ça) et on a fait une autre photo, car il avait oublié de retirer sa keffieh. Plus tard, il est venu m'apporter des couvertures, et je l'entendais faire sa ronde autour de la gare routière. J'étais sous la haute protection de la police.
Au matin, on est venu me réveiller. C'étaient les employés de la gare routière qui venaient m'inviter à me réchauffer et à prendre le thé dans leur bureau. Après, quand j'ai sorti un restant de fromage, on est venu m'offrir du café et du pain syrien.
Puis le soleil s'est levé, et les motos-taxis ont commencé leur sarabande. Les motos-taxis? Eh oui ici on les appelle les motos, tout simplement, ce sont de bonnes vieilles 35O ou 5OO BSA Matchless ou AJS, avouant allègrement vingt ans d'âge mais, amoureusement entretenues, elles pètent la santé. C'est le taxi le plus économique qui soit: pour un franc, elles vous font traverser la ville. Tout le monde, y compris femmes et vieillards, utilise ce moyen de transport à Lattaquié.
Tout de même, pour en européen, même prévenu de la chose, ça fait tout drôle: une 5OO Matchless rouge ou noire arrive, pom pom pom, elle s'arrête, un pépé de 7O ans saute du tan-sad, glisse une pièce d'une livre (1 F) au pilote qui repart, pom pom pom, kieffeh flottant au vent, chercher d'autres clients.
Les motos-taxis n'existent plus guère qu'à Lattaquié. Dans le reste de la Syrie, il y en avait aussi il y a trois ans, mais elles ont, peut-être provisoirement, laissé la place aux autos, à la suite d'une histoire éminemment bizarroïdale.
Oyez un peu que je vous raconte ce conte à dormir debout, hélas absolument véridique. Au moment où il y avait du tirage entre la Syrie et son voisin l'Irak, il y a eu dans les grandes villes syriennes des attentats du style "Brigades rouges" et les terroristes utilisaient souvent des motos pour prendre la fuite une fois leur coup fait.
Que pensez-vous alors qu'il arriva? Le gouvernement syrien, qui comme tout gouvernement n'est pas à l'abri des conneries monumentales, a tout simplement interdit la circulation des motos (à part celles de la police évidemment) sur le territoire syrien.
Évidemment, prendre une mesure débile de ce tonneau ou pisser dans un violon, c'est kif-kif du pareil au même. Les terroristes ont laissé tomber les motos pour se servir de petits pas minivans Suzuki, de petites camionnettes de 5OO kg de CU avec des moteurs trois cylindres deux temps, véhicules très répandus ici.
L’État ne pouvait évidemment pas interdire les minivans qui assurent le plus gros des livraisons en ville, s'il l'avait fait, il n'aurait eu ensuite qu'à interdire les triporteurs, les vélos, les autos puis la marche à pieds.
Alors, on a ré-autorisé progressivement les motos, en commençant par Lattaquié. Théoriquement, elles sont encore interdites à Alep où je vais aller aujourd’hui, mais la loi ne s’applique pas aux véhicules étrangers. Puce ne sera pas interdite de séjour à Alep.
Il est huit heures, dans un moment il va faire assez chaud pour rouler le nez au vent. Le soleil commence à taper sur la route. Objectivement, la situation n’est guère brillante : j’ai en tout et pour tout une livre (1 F) en poche, parole, et pas d’essence. Alep, où je vais aller voir Mamoun et Khaleb, deux copains que je me suis fait là-bas lors de mon premier voyage il y a trois ans, est à 180 bornes.
Pas grave, pas grave… Ici, c’est la Syrie, tout s’arrange toujours.
Alep, dimanche
Alep, seconde ville de Syrie, première à mon hit-parade personnel. Depuis longtemps, je voulais y retourner, j’y suis arrivé, j’y reste…
Je n’avais pas de quoi payer les cinq litres d’essence dont j’avais besoin pour faire Lattaquié- Alep, mais j’avais entre autres un stock de bougies de rechange. L’Arabie, c’est le berceau du troc. Quoi de plus simple que d’échanger des bougies, même ultra-froides et à culot court, contre de la liqueur de derrick ?
Le pompiste n’a pas hésité une seconde, à vrai dire, il ne m’était même pas venu à l’idée qu’il puisse refuser. L’argent n’est guère qu’un vecteur entre une marchandise et une autre, alors, quand on peut s’en passer, on s’en passe.
En trois tours de roues et demi, on est arrivé à Alep, traversant des paysages qui auraient pu être ceux du Massif central. Alep est construite comme un village, sans buildings de 500 mètres de haut.
C’est un dédale de petites rues, de petites places, d’arcades et de passages à couvert. Un village d’un million d’habitants.
La plupart des rues n’ont pas de nom, quand on écrit aux copains, ça donne des adresses folkloriques du genre : Syrie, Alep, Khaleb et Absi, près de la gare Bagdar, à côté du marchand de pneus, derrière le cinéma « Ech Cahrk ». Authentique !
A première vue, c’est poétique, mais pas rationnel pour une piastre. En fait, c’est très pratique. Je le prouve : imaginez qu’en France vous alliez rendre visite à un pote dont vous savez tout juste qu’il habite 2, rue des remparts à Monthey-sur-les-Monneaux. Vous arrivez dans le bled en question, il est onze heures du soir, par miracle vous trouvez un quidam dans la rue, et lui demandez s’il connait la rue des remparts. Comme de juste, la rue mesure trente-sept centimètres de long, il n’y a qu’un teulé et deux pondus qui y habitent.
Vous êtes fait, je parie même que vous n’avez plus de sous, plus d’essence, y’a plus qu’à coucher dehors, mon pote ! Maintenant, imaginez que l’adresse de votre pote soit une adresse à l’arabe : « près de l’église, à côté du marchand de motos ». Vous ne croyez pas que ça vous donne plus de chances de trouver quelqu’un « qui connait » ?
Bon, c’est pas tout ça, on est en Syrie, on va donc parler de la Syrie pendant un bon moment, je n’ai pas l’intention de la traverser en coup de vent, because… Vous avez deviné, j’aime beaucoup la Syrie. Ici donc, comme en Italie, objectivité ma fi.
Objectivité, d’ailleurs connais pas, moâ messieurs. Le jour où le Bon Dieu a fait la distribution, j’étais tombé en panne sous la, pluie du déluge à cause d’un fil de bougie poreux qui tirait des arcs sur les ailettes de culasse au lieu de convoyer sagement la foudre essentielle jusqu’au feu central qui fait marcher la machine.
Bref, quand je suis arrivé, le Grand Barbu avait déjà distribué tous ses stocks de sérieux, de raison, d’objectivité. A vrai dire, y’avait presque plus rien dans ses sacoches à Dieu le Père, en grattant bien au fond, il a trouvé un vieux stylobille et une graine de folie qu’il m’a donnés en disant « faudra faire avec ça mon Poth » (poth ça veut dire ami en hébreu).
Il avait les mains bougrement sales, il ne s’est pas gaffé que sous ses ongles, il charriait un bouillon de culture de virus de Sioux, le virus de la moto. Je vous raconte ça pour vous montrer à quel point, souvent, le cours de notre existence ne tient qu’à un fil.
Enfin j’aime la Syrie. D’abord les Syriens sont beaucoup plus cultivés que les Français, la preuve en est que tous ceux que j’ai rencontrés parlaient couramment l’arabe, alors qu’en France c’est beaucoup plus rare, quoi qu’en disent Le Pen et ses joyeux lurons.
Brèfle, avec le système d’adresses syrien, ça a été très facile de trouver la maison de mon pote Mamoun.
Mamoun, Puce et moi avions fait sa connaissance dans la rue, à Alep, il y a trois ans, lors de mon voyage de noces avec Puce en Jordanie.
Les Syriens sont fichtrement sociables, aiment prendre contact avec les étrangers, pour un oui ou pour un non, ils vous invitent à prendre le thé, à manger et à dormir chez eux.
Comme ça, Puce et moi avions vécu deux ou trois jours chez Mamoun il y a trois ans, ensuite on s’était écrit en gros une fois par an, histoire de se dire qu’on n’était pas mort. Et tac, comme ça, au débotté, Mamoun a retrouvé, trois ans après, la Puce et moi devant sa porte.
Que pensez-vous qu’il arriva ? Ben voyons ! on s’est retrouvé en famille ! On m’a réservé un lit, avec un cosy magique. Je dis magique parce qu’il n’y pas d’autre explication : quand je suis arrivé ici, il y bien des jours maintenant, je ne compte plus, je n’avais pas un sou en poche, et ceux que j’ai honteusement gagnés le mois dernier en vous racontant des bêtises sont encore en train de naviguer entre Paris et Alep.
Gîte, couvert, aucun problème puisque je suis chez un ami, mais j’étais angoissé par les clopes. Eh oui les clopes, parce que je suis un membre du club des « un paquet par jour », je voyais en cette matière la disette profiler son spectre décharné sur la page blanche des jours non encore vécus.
Bien sûr, ici, on n’allume jamais une cigarette sans en offrir à la ronde, mais que fumerai-je quand je serai tout seul, comme maintenant ? ( Je mens, d’ailleurs, je ne suis pas seul, à la table où j’écris, il y a les deux petits frères de Mamoun, Zacharie le plus jeune à ma droite qui repasse sa leçon de géographie et Mohamed en face qui fait du canevas, mais ils ont vingt quatre ans à eux deux et ils ne fument pas).
C’est là où je me suis aperçu de l’existence du cosy magique. Figurez-vous que ce cosy a le pouvoir de fabriquer des paquets de clopes. En arrivant ici, j’y ai mis mon dernier paquet avant constat de faillite. Je suis sorti, quand je suis revenu, il y avait deux paquets.
Le lendemain, quatre. Depuis, j’ai beau fumer et offrir des cigarettes à tout ce qui bouge, il y a toujours des paquets de cigarettes dans le cosy. Aujourd’hui, il y en a six. C’est magique, y’a pas ; comme tous les trucs magiques, ça ne marche que quand on ne regarde pas. Les paquets de clopes se multiplient uniquement quand je ne suis pas là.
Il y aussi la patère magique. Deux fois déjà, y ayant accroché mon blouson, j’ai ensuite trouvé dans mes poches de l’argent que je savais, et pour cause, ne pas y avoir mis. J’ai eu beau questionner toute la maisonnée, personne n’avait mis de l’argent dans mes poches. La magie restait la seule explication possible.
Maintenant, dans la maison, nous sommes dix résidents officiels :Mamoun, ses parents, sa femme, ses trois frères, Cham la chatte, Puce et moi. A vrai dire, les recensements sont difficiles à faire : la population de la maison évolue chaque seconde, du rare vide complet jusqu’à trente personnes.
Sur la porte, il y a un heurtoir en cuivre qui fait « tactac » sans consommer d’électricité. Toute la journée, on l’entend tactacquer, pire que dans une samba brésilienne.
Sept heures du matin, tactac ! c’est la voisine du dessus . Vous n’auriez pas du café ? Tfaddali, entre ! On lui donne un sachet, justement les lève-tôt sont en train de prendre leur café « à la turque », ne pars pas tout de suite, prends une tasse avec nous ! On boit le café, les cigarettes circulent, on bavarde, tactac ! Ce sont deux copains d’Abdo, le frère ainé, entrez ! On refait du café, on bavarde, tactac ! tiens en voilà un que je n’ai jamais vu, tfaddal, entre ! On me le présente « c’est le beau-fils de la cousine de ma tante Naala, tu te souviens, celle qui est venue avant-hier soir ? ».
Toute la journée, c’est comme ça, tactac, il arrive des gens de toutes parts. Les femmes ne travaillent pas au dehors, les enfants n’ont que des demi-journées de classe (matin ou après-midi par roulement) c’est le va-et-vient continu.
L’immeuble où l’on vit est une espèce de communauté. A une heure du matin, on vient encore s’emprunter du pain. L’autre jour, on fêtait l’anniversaire de Zacharie, le benjamin, qui entrait d’un pied vaillant dans sa onzième année d’existence.
Côté musique, on n’était pas très outillé, ici l’on n’a qu’un transistor de poche que l’on pose sur l’embouchure d’un verre vide pour amplifier le son. Alors, les enfants sont allés faire tactac chez les voisins pour revenir avec deux de ces énormes radio-cassettes stéréo qui font la joie du monde arabe, des trucs gros commak bourrés de gadgets style vu-mètres, trouillomètres et multiples indicateurs lumineux qui ne servent pas toujours à grand-chose, mais les rendent diablement imposants.
Ici, on ne cherche d’ailleurs pas à savoir à quoi tout ça peut servir, on laisse les vu-mètres dépasser la zone rouge et les indicateurs de crête à LED clignoter comme des sapins de Noël, ça donne du 99% de distorsion par harmonique, à priori un abominaffreux supplice pour l’ex-hifiste que je suis, habitué aux taux de distorsion dont le chiffre commence par zéro virgule, mais on s’en tape, ici l’étalon en matière de haute fidélité, c’est le haut-parleur de la mosquée voisine, fidèle à 100% puisqu’il récite des chapitres entiers du Coran sans jamais omettre une syllabe.
On a fait une nouba de tous les diables, sans champagne ni vodka-orange, puisqu’ici on est musulman. Même avec seulement avec du thé à boire, notre nouba a été réussie, tactac ! tactac ! ça n’a pas désempli.
Chez nous, le soir, y’a pas la télé. Heureusement, parce qu’on est déjà assez nombreux à parler, si on mettait Guy Lux par-dessus tout ça, y’aurait plus qu’à tirer l’échelle. Le soir, soit on va veiller chez les voisins, parents ou amis, soit ce sont eux qui viennent veiller chez nous.
On parle, on joue aux cartes, au jacquet, aux échecs… je suis devenu une vraie bête au « konkin » qui chez nous s’appelle le rami.
Bref, comme des hommes préhistoriques ou comme des petits enfants, on s’amuse avec des bouts de bois ou de carton, ou même avec rien du tout, comme on le faisait il y a longtemps dans les pays modernes, où l’on reste terré chez soi devant 40 kilos de semi-conducteur qui débitent l’Evangile selon Saint Valéry.
Des hommes des cavernes qu’un est. On va vers l’homme lorsque l’on veut voir quelqu’un, alors qu’on pourrait le recevoir par voie hertzienne avec de belles couleurs sur un tube PIL, avec l’avantage de ne pas être gêné s’il a mauvaise haleine. Comme des bêtes on vit.
Pire que des motards qui s’échinent à se réunir dans des endroits pas possibles alors que chez eux, y’a Monsieur Thomson-CSF qui pourrait les emmener au bout du monde sans qu’ils aient besoin de se geler le nœud sur une moto. Franchement, c’est le moyen âge. Faut dire qu’ici, selon le calendrier coranique accroché au mur, on est en 1394…
Ici, y’a pas la télé parce que c’est trop cher, bien sûr y’en a qui l’ont, d’autres qui voudraient l’avoir, qui en rêvent, sont persuadés que ça changerait leur vie. La tentation de l’occident, la voiture, la télé miracle, transmutation, vie nouvelle.
Même si le voisin vous dit « j’ai essayé, ça ne marche pas, la télé c’est l’univers des paralytiques et l’auto est le fauteuil ghetto des culs de jatte, n’y va pas, c’est un piège ! », on fonce, on plonge parce qu’on n’est pas assez riche pour ne pas avoir l’envie, ni essayer sans avoir à se plonger jusqu’au cou.
On se retrouve comme un con avec une vie aussi vide qu’avant et deux ans de traites sur le dos, travaille fainéant ! Méfiez-vous, les gars, quand je vous parle de l’auto, c’est par racisme, mais la bécane 1300 Tartempion, si elle doit vous coûter un an de salaire, c’est le même piège. Ne laissez pas les marchands de melons vous faire devenir, comme disait Prévert, chauve à l’intérieur de la tête. Holà, holà, c’est qu’il deviendrait philosophe, le mec.
Tiens : « Mazoooot !... Mazooooot ! » Voilà le marchand de mazout.
Ici, pour les fournitures essentielles, il n’y a pas besoin de se déplacer : c’est le marchand qui passe dans les rues, en criant ce qu’il a à vendre : du « mazot », des fruits, du savon… Il y a aussi le fripier, qui achète les fringues usagées pour les retaper et les vendre sur le marché ou dans la rue.
Il y a énormément de boutiques à Alep, énormément aussi de marchés couverts, néanmoins la majorité de ce qui n’est pas encombrant se vend à ciel ouvert, dans la rue, à la criée. Ici, une exposition de chaussettes, comme ce n’est pas cher, le marchand crie le prix « Léra ou neuss ! » (1,50 F). A côté des cigarettes américaines de contrebande « Kent, Marlboro, Lerten ! » (2F).
Après, ce sont les pâtisseries, 25 centimes la petite portion, les graines de sésame qui sont le chewing-gum de l’Orient , les sandwichs œuf dur, salade, piment, un Franc, les fringues d’occasion, accrochées aux grilles d’un jardin public, les cireurs de chaussures, les bonbons, le savon, les journaux…
Il va de soi que dans ces conditions, la rue ne peut pas être d’une propreté de clinique suisse. Je vais vous avouer un péché honteux, non pas celui-là, un autre : j’aime bien les villes un peu crasseuses, parce que la crasse est une des manifestations les plus évidentes de la vie. La solution définitive pour avoir une ville propre, c’est la bombe à neutrons. Plus de vie, plus de crasse.
Ici, il y a des chevaux et des ânes, donc des crottins par ci, par là. On vend du chiche-kebab sur le trottoir, il y a donc des cendres, etc. Évidemment, tout ça donne à la ville un parfum épicé que d’aucuns trouvent choquant, mais j’aime bien : je trouve que les villes dites propres sentent la mort…
Je vais vous raconter une histoire de crasse qui n’a pas grand-chose à voir avec notre propos, mais qu’importe. Au printemps dernier, lorsque j’ai décidé de remettre les voiles avec la Puce, je l’ai mise en pièces pour la remettre en état.
Lorsque j’ai déposé le boîtier du filtre à air, j’y ai retrouvé une myriade de ces petites teignes végétales qui poussent dans les buissons du Sahel. Je suis resté deux heures à les regarder, fichées dans la mousse de la cartouche filtrante. Il y avait aussi du sable rouge et du gas-oil.
J’ai revu Bobo-Dioulasso, Ferkessédougou, Ouagadougou, Filingué, la piste de sable rouge, la panique des camions qui traînent un panache de poussière de trois kilomètres de long derrière eux, on en bouffe pendant un quart d’heure avant de les rattraper et de les doubler en risquant de partir à dame, complètement aveuglé.
La nuit passée dans le désert avec François 500 Ducati, des méharistes avaient dormi à côté de nous et nous avaient offert à bouffer une sorte de béton pimenté qui desséchait la gorge pas croyable. Cela nous inquiétait parce qu’on n’avait pas beaucoup d’eau avec nous… Souvenirs…
Tout ça pour cinq grammes de crasse retrouvés dans un filtre à air. Clop, clop, clop…
Mazoooot, mazoooot ! Le marchand de jus de pipeline s’en va. J’avais oublié de vous dire, c’est un cheval qui tire la citerne de fuel, eh, oui…
ALEP SAMEDI
Depuis ce matin, il pleut sur Alep. Rien à craindre pour la Puce qui couche à l’intérieur de la maison. Depuis que je suis arrivé à Alep, elle se repose, la pitchoune. D’une part parce qu’il fait bon marcher, à Alep, d’autre part parce que s’y promener à moto en attendant que les locaux soient de nouveau autorisés à chevaucher la plus belle création de l’homme, est à peu près aussi discret que se trimbaler à poil, peint en vert et avec des plumes d’autruche coincés entre les meules.
Sapé comme un Syrien moyen, je peux déambuler invisible dans la ville. Évidemment, je ressemble plus à Ho Chi Minh jeune qu’au président Hafez El Assad, mais on fait ce qu’on peut….Cela dit, il n’y a pas de Syrien type.
Quand on vit en Europe, on a un peu facilement tendance à imaginer tous les Arabes « pas franchement louches, mais franchement basanés ». Alors là, les mecs, je crie casse-cou : des Syriens, il y en a de toutes sortes, des bistres à cheveux noirs comme ceux de Coluche, mais aussi des tout clairs cheveux roux qu’on prendrait pour des Irlandais, des bruns-clair teint pâle qu’on croirait français, de tout, quoi.
Par ci par là, on trouve même des vieux qui ont été élevés chez les sœurs de Marie couche-toi-là, et jaspinent le françoziche comme vous et moi, sauf que du pays de la fine-champagne et du clos Vougeot, ils n’ont vu et ne verront que des cartes postales, ou les polychromes des bouquins d’histoire, nos ancêtres les Gaulois, etc.
Tiens, je vous avais dit qu’il faudrait que l’on parle de véhicules un de ces quatre. Eh bien parlons en, en partant du bas de l’échelle.
A la base de la pyramide, plus bas que terre, il y a le véhicule sans véhicule, je veux parler de l’homme. Ici, comme dans tous les pays où la motorisation en est relativement à ses débuts, le piéton n’est rien, moins que rien ; il n’a que le droit de sauver sa misérable vie comme il peut.
Ici, les feux rouges sont rares, rares aussi les passages cloutés qui de toutes façons ne donnent aucun droit effectif au bipède sans véhicule. Pour circuler en sécurité, il est bon de posséder une licence en tauromachie et, surtout, surtout ne pas être sourd.
L’automobiliste qui voit un piéton ne ralentit pas, il klaxonne. Si le piéton ne se pousse pas dans les plus brefs délais, c’est qu’il désire mourir, que son âme est pure et qu’il ira donc tout droit dans les jardins d’Allah. Ce ne sera pas un accident, mais une euthanasie, le chauffeur ne sera pas un chauffard, mais un envoyé du ciel.
A noter que la plupart des véhicules, ci, ne sont pas assurés. A quoi bon ? Si un automobileux envoyait un piéton dans les jardins d’Allah, là où il trouvera des jardins parcourus de courants d’eau et des femmes vierges de toute souillure, c’est encore l’écrasé qui serait redevable, non ?
Si le piéton avait une âme noire vouée à la géhenne où l’attendent des supplices éternels, c’est bien fait pour lui. Dieu sait ce qui est en nous…. Ne dramatisons pas. Depuis plus de trois semaines que je vis à Alep, je n’ai pas vu l’ombre d’un piéton écrasé.
Alep n’est pas Le Caire. Les Alepois, faute de conduire très très bien, le font au moins prudemment, et, avec l’aide de Dieu, écrasent très peu de monde, d’autant moins que les piétons connaissent bien la règle du jeu, et savent évoluer dans la circulation comme des toréros dans une arène.
Ensuite, il y a les vélos. Première caractéristique, ils sont au dessus de toute réglementation. Sens interdits, trottoirs jardins publics, le vélo donne accès à tout. Dans les marchés couverts où l’on se côtoie coude-à-coude, les vélos passent aussi, contournant individu après individu, signalant leur arrivée imminente à coup de sonnette, de pouet-pouet, ou simplement à grands coups de gueule.
Sans lois, mais sans droits également. Comme les piétons, les vélocipédistes sont généralement habiles comme des artistes de cirque. L’autre jour, Puce et moi abordions avec circonspection un rond-point dangereux. Un gamin à vélo nous a doublés à fond à fond et a abordé la place à vitesse V+N, une Mercedes noire est arrivée à toute vitesse sur sa droite. Je le voyais mort, le petit Eddy Merckx ; eh bien ballepeau ! A un poil de fesse du char d’assaut made in Stuggart, crac ! il a fait, à grand coup de rétropédalage, un arrêt en travers impeccable, sans oublier d’insulter copieusement le mercedesseux qui avait coupé son élan.
Ensuite, il y a les ânes, attelés ou pas ; c’est un véhicule peu cher à l’achat, économique, d’entretien réduit, et qui met dans la circulation urbaine une fantaisie de bon aloi . Comme chacun sait, cet étonnant véhicule avance généralement quand on veut le faire reculer, recule quand on veut qu’il s’arrête, et met de dix secondes à trois minutes à démarrer au feu vert, ce qui permet aux automobileux qui se trouvent dans la file de contrôler le bon fonctionnement de leur klaxon.
De plus, l’âne est parfois sujet à des rêveries érotiques érectogènes, qui permet à la foule d’admirer avec amusement ou/et envie le très généreux équipement phallique de ce vigoureux animal. Lorsque ce genre de songe le prend à l’occasion d’un arrêt à un carrefour, Ali-beau-rond refuse généralement de repartir au feu vert, pour ne pas interrompre son beau rêve.
D’où rigolade généralisée de la part des badauds au carrefour, flics inclus, et des passagers de la voiture qui attend derrière, au spectacle de l’asinus à cinq pattes. Il n’y a que les automobileux situés plus loin dans la file qui klaxonnent, probablement parce que leur position éloignée ne leur permet pas d’assister à cet édifiant spectacle.
Il faudrait que les zoologues se penchent sur ce phénomène particulièrement digne d’intérêt, à mon avis le copieux appendice zobinatoire de l’âne lui sert aussi de frein de parking.
Les motos…. Il n’y en a pas ou plutôt peu, à la suite de l’interdiction dont je vous ai parlé à Lattaquié. Les seules qui demeurent sont celles des flics et des employés d’état, reconnaissables à leur plaque d’immatriculation verte. Si, il y a une moto privée à Alep ; c’est une 72 cc Yamaha bleue, immatriculée en France dans les Haut-de-Seine. C’est Puce.
Les triporteurs. On en trouve deux genres différents, l’un propulsé par un 50 cc Sachs refroidi par turbine, l’autre par l’antique 500 Guzzi Falcone. Les premiers sont une plaie affreuse. Ils se traînent à quarante à l’heure en pleine colère dans un bruit d’enfer et, à la moindre montée, on les entend hurler à la mort à fond de régime en première, suivis par un nuage de fumée qui ferait pâlir d’envie un employé des P et T iroquois, ceci à la vitesse d’un cul de jatte qui dispute le championnat du monde des courses de lenteur.
Ces ratagaz ont une transmission directe par chaîne, sans différentiel, alors sur les pavés gras de la vieille ville, quand ils tournent un coin de rue, ils ont tendance à se mettre en travers.
Les gros triporteurs, avec le 500 Falcone, Dieu quelle classe ! Ils font résonner les murs de la ville de la noblesse de leur pom-pom. De plus, ils sont souvent décorés à l’arabe, et souvent chargés de fruits et légumes, ils sentent bon.
Après les triporteurs, il y a les Suzuki. Ce sont des mini-camionnettes de 550 kg de charge utile comme Honda a commencé à en importer en France. Des Honda, on en trouve ici aussi, mais peu ? Les p’tits Suzuki ont bouffé tout le marché, on en voit partout. Du coup, on n’appelle pas ce genre d’engin minivan ou mini-camionnette, on appelle ça un Suzuki, tout simplement. Ils sont vraiment jolis comme tout, ces Suzuki, tellement que les Syriens n’éprouvent presque pas le besoin de les personnaliser, c’est dire !
Les Honda sont tout beaux aussi, mais là où les Suzuki les écrasent, c’est pour le bruit. A la place du teuf-teuf du bicylindre quatre temps Honda, un trois pattes deux temps avec un échappement trois en un, je en vous dis que ça, mes chéris. Les concertos pour hautbois de Cimarosa, à côté, sont aussi moches à entendre qu’un duo de marteaux-piqueurs. De plus, pour moi, c’est pratique. Quand j’ai besoin d’huile 2 temps pour ma Puce, je demande …. De l’huile pour Suzuki.
Maintenant, nous allons aborder le véhicule roi des pays que l’on appelle par une douce euphémie « en voie de développement », comme on appelle « non voyants » les aveugles.
Hola ! N’allez pas croire que je regarde les gens d’ici de haut, fort du fait que de chez moâ à Pantruche je peux avoir au téléph’ la Californie ou le Japon en dix secondes alors que d’ici il faut une demi-plombe, si le vent est favorable, pour avoir Damas, qui est à 350 bornes.
Non ! Nous, on a le téléphone automatique, trois chaînes de télé en couleur où l’on peut voir Giscard à toute heure du jour, des machines à laver la vaisselle, mais on n’est pas plus avancé que ça.
Seulement, notre civilisation de riches pour les gens d’ici comme une vitrine de jouets pour un fils de pauvre. Il y a vingt ans, en France, il fallait avoir une automobile pour être quelqu’un, et les en-auto écrasaient les sans-auto de leur mépris de parvenus. Aujourd’hui, ça se calme. Disons qu’ici comme dans beaucoup d’autres pays, c’est comme en France il y a vingt ans.
Allons-y donc pour Sa Majesté l’automobile. Ici, une voiture sur deux est un taxi. Il n’est pas outrageusement difficile de devenir taxi en Syrie, il suffit d’avoir un permis de conduire et une automobile, quelqu’en soit l’âge ou l’aspect. Taximètres ou autres accessoires, fi donc ! On reconnait les taxis à leur plaque d’immatriculation rouge, et au fait qu’ils sont toujours pleins.
Ce sont des taxis « service », c’est-à-dire qu’ils ne prennent que rarement un seul client à la fois. Il y en a partout, quand vous en voyez passer un, vous lui faites signe et lui dites où vous allez. Si c’est vaguement son chemin, vous montez, ça vous coûtera de un à trois francs. Si vous voulez voyager seul, c’est évidement beaucoup plus cher et le prix se discute à la tête du client. Ici, on prend facilement le taxi pour de longues distances, si l’on discute bien, ça revient à dix centimes du kilomètre.
Les taxis longue distance se regroupent dans un point précis de la ville, les chauffeurs assis sur l’aile de leur bagnole, crient leur destination. Il n’y a qu’à s’installer, lorsque la voiture est pleine, on part….
En France, comme les tarifs des taxis sont imposés, si on a le choix, on prend la plus belle bagnole. Ici, c’est le contraire : plus la voiture est moche, plus on a des chances de faire baisser les prix, et des moches, je vous garantis qu’il y en a.
Des seringues de trente ans d’âge, ravaudées, rapiécées, restaurées, dont on se demande ce qu’elles font encore dehors à leur âge.
Sûr, il y en a encore de toutes belles, toutes neuves, des Chevrolet, des Cadillac dernier cri, des VW Golf flambant neuves mais, à cause des taxes d’importation énormes, elles sont si chères que la marché de l’occasion marche le feu de Dieu.
Tout ce qui a quatre roues et un moteur jeune ou vieux vaut son pesant de pierres précieuses. Une 504 Peugeot en bon état est un bijou sans prix. Une Opel Kapitan de vingt ans d’âge dont chez nous on proposerait quinze sacs en faisant la moue, arrive encore à coter ses cinq mille balles. La bonne vieille Ariane Simca est très cotée : beaucoup de place et consommation raisonnable.
Malgré le litre de « super » à 90 centimes, on y pense... Les vieilles américaines diesélisées par les bricoleurs dont l'Orient n'est pas avare, tiennent fermement la rampe, même si elles flirtent avec les trente printemps. Il faut que ça roule et qu'il y ait de la place. Il est aussi essentiel d'avoir un bon... Klaxon !!!
Ah ! Le Dieu Klaxon... Au fil des années, son royaume se restreint. Il est en train, par exemple, de perdre la Grèce. Etrange en effet, mais ces dernières années, les Grecs klaxonnent de moins en moins, c'est à dire encore beaucoup, mais tout de même nettement moins qu'avant.
En Orient, par contre, sa Majesté tient bon. Ici, si une bagnole crache un litre d'huile aux cent mètres par le pot d'échappement, on ne s'alarme guère. Si la moitié des pignons de la boîte gît au fond du carter en compagnie d'une bielle ou deux, tout est encore possible : ça peut attendre.
Mais si le klaxon tombe en panne, il faut se ruer séance tenante chez le réparateur : la patrie est en danger. Vous savez comment se dirigent les chauves souris : elles émettent des ultrasons, qui en se réfléchissant sur les obstacles, permettent de les détecter et d'en déterminer la distance.
Eh bien au Moyen-Orient, c'est comme ça que l'on conduit. Quand on débarque ici, surtout ne pas se dire « moi c'est pas pareil » et rouler en silence.
Si vous ne klaxonnez pas, on en déduira que vous n'êtes pas là, que vous n'existez pas. On vous coupera la route au carrefour, les piétons vous traverseront devant les roues, car avant de franchir une rue, ils ne regardent pas : ils écoutent. Silence égale voie libre.
J'ai essayé la tactique du silence au début. Après avoir failli me faire transformer en pâtée Ron-Ron par un semi-remorque, emmener sur mon garde-boue quatre hommes, sept femmes dont trois enceintes et une portant dix kilos de pain dans un panier en équilibre sur sa tête, onze enfants et un raton laveur, je me suis mis au diapason.
Ma corne de brume à gaz fonctionne à plein tuyau. Pôaâââh ! Pôôôââââh ! Je klaxonne pourtant très peu par rapport à la moyenne, mais si en France on m'entendait pooâââtiser de la sorte on me prendrait pour un dangereux maniaque.
Écoutez, c'est simple : les Syriens klaxonnent tellement... Qu'ils s'en rendent compte !!! Je m'en vais vous le prouver de façon indubitable par une anecdote que je vous garantis absolument véridique. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, comme disait la mère Giroud, même qu'une critique (du Nouvel Obs, je crois) disait qu'elle prenait fichtrement des risques...
Hier au soir, avec mon pote Kha-leb el Absi, on disputait une sacrement velue partie de « Konkin » (« rami » chez nous) on en était comme qui dirait à la balle de match. Khaleb a tenté un coup de Jarnac machiavélique pour me faire morfler cent points.
Sa tactique a foiré comme un filetage de bouchon de vidange en alu quand c'est Cassius Clay qui le revisse avec une clé à œil de deux mètres de long, et c'est lui qui a pris les cent points fatidiques dans les ratiches. Il s'est marré, puis il a jeté ses cartes sur la table en disant « ma zam-mar ! ». Ça veut dire littéralement « ça n'a pas klaxonné ».
Évidemment, je l'ai regardé avec des yeux gros commak, il m'a dit « Ben oui, ça n'a pas klaxonné, ça n'a pas marché, quoi ! Ici, quand ça marche, on klaxonne alors si ça n'a pas klaxonné, ça veut dire que ça n'a pas marché ! »... Ben oui... Évidemment quoi.
Holà ! Ça fait un bout de temps que je bavarde, voilà Naala, la femme de Mamoun, qui commence à mettre le couvert pour le repas du coucher de soleil. Chez nous, on dîne au coucher du soleil, et rebelotte vers onze heures si l'on n'est pas encore couché.
Ce sont toujours les femmes qui font tous les travaux domestiques, dans le coin je n'en connais aucune qui travaille à l'extérieur.Faut pas dramatiser la situation. Une famille de neuf personnes à entretenir pour deux femmes (la mère et la bru) ce n'est la mer à boire, je vous garantis que dans la journée elles trouvent largement le temps de se distraire, d'aller voir les copines, de taper le carton, ce n'est pas l'esclavage.
Mamoun, lui, bosse de 6 heures du matin à 16 heures, et n'a qu'un seul jour de congé par semaine, le vendredi... Ah, chouette ! Y'a du « Foui ». C'est l'un des plats populaires syriens, ça a l'air tout con, ce sont des fèves bouillies avec une sauce faite de lait caillé et d'huile d'olive. Au début, je trouvais ça plutôt bizarre, puis avec l'habitude, je me suis mis à aimer ça comme un fou.
Chez nous, en France, tous les repas tournent autour de la viande. Ici, c'est différent. On peut passer des jours sans en manger. Salade, fèves, gros radis, tomates, piments, on se sustente tranquillosse avec ça, des œufs aussi, soit bouillis soit brouillés et découpés en petits carrés.
Ma foi, jusqu'ici ça va... On mange aussi de la viande deux ou trois fois par semaine, entre autres du poulet. Oh mazette ! En France je n'aimais plus le poulet, parce qu'à force d'engraisser ces pauvres bestioles à toute vitesse avec des substances plus ou moins avouables, on a fini par les rendre totalement insipides ou plutôt insapides, pauvres bêtes !
Des fantômes de poulets. Pauvre Henri IV ! S'il avait pu prévoir, sûr qu'il aurait choisi un autre programme électoral, pauvre homme ! La première fois que j'ai becqueté du poulet ici, ca m'a rappelé une époque lointaine où j'étais vacher au pays basque.
On avait une armada de poultoks nourris au maïs, quand on s'en croquait un, on le faisait rissoler dans une vieille cocotte en fonte, sur les braises de la cheminée, pas avec de l'huile, oh non ! Avec du gras de jambon-maison.
Eh bien en mangeant du poulet à Alep je me suis rappelé que la viande de poultok pouvait avoir du goût. J'avais oublié. A vivre dans mon ghetto parisien j'avais, j'ai oublié des tas d'autres choses encore, j'ai oublié d'en apprendre d'autres, la Puce et moi avons mis la clé sous la porte pour les réapprendre ou les apprendre.
On essaiera de vous les faire partager le plus qu'on peut. Dans quelques jours, on va mettre les voiles d'Alep pour prendre le chemin de Damas.
De là on ira soit vers Bagdad (peu de chances, la frontière irakienne a l'air aussi ouverte au voyageur qu'une boutique de farces et attrapes un jour de deuil national), soit vers la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les émirats du Golfe persique. A Damas reprendra notre guerre des visas.
Avec l'aide de Dieu, on passera...
Alep, samedi
Ça y est. Ce soir je vais quitter Alep. A vrai dire, je devrais être parti depuis avant-hier, puisqu'après cinq semaines de ping-pong entre banques, le fruit pognonesque de mon labeur du mois de janvier est finalement arrivé à la banque du coin.
Ça faisait cinq semaines que profitais de l'hospitalité de mes copains, il était tout de même temps.
Triomphalement, je suis revenu avec mon fric en poche. « Ce soir, je vous offre une nouba des mille et une nuits, et demain je pars à Damas ».
La mère de famille a tout de suite usé de son droit de veto : pas de nouba, tu auras besoin de ton argent pour voyager. Il ne faut pas partir demain, ce soir on est invité chez ma sœur, on va se coucher tard, tu seras fatigué demain. Tu as le temps...
Toute la soirée j'ai ergoté pour pouvoir leur offrir cette fiesta, mais maman Sarminy a été inflexible : « ici c'est moi qui suis ta mère, et ta mère dit de garder ton argent ».
C'est quelque chose, l'hospitalité syrienne... Ici, lorsqu'on invite quelqu'un, ne serait-ce qu'à prendre le café, l'hospitalité est totale. L'hôte, par exemple pose un assortiment de cigarettes sur la table, et il serait plutôt mal séant de fumer ses propres cigarettes.
Vous vous arrêtez pour prendre de l'essence dans une station-service, on vous y offre deux fois sur trois thé et cigarettes. Les Syriens ont l'air d'avoir l'hospitalité dans le sang, on passe presque autant de sa vie chez les autres que chez soi.
Ça les étonne beaucoup quand je leur dis que chez nous, ce n'est pas pareil du tout. Ils me regardent avec des yeux ronds, à part ceux qui ont fait des études en France. Ceux-là savent que Marianne, en s'enrichissant, est aussi devenue égoïste, et que beaucoup de gens y vivent repliés dans leur ghetto personnel, de peur que quelque intrus ne vienne détourner une parcelle de leur petit confort quotidien.
Ça y est ! Je refais ma crise... Je rêve de l'an 01 comme Gébé, le dessinateur, il y a dix ans. C'est vrai qu'il y a dix ans, c'était 68, l'espoir idiot d'une vie plus humaine dans un environnement fait pour l'homme, avec une administration qui soit au service de l'homme, n'importe quoi, quoi...
Des sociologues ont théorisé que le phénomène moto, du moins le « boom » de 1969, était l'une des conséquences de la révolution avortée de 1968. La révolution sur deux roues, quoi, le « pas-de-côté » dont parlait Gébé. Ils ont peut-être raison, les bougres.
C'est vrai que l'on vit dans un pays ghetto, et au lieu de dire qu'il faut humaniser la France, son environnement, son administration, ses flics, on parle de fric, on a Giscard et Babar, Laurel et Hardy, qui conduisent un pays comme on gère une société anonyme.
Merde, la gestion technocratique, ça va bien quand on vend des savonnettes ou des machines à rider les pruneaux, mais quand c'est de l'homme qu'il s'agit, c'est humain qu'il faut être, ventrebleu, au train où ça va, on va tous crever d'ennui, les potes !
Alors, on va faire une virée à moto et bavarder avec les copains pour oublier tout ça. Pourtant, tout ça, c'est fichtrement démocratique. On a voté. De la même façon, la plupart des motards titulaires de licences trouvent que la Fédération Française de moto, de même que son homologue internationale, est un ramassis de vieilles croûtes qui naviguent à côté de leurs pompes.
En fait, si on faisait le compte des officiels importants de la fédération qui font effectivement de la moto, on pourrait les compter sur les doigts d'un manchot lépreux. Pourtant, ils ont été élus, y'a pas ! Les dirigeants de la fédération moto ne font pas de moto, et, je suppose, les dirigeants d'état ne vivent pas, sinon il serait invraisemblable que ca marche aussi mal.
Faut-il supprimer la démocratie, puisqu'on vote aussi mal ? C'est une idée, mais quoi ? Un prophète ? Excellente solution, que ceux qui se sentent à même d'être le prophète du 21e siècle m'écrivent, ils ont gagné. Bon. La crise est passée, parlons d'autre chose, du « Boukra » par exemple...
Le dieu Boukra, est, avec sa splendeur le Klaxon, l'un des grands régents du Moyen-Orient. « Boukra » ça veut dire « demain ».
C'est le sens littéral. En fait, ça veut dire demain, après demain, dans une semaine ou même jamais ». Ici, dès que vous demandez quelque chose d'ennuyeux ou compliqué, on vous dit « Boukra », parce que demain, si Dieu le veut, la terre se sera mise a tourner dans l'autre sens, le soleil se sera rapproché de la lune, et la chose compliquée que vous demandez sera peut-être .. devenue simple.
Quand on vit en un lieu où la vie est plutôt douce, il serait tout de même dommage de se perturber la vie, de gâcher de précieuses minutes de songerie à résoudre le problème au fond sans importance d'un étranger frétillant qui s'affole pour un rien, comme si sa part de paradis en dépendait.
Si vous venez par ici un jour, il faudra apprendre à n'être jamais pressé. Pour ma part, je dois avouer que c'est ce qui ne donne le plus de mal. On ne change pas de civilisation comme ça.
Bon... La Puce est chaîne tendue et bien graissée, plein d'huile fait, j'ai changé mes I ampoules de phares... Tiens à propos, ça a été dur de trouver des lampes standard européen à Alep. J'en ai trouvé... Parce que les Syriens sont vraiment sympas.
Le second marchand chez qui je suis allé, n'en ayant pas, m'a « prêté » son petit commis, qui m'a pris par le bras pour me guider dans le quartier des mécaniciens, dans toutes les boutiques où je risquais de trouver des « culot Bosch ».
Ça nous a pris presque la matinée, car il me fallait aussi des ampoules de compteur et des bifilament arrière, le tout en 6 volts. Il ne m'a pas quitté avant qu'on ait tout trouvé et quand j'ai voulu lui donner un bakchiche, il l'a refusé d'un sourire...
Bref, la Puce est prête. Le chemin de Damas nous attend, on se retrouve là-bas...
Damas, lundi.
Damas, ech-Cham, chamet-ed-denyie, le nombril de l'univers. Nous y voilà.
Les quatre cents bornes de route n'étaient pas longues à faire, en fait pour la plus grande part, c'était l'autoroute, de la vraie comme chez nous mais sans péage, et avec une astuce en plus.
Y'a pas de pétard, les arabes ont du sens pratique. Chez nous, une autoroute est une route très large, divisée en deux par un terre-plein central ou, hélas, souvent par des « rails de sécurité ».
L'autoroute Alep-Damas, par endroits, ce sont deux routes totalement séparées, une dans chaque sens, qui peuvent par fois être à 500m l'une de l'autre. Quand elles se côtoient de très près, à la place du rail métallique, on a mis une tranchée en V de 2 mètres de large sur un de profondeur.
D'une part ça coûte moins cher, et d'autre part c'est plus efficace. Eh oui, aucune voiture ne pourrait passer de l'autre côté de la tranchée même en faisant exprès, d'où pas de risque de collision frontale, et la bagnole qui se flanque dans la tranchée, vu sa profondeur et l'inclinaison de ses versants, ne risque pas de rebondir et de retourner sur la route pour se faire télescoper par ceux qui arrivent derrière, comme ça arrive si souvent avec nos rails de sécurité à la noix. Il y a de l'idée là-dedans.
Aussitôt arrivés à Damas, Puce et moi, nous sommes mis en quête d'un somptueux palace, puisque pour le moment on ne connaît personne chez qui habiter ici.
Le majestueux hôtel « Al Kindi » répondait à nos vœux. Huit balles par jour, il y a moins cher, mais on tient à son standing quoâ !
Blague à part, ici, quand on arrive dans un hôtel pas cher, on ne demande pas « une chambre », mais « un lit ». On voisine dans la chambre avec un, deux ou trois individus qu'on ne connaît ni d’Ève ni d'Adam, la promiscuité ne fait pas peur. Le soir, on bavarde avec ses voisins de chambre, on s'offre des fruits, des cigarettes, on vit ensemble, enfin...
Damas... Damas ne ressemble pas du tout à Alep. Ce n'est pas un village immense, c'est une ville, comme chez nous, avec des avenues larges, des buildings modernes, des feux rouges.
Oh, c'est arabe tout de même, mais après Alep, j'ai l'impression d'être revenu en arrière. Ici, je ne ressens pas autant la « jouissance ». Il faut que je vous explique ça. Quand je suis loin de chez moi, ou plutôt de ce qui était chez moi, il me vient de temps en temps des « flashes »...
C'est difficile à expliquer, je vais vous en raconter un. Il y a une semaine, à Alep, on donnait un film français, « Le Juge Fayard ». Mes potes m'y ont emmené. Comme presque tous les films étrangers qui passent en Arabie, celui-là était en version originale, donc en français, sous-titré en arabe international.
Donc pendant deux heures, je me suis retrouvé en France. Quand on est sorti du cinéma, plaouf ! J'ai pris Alep en pleine poire : les marchands de gâteaux, de chaussettes, de trucs et de machins qui s'égosillaient sur le trottoir, l'architecture de la vieille ville, les hommes en keffieh, des femmes voilées de noir.
Tout à coup, la lumière m'a paru irréelle, je ne savais plus où j'étais. Je sentais la terre ronde sous mes pieds, j'étais une chiure de mouche perdue sur un point de son immensité, ça a duré une éternité de secondes puis je me suis dit, mais oui, Alep, Syrie, et je me suis senti une petite partie du monde...
Maintenant ça fait un bout de temps que l'on bavarde ensemble, que j'ai pour univers une table en marbre, un cahier, un bloc-notes, un paquet de clopes et un briquet, j'écris en français, je ne suis nulle part.
Tout à l'heure, quand j'aurai trop mal aux doigts pour continuer à vous écrire mes salades, je vais aller casser la croûte. Quand je vais sortir et me retrouver dans l'avenue El Nasr, sûr ça va me faire le coup. C'est un pied fantastique.
A parler de manger, je commence à avoir faim. Avant de remiser mon stylo, je vais vous expliquer où je suis. C'est un bistrot, avenue El Nasr, entre la gare du Hedjaz et l'immeuble des télécommunications.
Rien à voir avec un bistrot de chez nous : on n'y vient pas vraiment pour boire. On ne sert que de l'eau (gratuite), du thé et du café (90 centimes). On y vient pour se détendre, ou pour passer un moment loin de sa femme. Il n'en vient jamais ici.
Le truc est grand comme un hall de gare, il y a une centaine de tables, et dehors on trouve une terrasse couverte, à peu près de la même taille. Ce n'est pas luxueux pour un sou, des tables en fer forgé et marbre plutôt ébréchées.
On entre là-dedans, et l'on s'installe. Si l'on ne veut rien, on ne demande rien et personne ne vous ennuie. Ça doit faire deux heures que je scribouille dans mon coin, personne ne m'a demandé ce que je fais ici. Des gamins circulent avec des plateaux chargés de verres d'eau, en criant « mayy ! mayy ! » (eau ! eau !). Si l'on en veut, un geste du doigt, à votre santé.
Un garçon déambule avec du thé et du café, même principe. Idem aussi pour le narguilé, les cigarettes de contrebande (Kent, Marlboro Winston, Rothmans, prix unique 2 F), les cireurs de chaussures (1 F), si l'on veut se distraire, on loue pour 1 F, durée indéterminée, un sous-main et un jeu de cartes ou de Jacquet, et l'on reste là, le temps qu'on veut.
Tiens, pour voir, je suis allé demander l'heure à un voisin qui joue au tarni avec ses copains, ça fait trois heures et demie que je suis assis ici. Je vais tout de même commander un verre de thé...
Damas, mardi.
Je suis revenu au bistrot d'hier pour gamberger tranquille. La situation se complique : pendant que je traînais en Syrie, mon visa pour les Émirats Arabes Unis s'est périmé. Pour me le renouveler, le consulat me demande une lettre de recommandation diplomatique plutôt duraille à obtenir. Je viens de tubophoner a Paris pour demander à un copain de tirer les sonnettes, il ne faut pas que je me retrouve dans le même traquenard qu'en Égypte, il y a quatre mois. Nom de Dieu, il faut que ça passe...
Si mon visa pour les Émirats menaçait de se périmer, pourquoi ne suis-je pas parti plus tôt d'Alep ? Parce que, pour prendre la route, j'y attendais de l'argent. Pourquoi a-t-il mis des semaines à venir ? Parce que j'ai demandé par téléphone que l'on me vire de l'argent à la succursale N° 2 de la Banque Commerciale de Syrie à Alep, Syrie, et que ça a été interprété par quelqu'un pas trop fort en géo ni en politique mondiale comme « succursale N° 2 de la Banque Commerciale du Chili à Alep, Syrie », comme si une banque d'une dictature d'Amérique du sud allait s'amuser à avoir deux succursales dans un ville d'un million d'habitants d'un petit pays copain avec Moscou et situé à sept méridiens de distance. On croit rêver, hein ?
J'ai beau essayer de me dire, comme les philosophes stoïciens, que ce qui ne dépend pas de moi ne doit pas me toucher, ça me fait caguer, cette histoire de visas. Si le verrou saute, à nous les trois ou quatre mille bornes de désert de Amman à Dubaï.
De la route, de la route, mon royaume pour un bout de bitume. Il faut arriver à Karachi. Après, on sera tranquille pour un bout de temps. Pakistan, Afghanistan, Inde, les chemins ne manquent pas.
Si les Émirats refusent, il reste une solution, une seule : l'avion pour Karachi. La Puce connaît bien l'avion, elle l'a déjà pris deux fois avec moi, une fois Damas-Paris, une fois Paris-Abidjan. Le problème est le prix, que je situe dans les deux cent cinquante sacs, qu'évidemment, je n'ai pas en poche... Tiens, au lieu de me morfondre, je vais aller vérifier combien ça coûte... Je reviens tout de suite.
Excusez-moi... Vous êtes toujours là ? Oui je sais, ça a pris longtemps, mais j'ai fait du démarchage agence après agence pour trouver le meilleur prix. C'est dingue, les différences qu'il peut y avoir. Pour moi seul, la plus mauvaise offre (P.I.A. Pakistanaise) est de 1345 livres (à peu près autant de francs français) et la meilleure (ALIA Jordanienne) 874 livres.
Quant à ma Puce, c'est 8 livres 40 piastres le kilo, ça ferait dans les 1 600 balles à nous deux, si notre fourberie diplomatique tombe à l'eau, il n'y aura plus qu'à emprunter des sous à Motocanard pour pouvoir faire le saut. Sincèrement, ça me ferait chier ; j'aimerais bien offrir à ma Puce la traversée d'un des plus grands déserts du monde, le Nefoud, « l'enclume où le soleil frappe ».
La vie, c'est tout un tas de petits détails, je vais vous en conter un qui vous fera peut-être un peu mieux sentir comme, là où je suis, c'est différent de chez nous.
Dans le bureau de la PIA, j'ai éprouvé le besoin d'allumer un clope. J'ai fouillé dans mes poches et je n'ai pas trouvé mon briquet. J'ai laissé tomber, et suis sorti avec ma cigarette éteinte au bec. Et alors ? Et alors un passant m'a arrêté dans la rue pour me demander si je voulais du feu, et m'a allumé ma cigarette. C'est idiot, mais c'est la première fois que ça m'arrive...
Damas, samedi.
Les négociations diplomatiques sont en cours. Mon sort, celui de notre voyage à Puce et moi, doit être en train de se discuter à Paris. Selon qu'un homme comme vous et moi, un être humain avec deux bras, deux jambes et quelques accessoires autour, décroche son téléphone, dicte un télégramme ou se croise les bras et dit non, Puce et moi avons le droit ou pas de nous enfourner -c'est le mot juste- dans le Nefoud.
C'est rue Boileau à Paris que notre sort se joue, et je suis assis sur un banc, dans une petite rue à arcades abritée du soleil, près de la mosquée des Omeïades, à Damas, Syrie.
C'est à 5 000 kilomètres de nous que se prononcera le « oui » ou le « non » fatidique. Si c'est un « oui », il va courir le long de quelques milliers de kilomètres de fil électrique pour nous parvenir.
Ici, il est à peu près cinq heures et demie, le soleil commence à se coucher. A Paris, il est quinze heures trente, et peut-être est-on en train de prononcer le « oui ou le non » qui nous concerne.
Seulement, on est si loin, nous, ce n'est pas le haut parleur de la mosquée qui peut nous le dire. Je lève le nez vers le minaret de pierre sculptée de la mosquée... Le sais-tu, toi ? Nom de Dieu ! Oh pardon... Voilà le haut parleur du muezzin, là haut, qui me répond « Allah-w-akbar ! » (Dieu est grand). Normal, c'est l'heure de la prière du crépuscule. N'empêche que sur le coup ça m'a fait un drôle d'effet...
Bon les gars, demain c'est dimanche, ce n'est pas férié ici, mais en France, ça l'est. Ce n'est donc pas demain que je peux espérer une réponse. Peut-être après-demain, peut-être plus tard, ce n'est pas de moi que ça dépend, hélas.
Si Socrate vivait à notre époque, on n'aurait pas eu besoin de le condamner à mort, il boirait la cigüe sans qu'on le lui demande, pour échapper au traquenard. Ça me rend hypocondriaque, ces salades...
J'en ai eu marre de poireauter à Damas, alors j'ai mis le cap sur le sud, vers Amman, en Jordanie. Au passage, je suis resté une nuit à Jérash, le plus fabuleux site Romain que j'aie jamais vu, parce qu'il est perdu dans la nature, sans guichets, sans guides bidon, sans marchands de cartes postales, sans rien.
J'y étais déjà passé il y a quelques années, mais je n'avais pas eu la patience d'attendre que les fantômes des Romains apparaissent. Cette fois, Puce et moi, on s'est blotti entre deux colonnes d'une maison pour attendre leur arrivée. Évidemment, ils sont venus, mais ils ont attendu que l'on dorme. L'essentiel est qu'ils sont venus.
J'ai aussi récolté une spécialité des nuits de printemps dans le désert : la grippe. C'est un peu embrumé qu'on a pris, au petit matin, la route d'Amman. Sacré dédale. Amman. C'est une ville mi-moderne mi-classique arabe, construite sur cinq collines : djebel Amman, djebel Luweibdeh, djebel el Hussein, djebel el Hashrafiya, djebel el Hashemiye...
Des noms qui fleurent bien l'Arabie. Seulement, un dénominateur commun avec la Syrie, cartes, plans, sont des choses mystérieuses. On en trouve dans les coins à touristes, mais si vous mettez un plan de sa ville sous le nez d'un autochtone même paraissant cultivé, il sera la plupart du temps incapable de vous y indiquer quoi que ce soit.
Je voulais aller directosse à l'ambassade des Émirats Arabes Unis pour tenter d'obtenir le renouvellement de visa qu'on m'avait refusé à Damas. Après une heure d'errance, il a fallu que je demande à un taxi de m'y précéder.
Hélas même trip qu'à Damas. Visa périmé, aucun espoir d'en avoir un autre. J'ai levé les voiles et suis allé tenter une nouvelle fois l'Irak. A Paris, délai un mois et demi, acceptation improbable. Idem à Damas. Le moins que l'on puisse dire est que l'Irak est loin, très loin d'encourager les visiteurs.
Ici, à Amman, on me parle de trois semaines à un mois. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? Je demande les formulaires, la dissuasion continue. On me tend deux formulaires « un à rempli en anglais et un en arabe ».
Aah ! Ils croyaient me faire mollir avec ça ? J'ai pris un stylo à plume et ai commencé à remplir mes paperasses en anglais et fi-l’Arabi.
Ça fait grosse impression. Langue entre les lèvres comme un potache, je suis arrivé au bout de mon pensum, et ai tendu triomphalement mes deux pages en arabe probablement bourré de fautes d'orthographe, mais ça fait moins touriste.
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Par la même occasion, j'ai demandé un visa japonais. Excellent accueil au consulat japonais : Thé, café, hôtesse (jordanienne) très gentille et appétissante, mais par contre, côté tatillon...
Ils ont voulu savoir tout sur moi, le nom de mon père, de ma mère, de mes oncles, la date de ma première crise de puberté, mon dossier scolaire, ils voulaient toujours en savoir plus. Cinq fois, ils ont téléphoné à mon hôtel pour avoir de nouveaux renseignements. Ça prouve au moins qu'ils s'en occupent...
J'ai élu domicile à l'hôtel Halton (mais non, pas Hilton...) sur djebel el Luwebdeh. Petit hôtel peinard, plus genre pension de famille qu'hôtel de transit. Le lendemain de mon arrivée on toque-toque à ma porte.
C'est à vous la jolie Yamaha bleue avec des boîtes en plastique sur les côtés ? -oui, elle est à moi... -combien voulez-vous la vendre ? -44 billions de dollars, pas un penny de moins. - ????
-comprenez-moi, j'aime cette moto. Je l'ai depuis trois ans, ensemble on a fait près de 30000 km dans quinze pays différents. Je veux bien la vendre, mais c'est 44 billions de $ ou rien.
-Ah bon... »
Les trois gars sont repartis déconcertés mais pas fâchés, depuis on est devenu copains, surtout avec Abd el Laziz (son nom veut dire, comme tous les noms arabes commençant par Abd el « esclave de Dieu », mais pour diversifier les plaisirs, on nomme Dieu par une de ses qualités, ici « le délicieux », mais comme Dieu est aussi clément, miséricordieux, juste, enfin a toutes les qualités, cela fait autant de prénoms possibles).
Abd el Laziz ne m'en a donc pas voulu, au contraire nous sommes devenus très amis. Il m'a fait connaître la vie des motards à Amman, capitale de la Jordanie. Une vie faite de difficultés et d'innocence.
Quelques gars ici aiment la moto, mais ils sont si loin des Mecques européennes, japonaises, américaines de la moto, qu'ils en ont une vision aussi floue et innocente qu'une fille de trois ans de l'amour à la lyonnaise.
On va prendre un exemple : au cours d'une discussion, Laziz me demande pourquoi d'après moi Honda ne court plus en Grands Prix moto. Je lui explique que le moteur quatre cylindres deux-temps moderne, léger, très puissant, est depuis plusieurs années, devenu plus performant que le quatre -temps, et que Honda, étant le roi du quatre-temps, ne peut raisonnablement pas courir d'un bout du monde en GP avec des cylindres à trous.
Justement, j'avais sous la main un vieux numéro de Moto Journal annonçant « une moto d'usine pour Sarron ». Je lui montre une photo de la Yamaha YZR 500 et lui dis : « voilà, cette année, cette moto était strictement imbattable ».
Mais, -me répond-t-il, il y la Grombli italienne qui est plus rapide...
-Tu veux dire la Emmevi (M.V.) ?
-N
Dernière édition par cobalt57co le Mer 16 Jan 2013 - 22:45, édité 2 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Amman, vendredi.
Encore un vendredi, une semaine passée à Amman. Je sais qu'aujourd'hui est vendredi parce que la plupart des boutiques sont fermées. Hier, après un trajet compliqué Paris 15e, Paris 1er, New-York, Amman, le fruit de mes déconnades du mois dernier plus une avance sur imbécilités à venir m'est parvenu.

Je vais quitter demain Amman pour aller plus au sud, en attendant que les gouvernements irakien et saoudien statuent sur notre sort à Puce et moi. Aujourd'hui, sous les yeux émerveilles du mécano de chez Kawa, j'ai révisé la Puce. Je dois admettre que ces deux derniers mois je l'avais plutôt négligée. Pas rancunière elle roulait toujours, mais commençait à griller des fusibles.
Cause ? Relais de clignotant détruit provoquant des court-circuits intermittents. C'est un scandale, une moto qui n'a même pas quatre ans, moins de trente mille kilomètres et n'a fait qu'une seule fois le Côte-Côte, deux fois seulement la Syrie et la Jordanie et a été soigneusement conservée le reste du temps dans un garage humide, me faire ça !
Bref je suis content d'avoir trouvé le truc. De joie, j'en ai même réparé une chambre à air qu'un clou ravageur m'avait perforée en Egypte. J'ai fait ça dans ma chambre, j'ai eu tort. Chez Kawa-Amman, ils m'ont vendu des rustines vulcanisantes « Camel » canadiennes. Trente Balles la boîte de dix avec la presse à vis parce qu'il faut une presse métallique pour ces trucs-là.
Vous allez comprendre. Le mec m'explique : tu mets le machin sur ta chambre à air après avoir enlevé la pellicule protectrice. Le machin, la rustine, est une feuille en alu rectangulaire avec sur une face une matière grisâtre. Tu mets la presse, tu serres, après t'approches une allumette de ce truc gris et t'attends un quart d'heure... Mazette, je ne savais pas ce qui m'attendait.
Cette fameuse matière grisâtre ressemblait à de la stéarine à bougies que l'on aurait mélangée à de la cendre. Je me suis dit que ce devait être une sorte de colle solidifiée, alors je suis allé faire ça dans ma chambre, parce qu'il y a un lavabo et que c'est commode, un lavabo plein d'eau, pour voir si une réparation de chambre à air fuit ou pas.
J'ai fait exactement ce qu'on m'avait dit. La pellicule protectrice, la presse, l'allumette... Le truc a pris feu. Pas un petit feu mesquin style lampe à huile, non, le 14 juillet, le feu de Bengale, et une fumée, les potes ! Effrayant !
Je me suis précipité pour ouvrir la fenêtre avant de n'y plus rien voir. Seulement la fumée s'évacuait mal, à cause de la moustiquaire que l'on ne peut pas ouvrir. Et la puanteur, les mecs ! Je n'osais pas sortir de ma piaule pour de peur d'enfumer tout le monde...
J'ai patiemment craché mes poumons jusqu'à ce que ça se calme. Parole, ça puait tant la poudre ou le je ne sais quoi, que si j'avais ouvert ma porte on aurait cru à une attaque de commando avec grenades fumigènes.
Ça pue encore maintenant, quatre heures après, et il y a de foutues traces de brûlé par terre. Quelle émotion, les potes ! En plus, c'est pas génial comme réparation, la rustine est trop épaisse et n'adhère pas tant que ça.
Du coup j'ai monté cette chambre là sur la Puce pour voir si ça tient. Cela dit, j'aime mieux les « Rema » allemandes à bords minces, elles collent bien et il n'y a pas besoin de foutre le feu à la maison pour s'en servir. Faut dire que les fridolins ont assez du groupe Baader Meinhof pour se passer de rustines « Septembre noir »...
Demain, la route de nouveau, les potes ! Je biche comme un pou. Les cités du désert, la mer morte, la mer Rouge, on a du pain sur la planche avant, j'espère, de tailler la route de nos rêves : celle du pipe line qui va du désert de Syrie via le Néfoud jusqu'au golfe Persique.
Hélas, si on pourra la faire, ça ne dépend pas de nous. Rendez-vous à la mer Morte ou Rouge, selon ce que Dieu voudra. .. Après, bien sûr, on verra...
Akaba, jeudi
Ça y est. Nous voilà dans le sud de la Jordanie, devinez ce que j'entends et vois sur ma droite ? La mer Rouge qui chantonne, et des bambins tous nus qui se baignent, avec comme bouées de vieilles chambres à air de camion.
Il fait une chaleur de tous les diables. C'est déjà rigolo d'être au bord de la mer Rouge, mais ce qui l'est cent fois plus, c'est la façon dont je suis arrivé ici. Mon idée de départ était de passer d'abord à Wadi Musa voir mon pote Mohammed Issa Falahat, puis éventuellement pousser sur Akaba.
Eventuellement seulement, parce que Akaba est à la Jordanie ce que St-Tropez est à la France, et j'avais peur qu'en avant-saison l'auberge de jeunesse ne soit pas ouverte. De ce côté-là, j'avais encore plus raison que je ne le croyais.
Akaba est en pleine modernisation, l'auberge de jeunesse a été rasée l'an dernier. Arrivés la nuit dernière, Puce et moi avons longtemps erré dans la ville, longeant les « Holiday Inn » et autres « Akaba Hôtel » dont le prix de la nuitée représente notre budget d'une semaine.
On a fini par trouver ce qu'il nous fallait, l'hôtel « Les Poissons » à un Dinar (13,70 F) la nuit.
Alors ? Pourquoi Akaba direct, hé pomme ? Par erreur.
Parce que Puce et moi n'avons pas trop le sens de l'orientation, et que l'on a une sale manie : quand on est engagé dans une route, même si ce n'est pas la bonne, on ne fait pas demi tour. Le côté tête de mule, quoi.
Bref, on avait projeté de partir dans la matinée d'il y a cinq jours, direction Wadi Musa. On a dû ajourner deux fois. La première parce que le diaphragme du Yashica 6x6 à compresseur qu'on a acheté d'occase à Amman pour remplacer le Nikon qu'on m'a volé à Damas a coulé une bielle, heureusement, on a trouvé un réparateur à la coule, et le particulier qui nous avait vendu le machin a payé la réparation sans même qu'on ait eu à le lui demander.
Le lendemain, orage gigantesque sur Amman. Le surlendemain, à dix heures, Puce était fin prête, on allait lever l'ancre, coup de fil du consulat du Japon « on a encore une mouche à sodomiser, pourriez-vous venir nous aider ? ».
Bref ils voulaient encore savoir quèque chose rapport à mon visa, car j'ai demandé un séjour long. Heureusement qu'ils sont polis, gentils et accueillants au consulat japonais, parce que dans le genre tatillon... Parole !
Bref on est parti à 15 heures, avec dans l'idée de faire le plus de chemin avant la nuit. On ne savait pas partir au devant de 48 heures de vie intense... La nuit a commencé à tomber alors que Puce et moi étions à une trentaine de bornes d'Al Qasr.
Sur ces plaines élevées du nord de la Jordanie, la tombée de la nuit, c'est quelque chose. L'air étant très sec n'a aucune « inertie calorique ». En l'espace d'une heure la température passe de 30-35° jusqu'aux proches alentours de zéro. C'est pour cela que depuis mon arrivée en Jordanie, je n'ai pu me défaire de ma grippe. Elle devrait finalement guérir, au bord de la mer.
Sitôt la nuit tombée, un vent à décorner tous les cocus de la terre s'est levé en plein dans notre nez. A 45 à l'heure en troisième, le nez sur le guidon, qu'on avançait, Puce et moi.
A El Qasr, on s'arrête faire le plein, le pompiste sert la tisane de la Puce et m'emmène me réchauffer dans sa guitoune. Thé chaud, le poêle à mazout qui ronfle, joie. A tout hasard, je lui demande si «fifendo' bel-balad, rhisyaani » bref s'il y a un hôtel, « c'est-à-dire pas cher » dans le bled.
Hôtel il n'y a pas, mais veux-tu venir chez moi ? » De nouveau l'hospitalité arabe. En cinq sec je me retrouve dans une maison, près du poêle, et comme j'ai eu très froid, choc du changement brutal de température, on m'allonge, on me couve, et je m'endors deux heures.
Après, repas, veillée, jeu de cartes (rami, qui s'appelle « konkin » en Syrie et « tcheddé » ici) et bien sûr, comme je suis l'invité, le meilleur lit. On dort à six dans la même pièce, c'est l'Arabie ! Pardon ! Sept, mes amis ont fait entrer la Puce dans la pièce de peur qu'elle ne prenne froid dehors.
Pourquoi tout ça ? Pour rien, Monsieur Fayz, mon hôte, n'est pas assez riche pour venir un jour en France afin que je puisse lui rendre son hospitalité. Non, me dit-il, mon père faisait pareil, aussi mon grand-père, c'est la tradition !
Le lendemain matin, on m'offre un énorme petit déjeuner pour que je n'aie pas faim en route, et c'est reparti. On arrive, Puce et moi, dans des paysages dantesques, lunaires. On traverse Kerak plein pot, et l'on prend la route qui nous paraît être la « King's highway », route du Roi, qui va à Akaba via Wadi Musa.
Plus on avance, et plus le paysage devient dément. Une très longue descente s'amorce, je ralentis pour passer au point mort, et voilà trente kilomètres de descente en lacets dans un paysage de fin du monde, moteur arrêté, ma chaîne ne fait presque pas de bruit, elle a pris un bain de graisse graphitée à Amman, on se déplace comme un tapis volant, je crois rêver. Au bout de la descente, une guitoune, deux militaires, N 16 en bandoulière, me font signe de m'arrêter « As-tu un laissez passer ? ».
Un quoi ? (Je ne connais pas ce mot). On me montre un exemplaire du truc, « va la police, à sept bornes d'ici par ce chemin ils te le donneront ».
Je suis donc allé chercher mon fameux papier, en me demandant pourquoi diable il fallait un sauf-conduit pour prendre la route du Roi, qui est 1a Nationale 7 de la Jordanie...
J'ai ensuite repris la route, sans s'avoir qu'elle n'allait pas à Wadi Musa mais vers l'aventure.
Trente bornes plus loin nouveau contrôle cette fois-ci la police du désert. Des bédouins longilignes, gallabiah kaki, keffiel à damiers rouges et blancs, Smith et Wessoi chromé à la ceinture, et la poitrine bardée pour décorer de cartouches de 7,62 NATO.
Impressionnant les mecs, je vous l'assure.
« Combien de kilomètres pour Wadi Musa '.
-Cette route ne va pas à Wadi Musa, mais directement à Akaba, à 180 kilomètres d'ici..
-Où trouve-t-on de la benzine ?
-Nulle part avant Akaba ».
Je me maudis de ne pas avoir fait rempli mon jerrican de secours à El Qasr ou à Karak, mais sur la King's highway, il y a théoriquement une pompe toutes les 50 bornes, quexè que cette affaire ?
Ca ne fait rien, ici c'est l'Arabie, un automobiliste sort un tuyau, siphonne sa Datsun et me remplit la Puce à ras bord. Je veux lui payer l'essence, il repousse mes sous, ma léééch ! C'est la solidarité du désert.
Nous voilà prêts à repartir, un, deux, trois coups de kick, la Puce ne part pas. A vrai dire ça faisait déjà un moment qu'elle rechignait.
Alors, puisque j'étais à l'ombre, j'ai fait une vérification générale. Allumage, carbu échappement, tout paraît OK, la Puce avance mais avec peu près autant de chevaux qu'un âne mal nourri.
J'ai tout vérifié, rien de rien Entre temps, les « redoutables » bédouins de la police du désert m'ont invité à prendre le thé (la boisson idéale lorsqu'il fait chaud) et m'ont dit « Si ça ne marche pas, on arrêtera un camion, et on lui demandera de t'emmener avec ta moto à Akaba ».
En fait à force de tripatouiller les réglages de carburation, j'ai fini par obtenir une Puce qui n'avançait pas bien mais avançait. Tout en bricolant, j'ai demandé aux policiers du désert s'ils pouvaient me vendre un paquet de clopes, évidemment, ils me l'ont donné, pas vendu, qu'est-ce que vous croyez ?
Quand Puce et moi avons quitté les bédouins de la police du désert, il était quatre heures passées.
Aucune chance de parvenir à Akaba avant la nuit. Bah, y'avait qu'à continuer. Le seul mauvais moment est entre chien et loup : il fait encore trop clair pour que le phare soit efficace, mais pas assez pour voir clairement où se trouve la route, perdue dans le sable et le cailloutis du désert.
Ça y est, il fait nuit noire. A 70 bornes d'Akaba, les phares d'une Land Rover garée dans le sable s'allument à mon approche. Contrôle militaire. Mais bordel quéxè que cette route d'Akaba sans escale et truffée de contrôles ? Militaire, fusil M16, papiers, où vas-tu ? Tu as froid ? Viens ! On me prend par le bras parce qu'on n'y voit guère, et que le campement, quatre griffetons avec une Land Rover, est planqué dans un creux de terrain. Feu de camp, thé chaud, on va chercher un siège dans la Land pour que je sois mieux installé.
-Ya ahi, Mon Frère, pourquoi y a-t-il tant de contrôles sur la route ?
-Tu sais où tu es ? Non tu ne sais pas... »
On me montre des lumières au loin de l'autre côté de la route.
« Là-bas, Israël ! »
Bon sang mais c'est bien sûr, J'ai tout bitte d'un seul coup, le laissez-passer obligatoire, les contrôles sur la route. Route du Roi, mes fesses ! J'ai pris la route frontière dite route interdite entre la Jordanie et Israël, qui du coup ne figure pas sur ma carte touristique, nom de Dieu !
Heureusement qu'ils n'ont pas repris la guerre pendant que j'étais dessus... J'ai eu envie de faire une photo de notre bivouac avec la Puce, la Land, les soldats Jordaniens et moi, mais j'ai eu un peu la trouille que de l'autre côté ils prennent l'éclair de mon flash pour un départ d'obus de mortier, et me fassent des trous dans la Puce.
De plus, on m'avait toujours dit de ne pas photographier des trucs militaires. Si les bidasses laissent faire, il peut toujours se trouver un gradé qui les fasse caguer par la suite. Dommage, c'était folklo, les quatre soldats, la Puce et l'envoyé spécial de Moto-canard au bout du monde, en train de boire le thé autour du feu de camp, le long de l'une des frontières les plus « chaudes » du monde, et ceci par pur hasard...
Si vous saviez comme j'ai joui de cette situation bizarre... Les soldats me versaient toujours du thé chaud, tu te sens mieux ?
On a fini par repartir. Carburation toujours pourrie, la Puce redémarre poussée par les soldats. Dernier contrôle avant Akaba, à sept kilomètres. Je sors mes papiers, les gars du poste sont en train de dîner, que croyez-vous qu'il arrive ?
Tfaddal, c'est la tradition, mange avec nous ! J'ai donc mangé avec eux, mouton, tomates, riz. Je me suis dit que c'était vraiment bon d'être dans un pays hospitalier, que... La situation me faisait bidonner intérieurement : imaginez chez nous, que vous dérangiez un poste de police ou de douane à l'heure du dîner, pensez-vous vraiment qu'ils vous inviteraient à leur table ? Ben, c'est-à dire que... C'est pas la tradition quoi ! Vous n'imaginez pas un fonctionnaire de la République Française, gradé et tout, se comportant comme un bougnoule ?
Dans un pays qui se respecte, les forces de l'ordre sont là pour faire régner l'ordre, Môssieur, pas pour nourrir les petits cons qui font les clowns sur leurs petites motos. D'abord, vous avez vos papiers ?
Excusez-moi, je faisais des suppositions, comme ça, pour rien, avant qu'on ne peigne sur les cerveaux des enfants, à leur naissance, « défense de supposer, loi du 18 juillet 1981 ». N'empêche que j'ai gardé « ça » en souvenir. « Ça », c'est un bandeau de paquet de cigarettes « Gold Star » eh oui ce sont les « gauloises » jordaniennes, et elles ont un nom de moto.
Ce bandeau là est le sceau militaire, comme sur les « Troupe ». J'en ai eu deux comme ça, deux paquets de clopes offerts l'un par un bédouin de la police du désert, l'autre par la patrouille militaire. Je les ai gardés en souvenir, en même temps qu'une belle image au fond de ma tête, parce que ce n'est peut-être pas de sitôt qu'où que ce soit, une patrouille militaire me fera ainsi partager sa bouffe, son thé, son feu de camp et ses cigarettes.
Akaba, samedi...
Je suis allé faire un tour dans la ville. Trois ans après, j'en avais tout de même gardé un vague souvenir. C'était un petit bled avec ses vieilles maisons, ses vieilles échoppes de mécanos rois du flambard, eh bien je n'ai rien retrouvé.
« Ils » ont tout rasé, et ils ont fait tout neuf, ce n'est pas vilain mais ça n'a plus l'air habité. Des boutiques et des hôtels, il n'y a plus que ça, à Akaba ! Tout bouge, tout bouge... Moi aussi du coup je vais bouger. Je vais remonter vers le nord voir si Wadi Moussa existe encore...
Akaba, lundi
Je vous ai raconté que la Puce n'avait rallié Akaba qu'à grand peine : elle était devenue ignoblement poussive 30 bornes après El Karak. J'avais mis ça sur le compte de l'altitude moins trois cents et quelques mètres du point où les ennuis ont commencé.
Cette théorie ne valait guère tripette, altitude négative égale pression atmosphérique supérieure à la normale, donc la Puce aurait dû être pauvre en essence, alors qu'elle fumait comme un incendie de forêt, ce qui diagnostiquait exactement le contraire.
Maintenant ici à Akaba, mesdames messieurs, altitude négative mes fesses. Je puis vous dire exactement l'altitude à laquelle Puce et moi nous nous trouvons à cette heure. Ne bougez pas. je reviens... Un mètre soixante...
C'est la hauteur de l'escalier qui, en face de nous, descend de la terrasse du café-restau à la mer Rouge. Or, la mer Rouge est au niveau de la mer ou sinon ce ne serait plus tellement une mer, mer d'alors !
J'entends un cartésien qui objecte que la mer Morte dont on vient est en-dessous du niveau de la mer. Une mer en-dessous du niveau de la mer, c'est un peu fort, tout de même, pire que la différence entre un canard. Vous la connaissez ? C'est qu'il a les deux pattes de la même longueur, surtout la gauche.
Quoiqu'il en soit, on est à 1,60 m d'altitude donc la Puce devrait, avec son gicleur de 92, être un peu pauvre sans plus. Hier soir, j'ai encore refait mon point d'avance et descendu l'aiguille du boisseau de carburateur d'un cran pour appauvrir un peu la carburation à petite ouverture de gaz, et je suis allé me coucher en me disant que ce matin, en Allah rad, ça marcherait.
Ce matin, macache, ma zammar, la Puce a bien démarré, mais avec un vilain bruit creux de pétrolette gavée, un bruit qui m'a rappelé... Une vieille 250 Jawa tchécoslovaque que j'avais achetée cinquante Balles il y a une onzaine d'années, et dont... les joints d'étanchéité du vilebrequin, dits joints spi, étaient morts.
Joint spi morts ? Pas fou non ? Puce a fait dans les 25000 bornes avec son premier jeu, ceux là ont été changés à Sète, ils ont donc à peu près six mille bornes...
Puce est poussive au possible, quasiment incapable de tenir sa quatrième vitesse, sans aucune souplesse, et puis... mais oui ! la boîte claque à chaque changement de rapport. De quand date l'huile de boîte ? Ahum... grosso modo 6 000 bornes, je ne la change que tous les 36 du mois, partant du principe que je suis très délicat avec les boîtes de vitesses que je fais extrêmement peu patiner mon embrayage.
Or, à part la poussière de garnitures d'embrayage, qu'est-ce qui salit l'huile de boîte d'un deux temps ? Rien, Madame. Bon, de toutes façons je dois faire le plein d'essence, hé bien on va vidanger en même temps... Bizarre.
Jordan Petroleum Refmery », annonce l'enseigne d'une station-service avec un petit atelier de réparation en coulisse. Je fais faire mes pleins, réservoir et nourrice de secours, puis « Est-ce que je peux acheter de l'huile quatre-temps en demi-litre ? » Non ? Bon, je voudrais une boîte d'un litre de 20/40 et la bouteille de Pepsi, là. La bouteille de Pepsi libanaise me sert de doseur par ici, elle fait 25cl.
A tout zazard, je sors ma jauge de la trousse à outils et je contrôle le niveau avant de vidanger. Merde ! Il en manque. Comme dirait l'autre, un ange passe, un joint spi entre les dents. Ben non, d'habitude je ne le contrôle jamais, mon niveau d'huile de boîte, c'est pas une moto anglaise ma Puce !
Dans le temps, je contrôlais, mais comme ça ne bougeait jamais... Comme a dit le cardinal Bel-figo « à quoi bon continuer à draguer une personne dont on sait qu'elle n'a pas de trou ? ».
N'empêche que ce coup-ci, il y a un trou. Où ? Joints spi ? Bah, on ne va pas tarder à savoir. Je prends ma boîte d'huile, ma bouteille de Pepsi, ma boîte de vitesse contient deux bouteilles de Pepsi, 500 cc. Coup de jauge, niveau impec. Caisse que vous croyez ? On est sérieux chez Pepsi-Cola-Liban.
Test sans appel pour des joints spi qui fuient sur un moteur deux temps, on démonte le cylindre et l'on emplit le carter-pompe de mélange huile-essence. Le niveau ne doit baisser que par évaporation de l'essence, sinon il y a fuite.
Or plus je verse et moins ca s'emplit. Ce ne sont plus des joints spi que j'ai, mais des filets de pêche ! Le patron me lorgne en coin. Il se demande à quoi je joue, lui qui travaille d'habitude sur des quatre-temps diesel...
Allez, on tombe le moteur. Le petit berlingot de Puce se retrouve sur l'établi. Vidange, et je commence à déposer le carter d'embrayage. Là, le patron ergote. Pourquoi ce côté-là d'abord ?
Je lui montre l'emplacement de la transmission primaire : « la boîte de vitesses perd de l'huile, c'est là que le joint est mort ! ».
Il doute, le grand chef. Evidemment, quand un diesel fume, logiquement, ce n'est pas dans la transmission primaire que l'on s'en va fouiner. On sort donc le carter d'embrayage. C'te bonne blague ! Le joint spi pendouille derrière le pignon primaire, complètement sorti de son logement.
« Altellak ! Je te l'avais dit ! ». Le patron se frotte la barbe avec le pouce, me regarde d'un air soupçonneux, mate le joint spi baladeur, et me dit d'un air entendu :
« Kwayyes enta ! » (tu es fort). Ça restera dans les annales du quartier mécano d'Akaba, le mec qui savait avant de démonter quel était le joint fautif.
Ce qu'il ne sait pas, le père Diesel, c'est que c'est peut-être le pépin le plus courant sur un deux-temps, après la panne d'essence tout de même.
Le patron a pris sa revanche avec la débrouille pour démonter et débloquer des pièces sans les outils réglementaires, là, imbattable. Pour remettre en place le joint spi, on s'est battu. Il voulait le faire parce que c'est lui le chef, moi je voulais le faire aussi, parce qu'un joint spi, c'est fragile.
On a dû faire un mini Camp David. Il a fait le gros-œuvre, moi la finition. J'ai remonté seul, ça tombait à pic que Ali et le patron aient eu affaire d'urgence à un Mercedes, j'aimais mieux m'arranger tout seul avec ma visserie de 6 mm.
J'ai pris le temps de tout décalaminer et tout nettoyer, puis, une fois terminé, de boire le Pepsi et fumer deux « Gold Star » avant de donner le coup de kick fatidique.
Assistance recueillie, un gamin ponctue mon coup de savate d'un sonore « Incha Allah beddo ! » (si Dieu veut, il/elle veut, prière locale pour qu'un engin démarre) Un chant clair annonce que mon ci-devant veau malade est redevenu son Altesse le Yam GT 80 n° 1267,6676 EG 92, que Puce est redevenue ma Puce.
« Kam flouz ' beddak, y a sidi ? » Combien veux tu de fric ? Quatre dinars, 55 balles. J'aurais dû discuter, faire baisser, mais fichtre la tradition, je n'ai même pas essayé, au contraire, j'ai payé le Pepsi.
Tu parles, Charles, si tu étais en train de crever de faim la bouche ouverte dans le désert et qu'on te propose un menu à 55 balles, tu irais discuter le prix ?
Ya sidi, c'est beau tout ça, mais pourquoi s'est-il fait la malle, ce fichu SW 28/40/8 de mes choses ? Un joint spi n'est pas un bédouin, à priori c'est plutôt sédentaire. Mal monté ? Surpression dans le carter ? Qui saura ? Bah... Je crois bien que ça restera un mystère. Ce qui compte, c'est que demain, Puce et moi, on va prendre en bonne santé le chemin de Ouadi Moussa.
Akaba, mardi soir.
Ce n'est pas un mystère, c'est de la magie. Puce ne voulait pas que je parte d'Akaba, c'est tout ! Ce matin, à 20 bornes de la ville, elle a recraché comme une mauvaise chique le joint spi que je lui avais remis hier. Si j'avais eu un chrono de marine, je pourrais vous dire exactement à quelle heure.
Son bruit a instantanément changé de ton, sans me poser la moindre question, j'ai tout de suite fait demi tour vers Akaba. Le joint spi se baladait au même endroit qu'hier. Cette fois-ci, hypothèse du mauvais montage à exclure. Surpression dans le carter, et pourquoi ? Dans mon pot d'échappement spécial anti-calamine, et pour cette raison pas décalaminé depuis sa fabrication, il y a en gros... oh ! oh ! 17 000 bornes, j'ai trouvé beaucoup de calamine, le tube de fuite partiellement bouché.
Il me semblait aussi, parfois, que ma Puce était plus silencieuse que lorsque le pot était neuf, au rallye Côte d'Ivoire-Côte d'Azur 1975. Seulement comme cette vacherie n'est pas démontable et que son tube de fuite de forme torturée défie toute investigation, j'étais parti du principe qu'il n'était pas calaminé. Erreur. Encrassement rapide des bougies, qu'en Egypte j'attribuais à l'huile de mauvaise qualité, surpression due au mauvais échappement, ça se tient. Ça c'est la raison objective que le temps confirmera ou pas. La vraie raison, vraie de vraie, c'est que ma Puce est magique : elle ne voulait pas que je quitte Akaba !
Inter-titre...
Là, y'a pas, fallait que je mette un inter-titre, à cause des chefs, dans la presse, qui disent que ceux qui n'ont pas les mêmes diplômes qu'eux sont incapables de fixer leur attention longtemps sur un texte, qu'il faut donc ménager des « repos » en l'occurrence des inter-titres, qui leur permettent de s'arrêter un moment pour faire refroidir le moteur.
Là je hurle au charron ! Objection votre honneur (de bras, comme disait le cardinal Duevalvole, qui a été excommunié par le sous-pape -un jésuite- pour avoir affirmé en public que Dieu avait créé le monde en quatre temps).
Moi qui ne suis pas plus diplômé que toi (pas toi, toi qui as loupé ton certif pour une sombre histoire de robinet qui fuit), j'arrive à me taper 100 pages de Faulkner sans déjanter, sans serrer, le seul truc c'est qu'il faut se servir de bouton de masse pour couper le moteur dans les descentes.
Tiens ! Ça me donne une idée colosso-géniale. Puisque j'ai un klaxon à gaz, je vais bricoler mon circuit électrique pour transformer mon bouton de klaxon d'origine en mise à la masse. C'est fichtrement casse-pipe de se jeter sur la clé de contact dans les descentes pour faire refroidir bobonne, d'accord ça fait pas loin de 30 000 bornes que je pratique le truc, mais ce n'est pas une raison pour continuer, pas vrai ?
C'est le même truc que mon pot d'échappement calaminé. La flemme, vous en avez entendu parler ? Bref, ce que je voulais vous dire au départ, c'est que j'ai « inter-titré » parce qu'il fallait selon le manuel du parfait petit journaliste, mettre un intertitre et que ne trouvant pas de titre d'intertitre j'ai inter-titré « inter-titre ».
C'est comme ça que m'est venue la décision de mettre un bouton de masse sur la Puce. Merde, du coup, j'ai tant bavardé qu'il faut que je remette un intertitre pour ceux qui, disent les diplômés, n'ont pas de bouton de masse. Mais non, je me fiche pas de ta pomme, mais à cause de Leif et Irène, j'ai l'âme rigolarde.
Il faut que je te parle de Leif et Irène : ils sont Norvégiens, et je n'ai jamais pu comprendre les Nordiques. La Scandinavie est, au-delà du Danemark, la seule région du monde où j'ai réussi à m'ennuyer. Leif et Irène ont dans les 120 ans à eux deux. Employés de banque. Tout pour plaire.
Eh bien figurez-vous qu'on s'est trouvé plus d'atomes crochus qu'un pignon fou avec un baladeur. Le coup de foudre. On a découvert qu'on avait la même conception de la vie.
Irène et Leif ont visité presque tous les pays du monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont très riches mais parce qu'ils n'ont jamais cherché à posséder trop de trucs sur terre. Ni maison, ni auto, ni télé.
Alors, du coup, ils ont souvent les moyens de mettre la clé sous la porte et d'aller se faire des potes à l'autre bout du monde. Evidemment, ils y laissent des plumes parce qu'ils sont innocents.
Irène embrasse comme une petite fille un Saoudi qui vient lui apprendre une danse arabe ; elle ne sait pas que Tartuffe, un tapeur-faux jeton qui embrasse dévotement le Coran tout en se soûlant à la bière sur le compte des voyageurs de passage, la traite de putain (en arabe) à la cantonade. Il est persuadé, Tartuffe, qu'Irène est sa conquête parce qu'elle ne se rebiffe pas et que Leif ne sort pas un revolver quand il lui caresse le bras pour admirer son bronzage ou qu'il l'invite à danser. Ignorance coupable des us et coutumes du monde arabe ? Si tu veux, mon pote. N'empêche qu'Irène, petite fille de cinquante huit ans, prodigue autour d'elle une leçon d'innocence.
Qu'importe alors qu'un crou-du-tul la traite de Charmouta ? Je le connais bien, Tartuffe, je ne me rappelle plus son vrai nom. Je l'ai pratiqué ici pour la première fois il y a trois ans, lors de mon voyage de noces avec la Puce. Il est le Tartuffe patenté d'Akaba. Il traiterait un chien de chien que celui-ci lui rirait au nez. Ce con, il avait failli me gâcher la Jordanie.
Excusez-moi : je me marre parce que le patron de l'hôtel est en train d'engueuler un de ses garçons : il l'a envoyé chercher une cartouche de Gold Star, la Gauloise jordanienne, et il s'est fait refiler des saoudiennes au lieu de jordaniennes. Ici on est à vingt bornes de la frontière saoudienne où il n'y a pas de taxe sur les clopes. Du coup les cigarettes jordaniennes sont moins chères en Arabie Saoudite. On trouve donc en Jordanie des cigarettes jordaniennes-jordaniennes et des jordaniennes-saoudites. Le cours n'est pas le même. Pauvre Abdo ! Faut dire que le malheureux n'a pas inventé la poudre, même moi je connais le coup. Il faut dire que c'est pareil en Italie.
Allez, pour le consoler, je vais lui faire enfin un polaroïd. J'espère que ça ne vas pas me bousiller mon objectif, non content d'être bête comme soixante douze pieds, le pauvre est moche comme douze régiments de poux.
Hier j'ai immortalisé sur sa demande le patron de l'hôtel. J'essaie toujours de fraterniser avec les patrons d'hôtels, ça peut toujours servir un jour ou l'autre. Le cas Abdo, a priori, ne présente pas d'intérêt manifeste, sinon de le consoler de son savon-maison ; peut-être que Dieu seul prendra mon geste en compte. Dieu sait ce qui est en nos cœurs.
Ouadi Moussa, jeudi.
Aujourd'hui, je puis vous l'affirmer avec certitude : je suis un poireau. Le joint spi baladeur, c'était bien ça : échappement bouché. Maintenant la puce marche comme un avion, j'aurai au moins appris que mon pot incalaminable spécial course doit être décalaminé au moins tous les 16 800 km.
Je promets donc solennellement de le décalaminer à nouveau avant que la puce n'ait 46 000 km dans la bielle. J'avoue que je ne bandais que d'une en quittant de nouveau Akaba. Jamais deux sans trois, dit-on. Or mon spi SW 28/40/8 s'était fait deux fois la jaquette, et la sortie d'Akaba est très dure pour une petite cylindrée.
Akaba est une petite plaine enfermée entre la mer Rouge et la montagne. Oeuf corse, pour en sortir, ça grimpe sacrement ; quand on est dur du matelas comme moi, on aborde la montagne vers 11 heures, où même en cette période de l'année il fait très chaud.
Retournons trois jours en arrière, quand je venais de remettre mon SW 28/40/8 en place pour la première fois, et que j'ai attaqué la montagne : après le poste de police d'Akaba, à 10 bornes de la ville, il y a un panneau « Amman 310 km » j'ai pensé à m'arrêter pour faire une photo, pour que vous voyiez qu'à 6 000 bornes de chez vous, il y a une route perdue dans le cailloutis du désert, et qu'au bord droit de cette route, un panneau bleu indique « Amman 310 km ».
C'est le premier panneau en partant de la mer Rouge. J'ai eu la flemme, parce que j'étais parti trop tard le matin et que le soleil tapait déjà fort, que je trouvais dur de devoir défaire les sandows de ma boîte à photos, bref j'ai passé outre.
Cent mètres plus loin, j'ai eu des remords. Dix bornes plus loin, j'ai dû contourner un mulet allongé en travers de la route, mort écrabousillé par une voiture ou un camion vu la flaque de sang séché sous son mufle, pauvre vieux...
Cinq cents mètres après le cadavre d'Alibo-ron, pif, paf ! beuheuheu. (bougie pontée), baah ! baah ! beuheuheuheu plouts... (Tentative de dégorgeage à coups de gaz). Je n'ai eu qu'à regarder ma fumée d'échappement pour savoir qu'il fallait faire demi-tour illico. Rien que le bruit de la pauvre Puce, de toutes façons, me l'avait fait comprendre à la seconde même.
Ce coup-ci, je suis donc reparti, même direction, après avoir tout de même débouché mon échappement, et bien sûr remis le SW 28/40/8 en place. Pas fier le mec.
Passant devant le fameux premier panneau après la Mer Rouge, je me suis cette fois arrêté pour vous faire la photo. On est reparti, dix bornes plus loin, feu monsieur le mulet était toujours là en travers de la route, sauf que cette fois-ci, il exhalait un foutu parfum qui n'était certes pas celui du jasmin ni de l'aubépine (de mulet).
Deux cent mètres après le cadavre de ce pauvre asinus qui n'avait pas traversé dans les clous, croyez-moi si vous le voulez (si vous me croyez pas lisez le Reader's Digest)... bref moins de trente secondes après avoir contourné mon pauvre ci-dessus mulet, pif paf, beuheu... pif, paf, beuheu...
Ah non, merde ! Raisonnons sainement : peu de chances que la présence d'un mulet mort influe à ce point sur la carburation d'un moteur qui en a vu bien d'autres. La bougie qui m'a permis de rallier Akaba après la seconde évasion de mon SW 28/40/8 n'a pas été changée, je m'étais dit que même gorgée d'huile, elle sécherait bien toute seule.
Comme je me trouvais sur une route de montagne étroite et sans bas côté, j'ai simplement prié à haute voix : bismillah el rahman el rahim, daa l'rahawa ya motori sriré ! (Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ne mollis pas, ma petite moto ! ).
Au lieu de mettre les gaz au taquet pour dégorger comme je le fais d'habitude j'ai rendu la main ; ça a passé grâce à Dieu ! Le joint spi en cavale c'était bien à cause de l'échappement spécial soit disant incalaminable, non décalaminé pendant 17 000 bornes.
Sur la route, après j'ai tiré de plus en plus sur la Puce, plus de vibrations, plus de cliquetis (essence ordinaire) et j'ai pris 105 compteur sur la route avant Déraa.
Si j'étais mécano chez Yamaha, je mériterais d'être foutu à la porte sans indemnité. Bah, n'importe, la Puce ne m'en veut pas, nul, surtout moi, n'est à l'abri de l'erreur. Je suis donc arrivé relax à Ouadi Moussa/Pétra, ces deux bleds, à trois bornes de distance, sont deux mondes totalement différents.
Petra, c’est un site fantastique, une forteresse inexpugnable, une cité entière taillée dans la masse de la montagne, et dont l’unique accès est un chemin caillouteux de deux ou trois mètres de large, bordé par les à-pics de la montagne. Inexpugnable, sauf qu'elle a été expugnée par les Romains en 192 avant que Jésus crie, je crois, par un moyen extrêmement simple.
Pour forcer les Nabatéens qui l'habitaient à rendre leur tablier, on leur a coupé l'eau. Aujourd'hui, Pétra est un lieu touristique, hôtel, cafétéria, cartes postales etc, beaucoup plus discrètement tout de même qu'en Italie ou en Grèce. Ça n'est pas homologué merveille du monde, mais c'est chouette.
Au-dessus de Pétra, dans la montagne, il y a Ouadi Moussa. Quelques centaines de mètres au-dessus de la cité devenue touristique, fréquentée par des touristes venus du nord en car climatisé, et qui, ô horreur, vont jusqu'à boire de l'alcool, Ouadi Moussa vit en l'an mahometan 1399.
Ouadi Moussa vit toujours selon les traditions tribales bédouines. J'avais à faire dans ces deux villes que 520 ans séparent. A Pétra, je voulais offrir à Puce la visite du « Treasusry », ce fabuleux monument taillé dans la masse de la falaise.
Nous étions allés à Pétra, Puce et moi, pour notre voyage de noces il y a bientôt quatre ans, mais je n'avais pas pu emmener Puce jusqu'au monument immortalisé entre autres par un album de Tintin...
L'accès de Pétra est interdit aux véhicules privés, si petits soient-ils.
Il a fallu faire intervenir quelqu'un qui connaît le cousin de la belle-mère du chef, mais la barrière a fini par s'ouvrir pour nous...
On a mis une heure à descendre les deux kilomètres de sentier caillouteux, because le « chef» de Pétra m'a fait promettre de m'arrêter et couper mon moteur chaque fois que je croiserai un cheval.
Tous les touristes ne sortent pas du Cadre Noir de Saumur, si leur canasson s'affole, on les ramassera sur la rocaille à la petite cuiller. N'importe. Puce a vu le « Treasury ».
Pour remonter on a attendu le « break » du repas de midi, élan, fond de seconde vitesse, clope au bec pour avoir l'air de Don Smith, et on a fait la montée « clean » comme disent les British, sans un seul pied à terre, salué par les « Kwayyes ! » (bien !) des gamins qui vendent de l'eau ou des sodas aux touristes.
La Puce est parfaite à piloter sur les pierres roulantes. Il n'y a qu'à tenir le guidon mollement pour laisser la roue avant trouver son chemin toute seule, le reste suit.
A Ouadi Moussa, c'était une autre affaire : je voulais sonner le rappel du Moto club de Ouadi Moussa. Il y a quatre ans, c'était un moto club puissant : on totalisait trois membres et 972cc. Ahmad, 650 BSA A65, Mohammed Issa, Yamaha 250 DT1, et moi Yamaha GT 80 œuf corse. Hébin, ils ont molli. Mohammed Issa roule Opel, et Ahmad qui a mis sa BSA en miettes marche à pieds aujourd'hui.
Exit le Moto club de Ouadi Moussa, mais l'amitié est restée, grâce à Dieu. Ainsi j'ai établi mes quartiers chez Mohammed Issa. Du haut de notre colline, nous dominons la ville de Pétra. « Tu arrives à point, m'a dit Mohammed, il y a justement des fêtes à Ouadi Moussa ».
En fait, des fêtes, il y en a toujours, à cause des traditions tribales. Chaque fois que quelqu'un perd un proche ou se marie, toute sa famille et ses amis l'invitent, lui et sa famille directe, puis ceux qui ont été invités invitent ceux qui les ont invités, si bien que chaque événement provoque une quarantaine de fêtes...
Je me peux pas rester pendant quarante fêtes, il faut tout de même que j'aille voir à Amman s'il y a des nouvelles côté visas.
Amman, vendredi.
Pas un visa à l'horizon...
Rien... Toujours et encore rien. Jamais de ma vie je n'ai eu autant l'impression de perdre du temps. De temps en temps, je bricole...
Ma dernière création, un nettoyeur de tube de fuite de pot d'échappement, bof, pas génial mais efficace, à base d'un écouvillon pour canon de fusil. J'ai pris soigneusement les cotes du tube de fuite de Puce, et je me suis dit que l'idéal serait un écouvillon pour pistolet ou revolver calibre 44 ou 45.
Je suis allé chez un armurier, et comme j'aime bien poser des questions précises, j'ai demandé : « Auriez-vous un écouvillon en cuivre pour un Colt45 à canon de 7pouces ? ».
Ben oui, c'était tout de même plus facile à comprendre pour un armurier que si je m'étais lancé dans une longue explication pour dire que je voulais propre comme neuf un tube de fuite de Puce d'environ 11,5mm soit 45/100 de pouce de diamètre et de 17 cm soit sept pouces de long, non ?
Que croyez vous qu'il ait fait ? Il a appelé les flics, parce que la détention des pistolets et revolvers est très réglementée en Jordanie.
Heureusement, la police du coin n'est pas méchante, du moins avec les étrangers, et Puce était garée à trois pas de là. J'ai montré mon tube de fuite de 0,45" de diamètre et de 7" de long, expliqué que je ne possédais pas de Colt 45, que je n'étais pas un dangereux terroriste, mais que j'avais simplement cherché à parler à mon armurier-délateur un langage qu'il puisse facilement comprendre.
Les flics se sont tordus de rire, j'ai demandé à voir leur revolver pour voir si par hasard je ne pourrais pas emprunter un écouvillon à la police, manque de bol, ils ont des Smith et Wesson calibre 38 à canon de trois pouces et demi.
J'ai fini par acheter un écouvillon pour fusil de chasse calibre 16 sans sa rallonge, et j'ai passé trois heures à le bricoler pour le rendre adéquat.
Ce matin, j'ai profité du fait que je devais renouveler mon séjour en Jordanie au ministère de l'immigration, je suis allé essayer ma Puce. Un avion, les mecs ! Ça a été ma joie de la journée, mon goupillon magique est une réussite totale. Si j'obtiens cette fichue autorisation de traverser l'Arabie Saoudite via la route du pipe-line, je vous garantis que je ne serai pas long à atteindre le golfe persique.
Seulement, ce visa ne vient pas. Peut-être que les Saoudiens ont peur que ma Yam super-décalaminée avionne si fort que le déplacement d'air arrache le pipe-line de ses supports, ou que j'emporte tout le précieux sable du Nefoud dans mes sacoches ?
Dieu que c'est bête la diplomatie ! Surtout, surtout que cela ne repose sur rien. Les diplomates, les politiciens se font des sourires ou des shake-hands sous les flashes des photographes, les consuls refusent les visas ou, s'ils ne veulent pas les refuser officiellement, vous font attendre jusqu'à ce que vous laissiez tomber vous-même (ça fait 39 jours que j'attends le visa irakien).
Ils doivent se croire super-indispensables, les mecs, sans eux, le chaos... Mes choses... Qu'est-ce qu'est l'essence de la politique ? Vivre ensemble c'est tout.
Ici à l'hôtel Halton il y a deux Saoudiens, trois Irakiens, un nord-Yémenite, des Jordaniens, et un Viet, moi. Pas un Viet réfugié du Haï Hong, un Viet avec un passeport communiste. Le Nord Yéménite devrait, s'il croyait ce que dit son gouvernement anticommuniste, se méfier de moi comme de la peste, il est lieutenant de carrière.
Eh ben on ne se bat pas. on ne s'échange même pas de propos aigre-doux, pour le moment, on est dans la même galère, dans le même hôtel bon marché où il n'y a presque jamais d'eau pour se laver, heureusement car quand il y a de l'eau, toutes les tuyauteries d'évacuation étant à demi-bouchées, on provoque des inondations qu'à côté, celles du Mékong c'est un pipi de chat.
Et bien je donne des leçons d'anglais à mon ennemi politique, et lui me donne des cours d'arabe. La politique, on se la carre dans l'oigne. Pareil avec les Irakiens : je leur dis qu'ils ont un gouvernement de merde, mais ça ne nous empêche pas de jouer aux cartes ensemble. Vivre ensemble. C'est si compliqué que ca ?
Les salauds, les foireux, les mange-merde, les pères de fils de foutu con, les résidus de jouissance interrompue par un coup de sonnette, les échappés de bidet, les foutus merdeux pestilentiels, les ordures de déchets d'ordure...
Plus criminel que Barrabas, Cornu comme les mauvais anges, Quel belzébuth es-tu là-bas Nourri d'immondices et de fange Nous n'irons pas à tes sabbats. Bourreau de Podolie, amant Des plaies, des ulcères, des croûtes, Groin de cochon, cul de jument, Tes richesses, garde les toutes Pour payer tes médicaments...
Il faut que je me rappelle Apollinaire pour pester en français.
Non, je ne suis même pas en colère, je suis franchement désespéré. Le consulat d'Iraq m'avait demandé d'attendre un mois pour avoir un visa. Un mois exactement après, je me pointe tout sourire. « Il faut attendre encore quinze jours », c'est le « Boukra » arabe dont je vous avais parlé en Syrie. Ça veut dire « on ne sait quand, peut-être jamais ».
Dans ce cas précis, c'est « jamais » que ca veut dire. Je suis persuadé aujourd'hui que dès le premier jour les mecs du consulat Irakien savaient très bien que je ne l'aurai jamais leur visa de merde, mais c'eut été trop simple de me le dire franchement tout de suite.
C'est tellement plus amusant de faire attendre pendant un mois pour rien ! Le gag, c'est dans la salle d'attente du consulat, il y a un superbe poster couleur « visitez l'Iraq ».
A votre santé, les mecs ! Foutus cons... Me reste l'Arabie -Saoudite, la route du Pipe Line jusqu'à Dam-mam.
Avec l'aide bénévole de l'Automobile Club Royal de Jordanie, j'ai pu avoir une entrevue avec le secrétaire d'ambassade, qui essaie de m'obtenir un visa de transit. Ça fait une éternité que ça patine. Raison ? L'Arabie-Saoudite a une sainte terreur des touristes-bidons qui viennent dans l'espoir de trouver un job sur place.
OK, mais c'est pareil pour le Japon. Seulement, les Japonais sont précis et efficaces. Ils m'ont demandé trente tonnes de garanties diverses et variées, je me suis débrouillé pour les leur fournir, et quand je suis revenu de Ouadi Moussa à Amman, à l'hôtel ils m'ont dit « ça fait trois fois que le consulat du Japon appelle pour vous dire que votre visa est prêt ».
Chapeau, Messieurs les Japonais, ça ne m'étonne pas que vous fassiez les meilleures motos du monde. Quoi qu'il advienne, maintenant, Puce ma bien aimée, ma perle de l'Orient, ma 80 Yamaha unique et préférée, reviendra visiter sa terre natale, je le jure.
En attendant, il faut que l'on puisse traverser l'Arabie Saoudite, il faut qu'on passe...
Le guêpier, toujours le guêpier, toujours les pays fermés comme la tronche de Staline quand on lui parlait de liberté individuelle. J'en ai ras la frange, les aminches. Nom d'un chien, mais comment se fait-il que le monde puisse parfois être aussi bête ?
Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre qu'il y ait un petit Yam et un petit Viet de plus sur leur territoire ? Il y a de quoi crever, étouffer sous la masse écrasante de la stupidité internationale...
Le Cardinal Belfigo, ce saint homme, disait « si tu es trop désespéré pour l'occuper de toi même, occupe-toi des autres ».
J'ai rendez vous dans un quart d'heure pour faire la carburation d'une Kawasaki Z 1000, qui navigue sur trois pattes et demie et vous donne des bougies noires comme Idi Amin Dada photographié sans flash par une nuit sans lune. Je vais essayer de le faire tourner rond, ce foutu machin. Vu qu'il n'y a pas un dépressiomètre à 3000 km à la ronde, ça va m'occuper un sacré bout de temps, pendant lequel je n'aurai pas le temps de penser à mes emmerdes personnels.
Vous savez, le voyage, ce n'est pas toujours rose. Heureusement qu'il y a les motos... Non seulement ça vous emmène au bout du monde, mais même quand ça ne marche pas, ça vous permet de passer le temps...
Amman, vendredi
Basta, je rends les armes, je laisse tomber. Arabie Saoudite, Irak, au cul mémé. Je ne les aurai jamais, leurs visas de merde, qu'ils se les carrent dans le cul avec leur pétrole par dessus.
J'appelle sur eux la malédiction de Dieu. d'Allah el rahman el rahim, qui sait ce qui est en nos cœurs. Qu'ils les fassent glisser sur une flaque de mazout et culbuter dans le ruisseau.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je leur dis solennellement « Merde » !
Demain, ida arad Allah, je retourne à Damas, et je vais essayer d'y faire ce que j'ai passé un mois et demi à éviter : prendre l'avion, avec la Pucinette dans la soute à bagages, direction Karachi.
Du fric foutu en l'air, et 1500 bornes de route de désert, le long du pipeline transarabique, ou de l'Euphrate, qu'on ne fera pas. Ça faisait deux mois qu'on en rêvait ! Hier, je suis revenu des ambassades saoudienne et irakienne avec ce genre de rogne qui vous donne envie de chercher des crosses à tout ce qui bouge. Je me suis assis sur une chaise dans le salon de mon nid à puces, au bord de l'explosion comme le réacteur de Three Miles Island.
Puis Laziz est arrivé. Laziz, c'est un drôle de mec : laid à faire peur, pas riche, mais fou de motos. Je vous ai parlé de lui, quand je suis arrivé à Amman, c'est celui qui a vendu sa 110 Honda qui marchait le feu de dieu parce qu'elle avait d'horribles problèmes de transmission qui venaient, j'en suis sûr à 99 % quoique n'ayant pas vu la moto, de la chaîne qui sautait sur la couronne AR probablement usée jusqu'à la corde.
Laziz, il m'énerve un peu, pas seulement à cause de sa fiole à faire fuir un corbeau, mais aussi parce que parole, il n'a pas inventé la soupape. Il m'a vu faire le tour des marchands de motos d'Amman, et parfois leur donner des conseils, parce que côté boulot sur des Japonaises, ils en sont là où la France en était il y a douze ans. Bref, depuis, Laziz se fait prêter les motos qui ne marchent pas bien, et me les amène.
J'étais donc assis sur mon cul, mort de rage et de désespoir. Qu'entends-je par la fenêtre sur cour ? Le bruit d'un twin deux-temps inindentifiable, quelque chose entre une 350 Jawa et une Kawa Al dont un distributeur rotatif serait cassé.
Nez à la fenêtre, je vois un engin à peine imaginable. Vlà encore du boulot. J'avais reconnu le casque intégral rouge et blanc de Laziz.
Là, parole, il m'avait amené la bête rare, le truc que l'on ne voit pas souvent dans sa vie. Une 185 Suzuki américanisée. Américanisée passe, mais comment ! Moi qui était prêt à pleurer de rage ou à larguer une bombe dans les ambassades saoudienne et irakienne, je me suis plié de rire !
Faut que je vous décrive le truc : la 185 bicylindre Suzuki est à peu près semblable à la 125 importée en France. L'ancien propriétaire (elle vient d'être achetée 150 dinars par un gars fasciné par son allure) lui a collé une fourche, « chopper », sans modification d'angle de chasse.
Comme tubes de fourche, il a utilisé du tuyau de plomberie, pas vraiment au bon diamètre, donc plus de suspension avant. Roue avant de 250 ou 350 Jawa (16 pouces), frein avant non utilisé (pas de câble) ce qui est certainement prudent vu la résistance potentielle en torsion des tubes (tuyaux ?) de fourche. Echappement « chopper » c'est-à-dire une rallonge de 40 cm, avec des « courbes » à angle droit, c'est plus facile à faire sans cintreuse. Circuit électrique style « retraite de Russie », c'est-à-dire contacteur à clé toujours là, mais on met le contact en pontant un connecteur avec un bout de fil. Pas de feu AR, phare style « feu de recul » à part la glace blanche, avec dieu sait pourquoi une ampoule bifilament 8/17W, alors que le support d'ampoule ne comporte qu'un contact. En plus la lampe est une 6V, alors que la batterie est une six éléments, donc 12V.
« Elle marche mal » me dit Laziz. L'eusses-tu cru, comme disait le cardinal Panzani ?
Eh ben mon pote, ça m'a remis de bonne humeur. Je suis allé chercher mes outils, mon bénard le plus crasseux, mon T shirt le plus minable, et au boulot. On a refait le circuit électrique, limé les vis platinées dont il ne reste que des moignons. On a fait l'avance avec un réglet en guise de comparateur, on a essayé de refaire une carburation, elle fonctionne, la 185 Suzuki ! Pendant que je maniais les tournevis, l'ohmmètre à vibreur Asaki Denso, la toile émeri de 600, j'ai oublié les Saoudiens et les Irakiens.
Merde pour les politiciens et les diplomates, il y avait une moto à faire marcher. Ça m'a calmé.
Autre chose : ça, l'acheteur ne l'avait évidemment pas vu, comme le reste, mais du fait de la longueur de la fourche, et de l'absence de suspension AV (les routes jordaniennes ne sont pas du billard) la moto s'était au moins une fois cassée en deux, suite à une rupture du berceau de cadre sous la colonne de direction, de même que de deux des tirants supérieurs.
Ça a été ressoudé à l'arc avec des renforts en fer plat, ça tiendra... le temps que Dieu voudra.
J'ai prévenu le proprio que d'ici quelque temps, il se pourrait qu'il se retrouve avec deux motos pour le prix d'une.
Bah, ça ne l'a pas affolé plus que ça.
Je lui ai conseillé de supprimer la rallonge d'échappement qui doit bien lui bouffer un tiers de la puissance, et la fourche modèle « service des eaux », il m'a dit oui, mais je suis bien persuadé qu'il va laisser tout ça, parce que s'il a payé 150 dinars cette épave, c'est précisément parce que sa gueule lui plaisait. Ne riez pas, on a tous un peu été comme ça quand on était p'tits. La Jordanie, c'est l'enfance de la moto...
Demain, c'en sera fini d'Amman, où j'aurais tout de même passé trois semaines en deux épisodes. Je viens d'aller paquer mes clous, demain, rideau. J'ai remballé mes fringues, mes outils que je laissais toujours sortis en prévision d'une visite de Laziz, des bandes de téléscripteur éparpillées dans tous les coins, mes cartes.
J'ai bien refait le chargement de mes sacoches, de mon sac à dos. La piaule qui était mon micro-univers est redevenue une petite chambre d'hôtel anonyme. Ça m'a fait un peu baliser.
J'avais un peu adopté Amman, Amman m'avait un peu adopté. Je ne jouerai plus aux échecs avec Nizak l'intellectuel, je ne jouerai plus au tcheddé avec les Irakiens, je ne bricolerai plus les motos d'Abd el Laziz, je ne déambulerai plus dans la rue du Prince Muhammad, je vais de nouveau changer de paysage, de vie, de traditions, de monnaie (le dinar vaut douze à treize livres syriennes), d'amis.
Drôle de vie. Depuis juin 78, bientôt un an, je vis en perpétuel transit. Ouiche ! Drôle de vie...
Bah, je ne vais pas me plaindre, chacun a plus ou moins la vie qu'il s'est faite, sinon quoi ?
Nous reverrons-nous, Amman ? Au fond on s'est connu par hasard, parce qu'ici je pensais avoir les visas qu'on me refusait à Damas. On s'était déjà entrevu il y a quatre ans, l'espace d'une nuit.
Arrivé à la nuit tombée, reparti au petit matin. Je me souviens que, comme je ne voulais pas laisser Puce dans la rue, on l'avait nichée au premier étage dans une resserre à balais.
Se reverra-t-on une troisième fois ? Peut-être, mais dans longtemps, ou du moins quand Dieu voudra. Il est puissant et sage.
Quand j'ai quitté Damas il y a un mois et demi, je ne pensais pas la revoir avant longtemps, et nous nous reverrons demain, si Dieu veut.
Les poids lourds sont facétieux ici, et la route Amman-Damas est bougrement étroite. Après, si Dieu veut toujours, l'avion, Karachi, le Pakistan, on quittera l'Arabie pour l'Asie. Ça va nous faire tout drôle, après trois mois de langue arabe et de culture musulmane, il va falloir perdre l'habitude de placer le nom de Dieu tous les trois mots.
Bah, avec le changement de langue, ça sera facile, si Dieu veut... Oh... pardon.
Hatrek, Amman. Demain matin je passerai dans tes rues, peut-être pour la dernière fois de ma vie. Inutile de me raccompagner, je connais le chemin...
Amman, samedi midi
Tiens, rigolo, au moment où je vais prendre la route, l'horoscope de « El Ra'i » me prévoit un risque d'accident mortel. Bah, si ça doit arriver, ma foi, qu'il en soit ainsi. J'aurai vécu presque trente ans, c'est déjà beaucoup, énorme même.
J'ai déjà eu le temps d'être aimé parfois, heureux, malheureux, déçu.
Fortune et malchance inattendues, ma vie comme bien d'autres n'a été qu'un perpétuel hasard.
Qu'ajouteraient à ça trente ou quarante ans de vie supplémentaires ? Les mêmes choses, sans cesse renouvelées ? Je ne cherche pas la mort, mais ne la crains non plus. Qu'elle vienne si elle veut, sinon, eh bien ce sera partie remise. Elle m'attend, elle nous attend tous quelque part. Je ne crois en ni n'aspire à l'immortalité. Je servirai, et c'est déjà beaucoup, d'engrais naturel...
Allons, assez parlé ! En route, ma destinée m'attend, peut-être sur la route Amman-Damas, peut-être plus loin. Ça, je le saurai pas plus tard que ce soir...
Damas, samedi soir
Hé ben non, n'en déplaise à la Mme Soleil de El Ra'i, la Camarde n'était pas au rendez-vous. Ça a été un voyage normal. Deux poids lourds m'ont envoyé sur le bas côté, deux vaches, un âne et trois chèvres ont essayé de se suicider par moto interposée, mais rien là dedans que de très normal, on n’est pas en Suisse, ici : y'a du folkore sur la route...
Ce fut un voyage tout à fait tranquille, normal, décontracté. J'ai tout de même roulé très concentré quand la nuit est venue, eh oui, je me suis fait piéger par la nuit à 50 bornes de Damas, j'ai perdu encore plus de temps que d'habitude à la frontière.
Quoiqu'il en soit, à 19 h 30 j'ai retrouvé Damas. Tiens, une chose, Amman en signe d'amitié m'a raccompagné à sa porte. Alors que je merdouillais dans les faubourgs, une moto m'a doublé et fait signe de m'arrêter.
La machine, je l'avais souvent vue garée devant un restau de Djebel Amman. On a fait connaissance, après l'étonnement habituel de voir un 72 ce venir de France, ils m'ont demandé où j'allais.
Dimachk ? Tu t'es trompé de route ! Allez, suis nous, on va te montrer. C'est donc escorté par une moto jordanienne que j'ai quitté Amman. Arrivés sur la bonne route, signe de la main, Allah maak ! Maa es salaam (Dieu soit avec toi, avec la paix !).
J'ai donc retrouvé Damas, grâce à Dieu. Je le sais par le choc que j'ai éprouvé en m'y retrouvant, je la préfère à Amman. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus arabe.
Je crois que chaque pays, chaque peuple doit préserver son identité, évoluer lentement pour que ses enfants ne se sentent pas déracinés. L'évolution se fait seule, génération après génération, il n'est nul besoin de la forcer.
Or Amman s'américanise, ou essaie de s'américaniser, à vitesse égale à V. On y rase et l'on y reconstruit en style moderne. J'ai peur que les petits Ammanéens (je ne veux pas dire ammanites, quoi que leur ville soit une « ville champignon ») balisent aussi fort que les petits banlieusards de Paris ou d'ailleurs quand on a rasé les baraques où ils étaient nés et avaient commencé à grandir, pour les remplacer par un univers trop grand, trop tassé, trop froid pour qu'ils n'aient pas l'impression de se trouver tout à coup en pays étranger.
A Amman, tout le monde voulait trop souvent à mon goût que je parle anglais pour pouvoir me montrer comme il le parle et le comprend bien, à part mon lieutenant yéménite qui pourtant le parlait aussi bien que les autres.
Je vais pouvoir ici me remettre à parler arabe. Pas pour longtemps, parce que dès demain je vais aller négocier pour Puce et moi un billet d'avion pas cher pour Karachi. On va changer de continent. Ça ne sera pas trop tôt, non qu'on se déplaise ici, mais on n'est pas parti pour vous faire une anthologie du continent arabe, pas vrai ? On va donc essayer de vous donner au plus vite, de « l'autre chose ».
Damas, vendredi 14 heures
H moins 2. Dans deux jours et quelques heures, Puce et moi tentons le grand roque. Ben oui, j'vous-avais-t-y pas dit que notre grande balade, à Puce et moi, est une sorte de partie d'échecs avec le monde ?
Eh bien on va déplacer la reine et le fou de quatre cases vers l'est. Comment ? C'est de la triche ? Un peu mon neveu ! Seulement voilà, on n'a pas le choix.
C'est ça ou le « Pat », la réduction à l'impuissance. Dans deux jours, la reine et le fou vont se déplacer de 4000 km vers l'est d'un seul coup.
Vol Syrian Arab Airways RB 501 à destination de Delhi, embarquement imminent à l'aéroport de Damas. Voler jusqu'à Delhi revient moins cher que Karachi.
Puisque l'Iraq et l'Arabie-Saoudite ne veulent pas nous voir. Puce et moi allons les survoler à 40 000 pieds d'altitude en leur faisant des bras d'honneur. C'est un joli coup, hélas un coup cher. 561 dollars service compris, si vous voulez tout savoir.
Heureusement que Puce ne pèse que 67kg non emballée pour un volume de 490 dm3, guidon et sacoches enlevés...
Ah, Ah ! Ça vous faisait peut-être rigoler que je parte avec une mini-Yamaha alors que l'on trouve des 1300 Kawa chez le marchand du coin ? Eh, les amateurs de gros cubes, faites une expérience : pesez votre moto, puis évaluez le volume en dm3 de la caisse qui pourrait la contenir, et multipliez le par 1,43. Prenez le plus gros de ces deux chiffres. (En fret aérien, un kilo = 7 dm3). Eh bien vous auriez payé, si vous étiez à ma place, autant de fois 11 F que de kilos obtenus en fin de calcul.
Tiens ? Pourquoi tu tousses tonton ? Cela dit 561 dollars, c'est un sacré coup de cimeterre dans notre balance des paiements à Puce et moi.
A côté de ce qui nous attend en Inde, le plan Barre c'est l'Amérique des années 50. Déjà, dans notre hôtel à Damas, il y a tellement de bébêtes qui piquent (des puces ou des punaises de lit, pas des moustiques, la nuit je n'entends pas de bruit de raids aériens) que je suis boursouflé comme le bonhomme Michelin.
C'est vous dire le standinge, à cinq balles la nuit, faut pas faire la fine gueule... En Inde, il va falloir faire encore moins cher.
Damas, dimanche
H-l... C'est demain. Puce et moi, on est comme qui dirait fin prêt. La Puce est déjà en douane à l'aéroport, emballée comme une momie égyptienne. Quant à moi, j'ai fait nettoyer toutes mes fringues encore mettables.
J'ai même acheté d'occase un pantalon de ville beige clair et une chemise assortie, 12,50 F en tout, pour avoir l'air d'un touriste-à-fric quand je débarquerai à Delhi. Pourquoi ? Parce que si par hasard on me posait la question « combien d'argent avez-vous sur vous » lors du contrôle d'immigration, il pourrait y avoir comme une gêne...
Plus j'aurai l'air riche, moins je risque qu'on me pose cette fatidique question. Tant que j'étais lancé dans les investissements de prestige, je me suis fait ressemeler mes bottes. Ça commençait à faire un bout de temps qu'elles roulaient sur la jante, les pauvrettes, et sur les pavés lisses des trottoirs d'Amman et de Damas, je me payais des embardées à faire pâlir un crossman.
Dans les souks, il y a une multitude de cordonniers qui vous font ça sur-le-champ. Des artistes, les mecs. Le coup d'œil du maître pour mesurer l'étendue des dégâts, on taille vite fait des coins pour rattraper les déformations de la semelle, cling, clong, les clous, bzzz, la meule, et un quart d'heure après on repart avec des grolles comme neuves. Cinq balles service compris.
Après ça, je suis allé marcher rien que pour le plaisir. Cette tenue de route, les copains ! Stabilité parfaite en ligne droite, en virage, en descente. J'ai ressenti la même impression que pourrait éprouver un possesseur de bécane japonaise lorsqu'il vient de troquer ses pneus d'origine usés jusqu'à la corde pour un train de M45 en gomme PZ2.
Ha là là ! C'est inimaginable. Eh bien j'ai éprouvé la même sensation en marchant avec mes bottes ressemelées. La joie du pilotage extrême pour cinq francs ! La vie est faite de petits plaisirs comme ça...
Pour le moment, je tue le temps, parce que demain, ça va être le grand chambardement. Je vais au cinéma, parce qu'ici ça coûte 2 balles la séance, et qu'on peut voir pas mal de films français ou anglais en version originale.
Changer de continent en l'espace de quelques heures, ça va faire drôle, drôle... Je regarde mon billet d'avion, celui de Puce, en magouillant un peu j'ai obtenu que Puce et moi prenions le même vol, RB 501 lundi 03 heures... Mais... Merde ! Lundi 03 heures, ce n'est pas demain, c'est cette nuit !
Tout le monde sur le pont, chacun à son poste d'équipage ! Bon excusez, il y a urgence, il faut que j'aille préparer tout mon attirail pour le grand départ. On se retrouve à Delhi, si Dieu veut, on y fêtera le premier mai...

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Inde et Népal
New Delhi, lundi soir
Eh oui, New Delhi capitale de l'état Indien, c'est là qu'on est, les gnaces. Enfin que je suis. Puce, ma Yam de Puce est encore à l'aéroport, à Dalam, à trente bornes d'ici.
Faut le temps qu'il faut, je ne pourrai probablement pas la sortir de douane avant demain ou après-demain...
Bon sang on a fait quatre mille kilomètres en cinq heures et des poussières, maintenant, quand un conducteur d'engin coûteux me demandera d'un air de commisération quelle est la vitesse de pointe de ma moto, je dirai « une fois, on a atteint 1000 km/h ».
Cela dit, Puce et moi sommes entrés dans la légende damascène. Le mec qui raque mille livres syriennes pour emmener avec lui en Inde une moto qui côté valeur vénale tend vers zéro (eh oui, un Yam GT 80 de 1975 avec trente milles bornes dans les tripes, vous en donneriez combien ?), de mémoire d'agent de voyages de Damas, ça ne s'était pas encore vu.
Brèflezonnest za Delhi. J'ai appris que Puce a trimballé pendant 15 000 km environ 46,7kg de bagages en plus de ma personne (de 53 a 60 kg suivant la situation de la balance commerciale). Les bascules d'aéroport font foi. Delhi.
Un choc ? Oui. D'abord il fait bien plus chaud qu'à Damas, 40° dans la journée, 30 la nuit, et une chaleur très humide, très lourde.
Ensuite... On roule à gauche. Il va falloir faire très gaffe au début, Puce n'a jamais roulé à gauche, et moi, la dernière fois c'était à London il y a deux ans, et je n'ai pas fait beaucoup de bornes.
A priori, L'Inde m'apparaît comme un pays extrêmement civilisé. La preuve ? Ils fabriquent des motos. Si !! D'une part ils ont récupéré les outils de fabrication et les droits de la 350 monocylindre Royal Enfield « Bullet », et la fabriquent depuis sous le nom de « Enfield India », d'autre part, il y a aussi un 200 mono deux temps, apparemment longue course, fabriqué par Enfield-Inde.
Je n'avais jamais vu cette machine auparavant. Ils font aussi des scooters et des motos Jawa sous licence. En dehors de ça, une débauche de triporteurs. On étudiera ça demain.
J'ai un mal de crâne pas possible. Le pilote du 747 nous a gratifiés de descentes tellement rapides que j'ai bien failli avaler mes deux tympans.

Demain... Demain il fera jour, tout ça s'est passé trop vite... 4000 kms en 5 heures, ça va pas non ? D'accord on n'avait pas le choix, mais quand même, c'est con, par la route on aurait mis une ou deux semaines, on aurait eu le temps de s'acclimater, d'apprendre trois mots d'Hindi, bref, on ne se serait pas retrouvé parachuté comme des cons.
Demain, demain, on verra... Ah ! Aussi, y'a les roupies. Que voulez-vous, c'est la monnaie d'ici. Sur les talbins « Reserve Bank of India » s'il y a écrit « je promets de payer au porteur », formule identique à celle des billets anglais, après c'est « la somme de X roupies ».
Quand j'étais gosse et que je racontais l'histoire du marchand de chameaux, je disais « ji tili vends trente roupies » parce que la roupie, et sa centième partie le roupillon (blague a part, ça s'appelle le « paisa ») ça me semblait si lointain, folklorique, à la limite de l'invraisemblable... Eh bien maintenant, c'est en roupies qu'il va falloir compter. Bah... On s'y fera. Demain.
Delhi, jeudi
Rien écrit pendant deux jours. J'avais déjà assez de préoccupations par ailleurs. Il fallait que je trouve le « Madras Hôtel », parce que dans le même immeuble il y a le bureau de la Syrian Air, qui devait me donner l'indispensable ordre de livraison pour que je puisse prendre possession de ma bécane bien-aimée.
Je l'ai eu hier vers dix heures, aussitôt j'ai affrété un triporteur pour aller à la « warehouse » où tout le fret est centralisé. Petit arrêt pour acheter un bidon d'essence, j'avais la ferme intention de remonter la Puce sur place et de repartir avec.
Un peu anxieux. Les carnets de passage en douane UIT ne sont théoriquement pas valables en Inde, et la voie normale d'arrivée d'une moto est la route, pas l'avion. De combien vont-ils vouloir amputer ma bourse déjà redoutablement plate ? Ont-ils abîme ma Pupuce ? Z'ont pas l'air soigneux des masses, les manut' de l'aéroport.
Longues palabres avec le gars des douanes. Bah, mon triptyque n'est pas valable en Inde, mais on va faire comme si. Ils m'envoient au « location office », puis à la caisse, 25 roupies, 13 francs de frais, trois heures après mon arrivée j'avais repris possession de ma Pupuce.
Très peu de dégâts : un petit poque sur le réservoir, l'ampoule de feu AR pétée (j'avais heureusement retiré le cabochon) sinon tout va bien.
Le temps de remonter le guidon, les clignos AV et de rebrancher le circuit électrique, deux coups de kick elle part, direction la consigne de l'aérogare passagers où j'avais laissé le klaxon, le compteur de vitesse, le compte-tours et les sacoches en polyester que j'avais pris en bagages.
Avant la tombée de la nuit, Puce, en pleine santé (elle aime les climats humides) faisait son entrée triomphale à New-Delhi.
J'ai adopté le « Madras hôtel » 20 roupies (10 F) la nuit dans une chambre à une personne, pas de sanitaires (à l'étage) mais un ventilateur que j'arrête la nuit pour avoir du silence. On trouve des hôtels beaucoup moins chers, mais je voulais pouvoir être seul pour travailler. La piaule a un peu l'air d'une cellule de prison, 2 mètres sur 3, pas de fenêtre, mais il y a un placard, un lit assez large, une table et une chaise pour écrire.
Côté bouffe, c'est un restau végétarien, la jaffe est à des prix impressionnants : une doça (crêpe épaisse de pâte de riz avec dedans des pommes de terre et autres légumes, de quoi faire un repas) 30 centimes. Un verre de thé, 25 centimes. On arrose la bouffe avec de la sauce au curry, je m'y habitue progressivement.
Premier repas, j'en ai consommé un demi ramequin, aujourd'hui deux, sans avoir besoin d'appeler les pompiers. Cela dit, les autochtones consomment ladite sauce à la petite cuiller, comme de la soupe. Je n'en suis pas encore là. Petit déjeuner, même trip : un plat avec de la sauce au curry à neuf heures du matin, ça fait drôle. Je m'y ferai.
Des motos... Il y en a plein, partout. Des 175 CZ tchèques fabriquées en Inde, des 200 deux temps et 500 mono quatre temps « Enfield India », des scooters Vespa et Lambretta également fabriqués ici, à profusion.
Remarquez qu'étant donné le climat, ça serait un crime de ne pas faire du deux-roues ici. Puis il y a les triporteurs Lambretta indiens qui servent de taxi à deux places passagers, les triporteurs Harley, des vieux 750 à soupapes latérales, avec différentiel et tout. C'est un peu décousu, ce que je vous raconte, mais ce sont mes premières impressions.

Delhi, plus tard.
Ce matin, je me suis réveillé en bonne forme au lever du soleil (si !). Est-ce un signe que je commence à m'acclimater ?
Wahoo ! Il serait temps, disons que mes débuts indiens ont été plutôt mouvementés et difficiles. Puce, ma Yam de Puce, a été plus souple que moi. Elle a tout de suite compris le coup pour rouler à gauche. Oh, une fois ou deux au début, on a cafouillé un peu à un carrefour et on s'est retrouvé à droite, mais dans la cohue générale ces petites erreurs sont passées totalement inaperçues.
Le gag, ici, c'est notre klaxon de bateau à gaz. La grande classe, par ce qu'en Inde contrairement à l'Arabie, si on se sert beaucoup du klaxon, on n'en trouve guère de très puissants (les importations de l'étranger sont sévèrement contingentées).
Les scooters et les triporteurs ont des petits vibreurs ridicules style Mobylette, les motos des petits put-put style moto anglaise des années 50, et les bagnoles (toutes de fabrication nationale, comme presque tout ce qui roule ici) leur klaxon d'origine, superfaiblard.
Alors nous, vous pensez avec notre sirène marine, on est la terreur de Delhi ; dès que je pose le pouce sur la touche de ma bombe tympanicide, les corneilles se réfugient sous les faîtes des toits, les moineaux se bouchent le trou auditif avec du ciment, et suspendent leur vol, de même que le temps qui lui n'a aucun mal ici, il ne vole pas vite.
Lorsque mon pouce tout puissant presse la touche, c'est pire que la puissance nucléaire de Brejnev ou de Carter : la débandade !
Quel est ce mugissement apocalyptique ? Le fantôme de la vache sacrée Rothi Ozépis, égorgée en 1622 par un brahmane sacrilège, qui, conséquemment à une confusion regrettable entre une bouteille d'eau et une de Gilbey's gin avait mélangé la vie du Bouddha de Vazymonga et un manuel de cuisine importé de Normandie ?
Est ce le cri de Shiva-Sregal, le dieu des vins et spiritueux, qui ne dessaoule pas depuis que l'Etat indien a établi la prohibition de l'alcool dans la plupart des territoires de l'Inde ?
Le dieu hurle non pas parce qu'il est ivre (il l'est tout le temps) mais parce qu'au marché noir, ça lui revient plus cher. Qu'est-ce ? Au secours ! Assez ! Pitié ! C'est trop, même Brahma ne brama jamais aussi fort dans ses plus fortes colères, qu'est-ce en fin ?
Calme tes terreurs, peuple de l'Inde, ce n'est que sa splendeur le 80 Yam qui demande le passage...
Donc Puce est à son aise.
Quant à moi... Ça a été plus dur. D'abord, je me suis fait un peu voler, ensuite j'ai eu une alerte à la bombe. Parlons de ça en premier. Au début, ça allait bien : la chaleur moite de Delhi me rend paresseux, m'enfin j'arrivais à me mouvoir, ceci jusqu'au triste jour où pour me changer un peu de la cuisine végétarienne, je me suis offert, dans un petit restau pas cher, un poulet au curry.
Sinistre erreur, car, je l'ai appris par la suite, ledit poulet avait été pendu bas mais très court en 1878 pour avoir fomenté une révolte contre le gouvernement de sa Majesté la reine Victoria, ou une autre, allez savoir, les poulets ne comprennent rien à la politique.
C'est justement pour ça qu'on a pendu celui-là. Or, manger les condamnés politiques était alors interdit en Inde, jusqu'à un décret-loi stipulant que les coupables de crimes politiques, lorsqu'ils appartiennent à la caste dite des « comestibles », ne seraient plus pendus mais empalés sur une sorte de pieu métallique horizontal, puis brûlés à petit feu (thermostat 5 à 7), pendant un temps proportionnel à la taille du condamné, entre une demi-heure pour un coupable de petite taille et trois heures pour un vraiment gros condamné.
Il paraît que d'autres pays ont adopté cette coutume barbare. Donc mon poulet avait été pendu en 1878 (bien avant la loi) mais on me l'a servi la semaine dernière, après la loi. C'est pour ça, sans doute que sa digestion a été si difficile.
En plus de ça, au réveil, je mangeais de l'iddly, des boulettes de farine de riz gorgées de sauce curry, parce qu'au Madras Hôtel y'a que ça au petit déjeuner, ou alors des trucs encore plus épicés.
Y'a aussi que l'eau courante n'est paraît-il pas saine en Inde, mais mon pauvre ami, même si tu perches à l'Ashoka ou au Maurya, où tu paieras vingt fois plus cher qu'ici, si un microbe vicelard a décidé de te mettre à bas, il trouvera bien le moyen de venir te chercher. Tiens, là, dans les glaçons de ton Chi-vas de 21 ans d'âge, ou là, dans ton tournedos à cent Roupies. Bref je me suis dit qu'on verrait bien.
En fait après l'épisode du poulet au curry, mon moteur a commencé à perdre des tours. Ce fut très progressif, très pernicieux, comme un allumage qui se dérègle. Bref au bout de quelques jours je me suis aperçu que je ne fichais plus rien de la journée. Pas le moral, envie de rien.
Etant donné que la bête humaine est une machine biologique, je me suis dit qu'il devait y avoir de la limaille dans le carter. Un homme, c'est comme une moto. Si l'on ne répare pas aux premiers symptômes, ça peut donner la grosse casse chère à réparer et tout. Quand on trouve de la limaille dans le carter, on ne continue pas à rouler en attendant patiemment que ça casse pour de bon. Faut réparer, mon gars.
Ça y est ! Je l'attendais celle-là. Y'a un mec au fond de la salle habillé tout en noir, qui dit que c'est pas pareil, parce que les motos n'ont pas d'âme. Mais l'homme non plus, mon pauvre vieux !
Seulement dès qu'on se heurte à une machine trop compliquée, on hurle au surnaturel. La seule différence est que l'homme est livré sans manuel d'atelier ni mode d'emploi ce qui fait qu'on est réduit à se fier à des on-dit ou tout inventer soi-même.
Faut dire qu'au moment de la création du modèle l'imprimerie n'était pas encore inventée, et que par la suite le manuel ne fut jamais édité parce que le constructeur était mort de vieillesse, et, ne sachant pas écrire il avait emporté les plans dans sa tombe, laquelle tombe malgré de patientes recherches ne fut jamais retrouvée.
Bref j'ai cherché la panne. Après inspection de la couleur des fumées d'échappement (n'est ce pas bien dit ?) nettement claires, j'ai conclu que c'était le foie qui était malade. Bon. Diète et repos. Cinq jours de riz blanc, yaourt et de médicaments à base de sucs végétaux (vendus ici sous le nom de « Lia SZ ») et le moteur s'est remis à tourner rond, entraînant la pompe à moral, toutes les aiguilles de manos sont retournées dans la zone verte. La preuve ? Je relis ce que je viens d'écrire, c'est plus débile que jamais par Ganesh !
Y a eu de la fauche aussi. Après ' m'être fait soulever un appareil photo dans « ma » chambre à Damas, j'avais sainement décidé de toujours confier ce précieux fourniment à la réception de mes palaces.
Aussi ai-je fait la tronche quand un jour on m'a rendu ma valise à photo avec de sérieux manques. Greffier notez. Un Polaroid, un flash électronique, une cellule photométrique. Pas un expert, le voleur. Il a pris le flash sans son indispensable chargeur, on ne trouve pas que je sache de film Polaroid en Inde, et à qui va-t-il vendre une cellule super compliquée dans un pays où l'on utilise guère que des « boîtes à savon » ?
Enfin ça me faisait tout de même baliser : en ne parant qu'au plus urgent, où trouver une cellule correcte à un prix non prohibitif ? Qu'allait faire l'hôtelier, théoriquement responsable ? Ça s'est arrangé. L'hôtelier, après trois jours d'âpres discussions, m'a remboursé la moitié de la valeur neuve du lot, ce qui correspondait tout de même à plus de cent jours de séjour dans son hôtel.
Cela dit, peu soucieux d'héberger des clients « à risque », il m'a ensuite gentiment mis à la porte. Trois jours après, j'avais échangé mon gros 6x6 et ses objectifs contre un 24x36 Nikon à cellule et tout était dit.
Ensuite il a fallu renouveler le carnet de passages en douane de Puce et courir les visas, Népal, Singapour, parce que pas de blagues, on a trois mois pour aller au Japon, on ne veut pas laisser se périmer ce visa-là. Encore deux ou trois signatures, et l'on va lever l'ancre.
Direction ? Lucknow, Bénarès, Kathmandou. On va rigoler, pour parvenir au Népal, il faut franchir des cols au dessus de 2500 mètres d'altitude. Comme de juste j'ai oublié d'emmener des petits gicleurs Mikuni pour corriger la carburation en altitude, on va peut-être avoir du mal. On verra...
Je ne vous ai pas dit grand chose de Delhi. C'est un drôle de bled : c'est peuplé, beaucoup même, il y a 1/2 crore, soit 50 lakhs d'habitants à Delhi. Comment ? Combien ça fait une crore ? 100 lakhs, mon ami.
Bon trêve de blagues, « ils » sont cinq millions. Cela dit, la ville, très étendue, est loin d'être invivable. Sans être tout à fait vivable tout de même, parce qu'en ce moment, il y fait chaud, chaud.
Quand il se décide à pleuvoir, on respire. Et ca tombe... D'un coup le ciel se plombe, une grosse rafale de vent, et plaoutch, ça tombe dru, dru, dru.
Après, il fait frais, agréable, et la ville sent bon pendant une ou deux heures, ou plutôt ne sent presque plus, parce qu'il faut bien admettre que quand il ne pleut pas, elle pue.
Puis le temps recommence à s'alourdir... Jusqu'à la prochaine pluie.
C'est la mousson qui s'annonce...
Dans New Delhi, la partie récente de la ville, on pourrait souvent, s'il n'y avait les Sikhs en turban et les femmes en sari, se croire en Angleterre.
Le vieux Delhi, lui, est indien. Difficile à expliquer. Tous les commerces sont sur le trottoir, tout est extrêmement tassé, et ça sent les épices, le kaka, tout à la fois... L'Orient quoâ.
Partout, dans l'ancien comme le nouveau Delhi, il y a les bébêtes qui roulent, qui roulent... Les bagnoles, des répliques de voitures anglaises des années 50, et les deux et trois roues nombreux à un point pas croyable.
La ville foisonne de parcs à motos gardés avec même parfois des patères pour accrocher son casque. Delhi a la plus forte concentration de motos que j'ai vue de ma vie.
Delhi, mercredi
Ouf ! Deux barrières qui nous tenaient coincés, Puce et moi, viennent de se lever dans un grincement de ferraille rouillée. Hier encore on ne savait pas, mais le grand départ vers l'Himalaya est pour demain à l'aube.
Le dernier coup de tampon a été donné ce matin à 11 h 45. « Singapore High Commission » M. Tran-Duc, Frédéric, et Mlle Yamaha, Puce, sont autorisés à se rendre à Singapour. La valse des tampons est à priori terminée jusqu'au Japon.
Des tampons, il en a fallu, plus chez les uns que les autres. Renouvellement du carnet de passages en douane de ma Puce : un télégramme pour Paris, vingt-sept coups de tampons, total 350 roupies.
Un visa pour le Népal, 45 roupies.
Un visa demandé en urgence pour Singapour, deux cent cinquante roupies et quinze jours d'attente. Total 645 roupies, en gros quatre cents Balles, une somme fabuleuse, de quoi vivre tranquillement en Inde pendant un mois.
Désastre financier, banqueroute, heureusement que mon régime alimentaire « spécial foie faiblard » réduisait mes dépenses de bouffe à six roupies (3 F) par jour.
Puce et moi, hier encore, on se rongeait les ongles. On attendait 1000 Balles parties depuis 15 jours de Paris, et le fameux tampon pour Singapour, afin d'être tranquille.
Tous les matins, même moue désabusée de l'employé de la banque. Rien. Ce matin, il a souri. Ca y est ! J'ai poussé un grand soupir.
Notre hôtelier commençait à faire la tronche, note impayée depuis dix jours, et on en avait assez d'être coincé à Delhi. Puce et moi avons aussitôt foncé vers le consulat de Singapour.
Là aussi, sourire : c'est accepté ! On a poireauté pendant une petite demi-heure, puis la secrétaire du consulat, une fort appétissante demoiselle au demeurant, est revenue avec mon passeport tamponné. Ouf ! La dernière barrière est levée. Heureux comme des fous, on est parti plein pot, et histoire de rigoler, on a
passé le « speed breaker » de Golf Links à 90 à l'heure.
Ah oui ! Vous ne connaissez pas les « speed breakers », briseurs de vitesse. C'est une invention rigolote pour obliger les gens à ralentir avant certains passages cloutés. Un dos d'âne artificiel, très sec qu'on ne peut passer que lentement ou à fond. Lentement, on épouse l'obstacle, à fond, on le survole.
La fourche de Puce a légèrement talonné en détente. Manque d'huile dans la fourche, les joints spi ont 30 000 bornes de plus ou moins mauvaise route dans le nez, et la tôle ondulée africaine, de même que le sable et la poussière, n'ont rien arrangé. Bah, on verra ça... Au Japon ! On n'a guère plus de 5 ou 6000 bornes à faire entre-temps.
Demain, ça va être reparti. On va pouvoir tailler la route jusqu'à l'Himalaya et la vallée de Kathmandu, à 1500 kilomètres d'ici, où paraît-il, il fait plus frais qu'ici. On va pouvoir roupiller dans les buissons au bord de la route et être réveillé par le soleil.
Puis ida arad Allah on va voir Kathmandu.
Birganj, samedi
Ouf ! Ça y est, Puce est moi sommes au Népal. On a passé la frontière en début d'après-midi, mais on attend demain matin pour attaquer l'Himalaya.
Kathmandu n'est qu'à 200 kilomètres, mais on nous a tant parlé des difficultés de cette route (les bus mettent une dizaine d'heures à la faire) qu'on ne voulait pas risquer de se faire piéger par la nuit.
1350 kilomètres en trois jours, ça n'est pas un record, mon neveu ! Pourtant, parole, je suis sur les genoux, fini, lessivé, et j'ai tellement mal au cul qu'à la seule vue des chaises en bois du restau du coin, j'ai été pris de nausées, sueurs froides et tremblements convulsifs.
J'ai les mains et le visage qui me brûlent comme si on m'avait fait une dépilation au chalumeau, des yeux de lapin russe et des crampes dans tous les coins.
Puce, elle, se porte bien, merci pour elle. Pourquoi ce délabrement ? Perte d'entraînement d'abord. Ensuite et peut-être surtout, la route, la chaleur, la poussière.
La route, vous savez ce qu'elle m'a rappelé ? L'Afrique.

Par moments, c'est très bon, juste un petit poil étroit, quand on croise un poids lourd, s'il ne se range pas soigneusement il faut mordre sur le bas côté.
Pour dépasser, même problème, et Puce avec ses 72 ce, est un engin diaboliquement rapide selon les critères indiens. Pensez un peu : les poids-lourds sont limités à 40 km/h et les autos, étant donné la difficulté des dépassements, ne vont guère plus vite.
En 1350 bornes, on s'est fait doubler quatre fois, par trois Enfield-lndia et une Yezdi (Jawa) des fous, des dangers publics, pour rouler au-dessus des 75 km/h que Puce et moi nous sommes fixés comme vitesse de croisière.
La plupart des motards se baladent comme tout le monde à cinquante à l'heure. Un 350 mono 4 temps qui se promène à 50 en quatrième, ça fait pom... pom... pom. Une explosion tous les 17 bananiers.
Ça, c'est quand la route est bonne. De temps en temps, crac, elle disparaît, pour laisser place à une mer de sable ou de cailloutis : travaux. On longe une armée de cantonniers de 7 à 77 ans qui portent sur des paniers les cailloux destinés à refaire la route.
A part tout de même le damage, tout se fait à la main. La main-d'œuvre est encore ce qui coûte le moins cher en Inde. De une à vingt bornes de sable, de poussière et de cailloux, la route réapparaît, jusqu'aux prochains travaux.
La chaleur... Très supportable tant que l'on roule, si l'on excepte le « coup de chalumeau » permanent sur les mains, mais dès que l'on ralentit ou s'arrête pour prendre de l'essence ou demander sa route, on a l'impression que quelqu'un vient d'allumer un radiateur électrique.
En l'espace de dix secondes, on se retrouve ruisselant de sueur, et l'on n'aspire qu'à une chose : rouler, rouler de nouveau, pour avoir un peu d'air frais, ou du moins, un peu plus frais.
La poussière... Omniprésente. A l'heure qu'il est, j'en remâche encore. Ca donne soif, soif, soif. Régime quotidien de ces trois jours : un silo de poussière et six litres d'eau. Je garde maintenant ma gourde en permanence autour du cou pour pouvoir boire en route.
Après Bénarès, j'ai voulu couper au plus court par une route secondaire, on s'est retrouvé à faire une centaine de bornes sur une piste digne du Paris-Dakar, ce qui a achevé mon malheureux fessier qui déjà n'en pouvait plus guère.
Cette étape nous a permis, à Puce et moi, de refaire connaissance avec la plus grande chaîne d'hôtels du monde, très appréciée des routards pour son rapport qualité prix absolument sans concurrence.
Quitte à faire de la publicité sauvage, je la nommerai. Il s'agit de la chaîne des hôtels Bellétoile et Courendert. On reconnaît aisément ces hôtels au fait qu'ils sont très hauts, mais vraiment très hauts de plafond, et que les lits sont par contre très très bas.
En Inde, les hôtels Bellétoile et Courendert sont très recherchés, parce que très bien chauffés la nuit. Le pied.
A la tombée de la nuit, on commence à scruter les bas côtés à la recherche d'une chambre convenable. Pas question de rou1er de nuit ici, la route est un perpétuel traquenard.
La lumière est strictement interdite sur les vélos, les charrettes, les piétons, les vaches, les cochons, les couvées. A moins de se monter un chasse-bœufs en guise de carénage, on risque au bout de vingt kilomètres de trimballer une arche de Noé sur son garde-boue avant.
Alors, au premier coin sympa. Puce et moi, on s'arrête, on s'installe tranquillement sans avoir à remplir de fiche, on contemple les étoiles en fumant des « beedies », des petites cigarettes faites d'une feuille de tabac roulée, et on s'endort.
A cinq heures et demie du matin, le service du réveil allume la lumière et l'on repart, c'est la route intégrale. La bouffe ? Il suffit de s'arrêter dans un village, même les plus petits possèdent au moins une petite échoppe à ciel ouvert, où l'on vous sert des légumes au curry dans une feuille de bananier, au bord de la route.
On a donc mis trois jours pour arriver au Népal, soit le même temps que les trains. Non, Ils ne sont pas très rapides, d'accord.
Mais pourquoi si vite ? Pourquoi ne s'être pas arrêté pour visiter Agra, -tout de même, le Taj Mariai- Bénarès, et tout le toutim ?
D'abord parce que je suis l'un des plus mauvais touristes que la terre ait connu. Les vieilles pierres ne me branchent pas, le plus beau paysage me lasse en un quart d'heure.
Ensuite à cause de Puce. Je vous ai déjà dit que ma moto est magique. D'ailleurs lorsque je suis parti, un pote m'a donné un T shirt « Yamaha, oriental wizardry » : sorcellerie orientale.
Eh bien, c'est vrai. Ce sacré petit bout de moto a des dons de voyance. Elle a le don de me faire arriver ou rester dans des endroits où quelque chose m'attend.
Vous souvenez-vous quand elle a refusé de quitter Akaba ? Et bien, pendant la dernière semaine que nous avons passée à Delhi, puis tout au long du chemin, j'ai senti ma Puce pressée d'arriver à Kathmandu. Il y a un secret...
Kathmandu, lundi
Kathmandu, c'est le pays de Bouddha. Il y est né...
C'est l'endroit du monde où le visage de Dieu est le plus proche de la terre... Eh oui, moi aussi j'ai vu le film de Cayatte. Le moins que l'on puisse dire est que la montée a été dure dure.
Pas à cause de la route. Ça monte, mais ni très fort, ni très haut, et il faisait très chaud.
Non. Le problème a été l'essence. A chaque station, même topo : « on n'a plus que du gas-oil, pour l'essence, il faut aller à la station suivante ».
On a terminé le trajet avec une drôle de tisane que l'on a trouvée dans une épicerie, qui était fort probablement du pétrole lampant.
Avec ça, la Puce refusait de passer le 50 km/h, cliquetait au delà d'un tiers des gaz, et chauffait comme un haut fourneau du temps de la splendeur de la civilisation industrielle, mais on est arrivé à Kathmandu.
Kathmandu... Je me suis toujours demandé pourquoi ce bled attirait tant de monde, et surtout tant de Français. Est-ce à cause du film (Les Chemins de Kathmandu), un très joli film quoique un peu cucul et donnant de Kathmandu une idée très inexacte ?
Probablement en ce qui concerne les Français.
O puissance des média !
Cela dit, il doit y avoir autre chose. Lorsque l'on arrive par la route à Kathmandu, on commence par se demander pourquoi on a fait tant de bornes pour arriver là.
Les faubourgs sont d'un style architectural fort connu chez nous : le moderne-moche. Puis dans le cœur de la ville on commence à comprendre.
On entre dans un enchevêtrement de ruelles larges comme une bagnole et quart, on trouve un temple tous les dix mètres, le tout avec une architecture délicieusement baroque.
Dans les rues, on croise ou l'on contourne à peu près tout ce qui vit sur terre. Des vaches, des buffles, des chevrettes, des porcs, des poules et des hommes, des hommes de toutes les sortes, le touriste allemand côtoyant le freak dépenaillé autant que désargenté, le bonze thibétain à l'allure sérieuse et triste, ou le Nepaliscus Vulgaris qui se rend à ses cultures ou son commerce, car, évidemment, tous ces visiteurs font sérieusement marcher le commerce.
Les Népalais paraissant extrêmement calmes, placides, à la limite de l'indifférence totale, ce petit monde arrive à coexister pacifiquement.
A Kathmandu chacun vit à sa façon et à son rythme, s'habille comme il veut dans l'indifférence générale. On a l'impression de se trouver en dehors du monde dans un lieu où rien n'est interdit, même si on a l'impression d'avoir affaire à de l'indifférence plus qu'à de la tolérance.
Ajoutez à ça que toutes les drogues ailleurs illégales ou légales avec ou sans ordonnance sont disponibles à tout vent, et que la vie en général n'est vraiment, vraiment pas chère, pour un étranger, s'entend.
On peut se loger pour trois balles, manger pour encore moins si l'on ne cherche pas à se faire du lard. Vous avez somme toute un endroit assez extraordinaire pour changer radicalement d'atmosphère.
Revers de la médaille : les Népalais se fichent de tout, en particulier de l'hygiène. Je n'ai pas rencontré ici un seul Européen qui ne soit ou n'ait été malade.
Au sommet du hit-parade, la dysenterie amibienne due à une eau particulièrement malsaine. Comment ? Ne pas en boire ? Ben oui, mon pote ? Tu vas faire des glaçons à l'eau minérale, te laver les dents à l'eau minérale, faire laver tes verres et tes assiettes à l'eau minérale, enfin tu mords le topo, mec ? L'hygiène, c'est une entreprise collective.
Ça permet au moins, ici, aux pharmacies de faire fortune. Bref, tout le monde est mal foutu. Je ne sais par quel miracle jusqu'ici je suis passé au travers. Pourvu que ça dure...
Dépaysement... Ici l'on a vraiment l'impression de se trouver au bout du monde. Il suffit de monter les escaliers d'un temple, et s'asseoir en haut en compagnie des fumeurs de chillum.
Là, on laisse tranquillement promener son regard sur choses et gens, et tout, tout vous dit que vous êtes très très loin de tout.
La nuit tombée, les lumignons et les mèches d'encens illuminant les statues dorées des dieux, des gens passent doucement en faisant tourner les moulins à prière d'un doigt distrait.
A onze heures, Kathmandu dort en silence. Aujourd'hui je regarde par ma fenêtre, et à quelques kilomètres, au sommet d'une colline, j'aperçois les trois pointes du temple de Swayanbu-nath, l'un des plus célèbres et des plus respectés du Népal.
Puce a envie d'aller saluer le petit Bouddha. Demain, nous gravirons la colline pour aller lui serrer la louche.
Kathmandu, samedi
Alors, celle-là, elle est forte. En voyage, on peut s'attendre à des tas d'aventures plus ou moins bizarres, surtout quand on se balade avec une moto comme ma Puce, qui connaît tous les secrets de la magie orientale ; tout de même, celle-là, vous ne la devinerez pas !
Savez-vous ce que viennent de donner bientôt quatre ans d'union entre Mademoiselle Puce Yamaha et moi-même ? Non... Si ? Oui.
On vient d'avoir un enfant. Ça, aucun expert gynécologue ne l'avait prévu, mais c'est arrivé.
J'ai téléphoné à Marcel du bar de l'Esplanade pour lui signaler l'événement, parce que Marcel trouve toujours des explications à tout.
Il a été catégorique : « Depuis le temps que tu te trimballes sur le dos de la Puce, c'était inévitable ! ».
Ben oui, faut croire. Il faut que je vous raconte comment c'est arrivé.
Je vous ai fait des cachotteries : tout a commencé le surlendemain de mon arrivée à Delhi, mais ça m'avait paru tellement irréel, et le résultat d'aujourd'hui tellement improbable que je ne vous en avais pas parlé, vous vous seriez dit « il rêve, le mec, il fume du 'teuch trop fort pour lui... »
Le surlendemain de mon arrivée à Delhi, sitôt la Puce sortie de douane, on est allé au consulat du Népal pour demander un visa, parce que Kathmandu était important pour moi. Je remplis le formulaire, on m'annonce que si je veux attendre, je peux avoir le visa aujourd'hui même. O miracle, un visa obtenable le jour-même, c'est presque unique. Glory be, Alléluia !
Je ressors acheter un journal puis m'en vais dans la salle d'attente. Tiens, il y a déjà du monde qui attend. Un couple de baba-kool avec un gamin de sept-huit ans avec les cheveux blonds jusqu'aux épaules. Eh merde ! Ils parlent, Ils sont français !
Les baba-kool, c'est pas vraiment mon trip. Chuis pas militariste du tout mais pas non plus pacifiste bêlant, chuis pas écolo, et j'dis pas que j'aie jamais fumé des pétards mais c'était à Copenhague en 71 dans une communauté, ça duré une semaine, la belle affaire...
Bon, ils sont français. Ça doit être bon de parler français...
Nous voilà routards à nous raconter des histoires de routards. Eux sont partis avec une fourgonnette deux-biques qu'ils ont abandonnée en Afghanistan. Ils me racontent.
Puis je leur raconte. J'en suis à leur conter comment de la montagne lunaire en Jordanie, on voit d'un coup apparaître la mer Rouge, que l'on arrête son moteur pour se laisser descendre comme un tapis volant.
Vlà le gamin qui m'interrompt sans lever la main et qui me dit, b-ism Illah je vous le jure:
« Dessine-moi la descente sur la mer Rouge... »
Eh merde le petit salaud... Mon coeur a fondu...
Si t'as pas lu Le petit prince de St Ex', t'es pas trop allé à l'école, camarade. Bon, ça m'a peut-être marqué plus que la moyenne à cause des baobabs.
Toujours est-il que c'était le « dessine-moi un mouton » du Petit Prince. Un petit gamin aux cheveux blonds, rencontré loin, loin de chez moi, qui me demande dans ma langue de lui dessiner la descente sur la mer rouge, c'est encore plus coton que la laine d'un mouton, parole...
J'ai dû faire le coup du chais pas dessiner comme dans le bouquin, et ça m'a tout remué.
Une paire d'heures plus tard on avait nos visas, on sort du consulat, l'aspirant Petit Prince regarde la Puce « oh ! Elle est bien ta moto » c'est vrai que Puce est presque à sa taille. « Tu m'emmèneras faire un tour ? ».
A l'arabe, je propose à toute la clique de prendre le thé à mon hôtel. Quand j'y pense maintenant, ils ont dû trouver ça shadock. Offrir le thé ! Puis ils m'ont invité à fumer un pétard à leur hôtel, et le petit m'a demandé « tu m'emmènes faire un tour à moto ? »
Il devait être trois heures de l'aprem', eh, pourquoi pas ? Je n'avais pas encore visité Delhi, pourquoi ne pas le faire à deux ?
« Je vous le ramène à la nuit »
Leur hôtel est dans une petite rue qui mène vers la gare de New Dehi. N'étant pas un génie de l'orientation, je demande au petit avant de partir : « connais-tu le chemin de la gare à l'hôtel ?
-Oui, oui... »
On a roulé, roulé. De grandes avenues à l'Anglaise, de petites venelles larges comme des couloirs, dans des styles d'architecture parfois à coucher dehors, c'était chouette, chouette en bonne partie à cause du Petit Prince. Des trucs que j'aurais normalement négligés, je me disais « ça va l'amuser », et merde, ça m'amusait aussi.
Au coucher du soleil, on est revenu à mon hôtel Madras pour dîner, il était seulement sept heures du soir mais le petit prince a mangé comme un mendiant. Bizarre. Pendant notre balade, il avait fallu s'arrêter plusieurs fois pour qu'il pose un pain. En fait ça a l'air d'une obsession chez lui... Dysenterie ?
Après dîner, pour le remmener à la maison, on va à la gare de New Delhi, et que dit-il ?
-C'est pas cette gare !
-Tu blagues, c'est la gare de New Delhi !
-C'est pas cette gare !
-Ecoute, il n'y a que deux gares à Delhi, l’autre (Old Delhi) est très loin !
-C'est pas cette gare... »
J'me suis dit « c'est p't'être freudien ». mais bof. je n'ai pas protesté et l'on est parti vers la gare du vieux Delhi, du moderne on passe au colonial anglais, on ne peut pas confondre...
-C'est pas celle-là non plus ».
On est retourné à nouveau Delhi, c'était assez magique, parce sur la route il y avait des mariages de riches, donc des convois à dos d'éléphant tout illuminés, on ne voit pas ça tous les jours.
-C'est pas cette gare là »
On avait fait les deux gares de Delhi, et le petit n'en reconnaissait aucune. Trois semaines qu'ils sont là. Serait-ce vraiment freudien ?
Je remmène le petit à mon hôtel et fouine dans l'annuaire du téléphone. Je me rappelle que le nom de leur hôtel commence par « Shere », comme « Shere Khan » dans le livre de la Jungle de Kipling. Tiens à propos, « Shere » dans Kipling venait peut-être du verbe anglais « to shear », déchirer. Le maître du déchirage, beau nom pour un tigre...
Il n'y a qu'un hôtel Shere dans l'annuaire du téléphone : Shere Punjab.
Eulloh, Hôtel Shere Punjab ? Auriez vous une Lady Prigent, Pieuraille-dgi-hi-Henne-ti ?
-Hmmmmm lettemi-scie... Yes we have !
-Where are-you-the-hell-located ?
-Vous allez à la gare de New Dehi, et... »
Ça doit être freudien, ce gamin qui ne trouvait pas son chemin.
Je ramène finalement le petit à l'hôtel Shear Punjab chez papa-maman. A peine arrivé le voilà qui interpelle sa môman :
-Salut Marie Claude ! Je peux rester avec lui cette nuit, il me ramènera demain matin ! »
Eh merde ! C'était freudien...
J'ai donc ramené le Petit Prince, puisqu'il le voulait, à mon Madras Hôtel, et Allah sait ce qui est en nos coeurs, je l'ai lavé de mes mains.
Il était cradaud des pieds jusques aux yeux comme un sans-caste, le gamin.
Allah, le lavant je me sentais le faire éclore. Il a ri de me voir flipper quand j'ai vu qu'il avait des poux. Ya Allah ! Je n'avais jamais vu de poux ailleurs que dans un livre, bourgeois que j'étais !
Puis je l'ai porté jusqu'à notre chambre, vu qu'il n'avait pas de chaussures. Je ne sais ce qui de tout ça lui a été symbolique, toujours est-il qu'il m'a demandé :
-Où tu vas maintenant ?
-A Kathmandu, c'est pour ça que j'étais au consulat du Népal...
-Et après ?
-Au Japon.
-Et après ?
-Ben. ..Aux Amériques, peut-être...
-Je peux venir avec toi ? »
Ben voyons... Que diable répondre à un petit prince qui te pose ce genre de question ?
-Ben... Si tes parents veulent bien... Oui...
-Si on va en Amérique, tu m'emmèneras à Disneyland ?
-Ben... Si Dieu veut...
-Tu crois en Dieu ? Marie-Claude -sa mère- y croit pas.
-Moi non plus, pas vraiment.
-On ira alors ?
-Si Dieu veut, si on peut... »
Le lendemain, Petit Prince partait vers le Népal avec ses parents, et je restais à Delhi en attendant des visas et des sous. Je n'ai même pas parlé avec eux, le matin, de cette inimaginable adoption.
On s'est juste promis de se laisser un message à la poste restante de Kathmandu pour se retrouver plus tard, mais ça paraissait tellement lointain...
Je suis parti vers le Népal vingt-quatre jours après eux. C'est pour ça que Puce et moi, outre le fait d'être de très mauvais touristes, étions si pressés.
Huit jours après mon arrivée à Kathmandu, où je n'avais trouvé aucun message poste restante, je bullais un matin dans ma chambre, et j'entends un mezzo-soprano crier dans la cour « Il est là ! »
C'était le Petit Prince qui avait reconnu Puce ma moto.
Il s'est le soir même installé chez moi, et sa mère m'a dit « Il a envie de rester avec toi, si tu peux t'arranger pour les papiers, c'est d'accord ».
Ben merde alors... Voilà cet adorable petit animal qui vit avec moi. Envahissant.
Il a huit ans et demi, il est intarissable de questions sur ci ou sur ça. Il faut être toujours avec lui. Il mange comme quatre.
Il a effectivement une dysenterie amibienne qu'il traîne depuis des mois. Une semaine de traitement au Flagyl. Au début, la chiasse devient pire. Plus d'une fois, il largue dans son bène avant qu'on ait le temps de trouver un coin pour chier.
Y'a pas plus triste qu'un môme de huit ans qui vient de chier dans son calbe, parce que c'est plus de son âge ! Je « fais les couches » dans le lavabo et je ne sais pas trop quoi dire pour le consoler...
Je lui ai appris à jouer au tcheddé et aux échecs. Après dîner, on joue jusqu'à dix-onze heures au restaurant de l'hôtel, puis il tombe raide endormi.
Je ne sais si c'est pour de vrai ou si c'est pour que je le porte jusqu'au lit, mais chaque soir, je prends dans mes bras ce petit animal tiède et si souple, je pousse la porte de la cour, je fais demi-tour pour prendre l'escalier où les cafards volants zonzonnent, deux étages de marches au pas irrégulier, deuxième porte à droite, la clé, j'entre, le pose tout doucement sur le lit, le déshabille du peu qu'il porte, le flaire comme une mère chatte, il sent l'enfant, un peu sucré.
Je vous jure que je sens déjà s'il a trop chaud ou trop froid, si ci ou ça. Est-ce en dialecte alsacien que l'on souhaite « dormez bien, rêvez sucré » ?
Je me couche près de lui et m'endors comme un ange. Le matin, on s'éveille en même temps. C'est insensé comme on est bien ensemble.
Sa maman et le pote à sa maman -ce n'est pas son père- sont partis un matin à Benarès par Royal Air Népal pour rentrer en France via chais pas où en auto-stop, me laissant Petit Prince.
On les a regardés, Petit Prince et moi, plonger dans la montagne. Ça a eu l'air de ne lui faire ni chaud ni froid, mais la nuit-même, il a eu un mal terrible de ventre qui n'a passé d'un coup que quand je me lui ai dit « je vais aller chercher un docteur ».
Ya salam ! Allah m'a donné un enfant. Il sait ce qui est en nos coeurs...

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

L’aspect économique de la chose n'est pas à négliger. Pour venir de Delhi à Kathmandu, Puce et moi avions consommé 33,5 litres d'essence à quatre Roupies et 16 paisa le litre, soit 139 Roupies 36 paisa. Quel ne fut pas mon mécontentement d'apprendre que c'est plus coûteux que le train en première classe climatisée !
Maintenant que nous sommes deux sur la Puce, même en tenant compte du fait que Petit Prince ne paierait qu'une demi-place, nous passons le seuil de la rentabilité. Je ne pouvais pas tolérer être oversold par une entreprise nationalisée, tout de même !
Puce, Petit Prince et moi, nous avons commencé à sillonner la vallée de Kathmandu en essayant de nous habituer au style de conduite des Népalais. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est déroutant.
Il faut dire que l'obtention d'un permis de conduire, ici, coûte cinquante roupies, soit vingt francs tout compris, ce qui laisse supposer que la formation est quelque peu sommaire. En fait, il n'y a pas d'auto-écoles. La circulation est par conséquent folklorique, en fait les seuls éléments disciplinés de la circulation ici sont... les vaches.
Pas une rue, route ou carrefour sans vaches. Elles déambulent le long des rues, autour des places, se couchent au milieu des ronds-points pour surveiller la circulation en ruminant paisiblement, mais elles seules ne stationnent pas au milieu des rues, tiennent bien leur gauche lorsqu'elles se déplacent, ne vous doublent pas à droite pour tourner à gauche, et regardent bien des deux côtés avant de traverser. Je vous jure que c'est vrai.
La diversité des comportements humains fait de la circulation népalaise une source inépuisable d'étonnement, ou d'irritation si l'on est un tant soit peu pressé. En fait, être pressé semble la seule chose qui soit véritablement interdite par le code de la route népalais. A part cela, chacun fait calmement ce qu'il veut. Calmement... Au feu vert, les piétons descendent du trottoir, jettent un regard vide du côté circulation, et qu'il arrive du monde ou non, se mettent à traverser en regardant droit devant eux, calmement. Les rickshaws, ces tricycles à pédales qui trimballent
jusqu'à trois personnes, occupent le milieu de la route et mettent un quart d'heure à démarrer au feu rouge, charge oblige. Dans les montées, le « chauffeur » descend de la selle et pousse son ustensile chargé de passagers, calmement. Les vélos transportant deux ou trois personnes louvoient au milieu des rues, calmement. Calmement aussi, les autos vous doublent à droite avant de tourner dans la première rue à gauche. Les conducteurs, après, ouvrent des yeux ronds lorsque Petit Prince les réprimande dans la langue de l'astéroïde B 612. En Bésicendouzien, « Monsieur vous nous gênez » se dit « Tutpoussécon » ou quelque chose de la sorte.
En fait, ici, le temps ne semble pas compter pour grand chose. C'est le pays de la lenteur encore plus que l'Inde qui, pourtant, se défend farouchement dans la spécialité. Rien de plus normal que de mettre deux heures à changer un chèque de voyage, d'attendre tout un jour une communication téléphonique.
Rien de plus normal si, lorsque vous demandez au restaurant un plat figurant au menu, vous voyiez un petit commis partir calmement au marché avec son petit panier sous le bras pour aller chercher de quoi faire le plat en question. Qu'est-ce que le temps, puisqu'après la mort, selon sa religion on sera réincarné ou on aura l'éternité devant soi ?
Le temps, c'est de l'argent. Les Népalais, pas peut-être ceux des boutiques ou des hôtels de luxe, mais les Népalais normaux, traitent l'argent comme ils traitent le temps. On ne vous présente pas la note toutes les semaines ou tous les jours, mais quand on a besoin d'argent.
Ben oui, à quoi bon réclamer de l'argent dont on n'a pas encore besoin ? De même, si l'on n'a pas la monnaie de votre billet de 100 Roupies, on vous la donnera demain. Ça énerve beaucoup les étrangers de l'Ouest souvent avides de comptes justes et immédiats, mais ça permet de se voir plus souvent, et c'est parfois bien pratique quand on est souvent sur la corde raide comme Puce, Petit Prince et moi.
C'est moins sec et plus accommodant que le comptant ou la traite à 30 jours fin de mois. En écrivant cela, je m'aperçois que je commence à m'habituer au Népal.
Les premiers temps ont été relativement durs de ce côté. C'est un peu dommage, car il faudra bientôt partir d'ici pour aller vers l'Inde du Sud et le Japon. Il faut qu'on y soit avant la fin du mois prochain, sinon ça va faire des salades de visas à renouveler et c'est de loin le plat le plus difficile à digérer que je connaisse.
Remarquez, de toutes façons, il va falloir recommencer la valse des tampons pour que Petit Prince puisse venir avec moi, alors... On verra. On aimerait bien pouvoir traîner encore un peu sur le continent indien, malgré la mousson...
C'est vrai... En fouillant dans mon sac, je suis tombé sur trois passeports. Le gros brun, « Fédération Internationale Automobile », celui de Puce, un petit bleu « Công Hôa Xâ Hôi Viêt-Nam », le mien, et un autre bleu « République Française », celui de Petit Prince.
C'est vrai qu'on est trois maintenant. Ça m'oblige à secouer beaucoup de poussière parce que même en voyage, surtout peut-être en voyage, à vivre seul on vit surtout pour soi.
D'abord, le problème technique du poids. Vingt quatre kilos et demi de plus, pour une moto de la taille de Puce, c'est considérable. En fait, moins problématique qu'il n'y paraissait au départ. La bascule de l'aéroport de Kathmandu m'a appris que j'ai perdu 8 kilos depuis Damas. Passer du format photo 6X6 à 24X36 à Delhi a diminué la charge de six kilos, plus que 10 kilos à perdre.
Quand on on trimballe 38 kilos, ce n'est pas bien dramatique. Ma garde robe en a pris un coup. Ma collection de T. shirts, mes deux pantalons « bourgeois », mon sac à dos, ont disparu dans les boutiques « j'achète tout, je vends tout » de Jochen Tole, dite « Freak Street » rue ainsi nommée à cause de sa densité considérable de fumeurs de chillum (pipe droite pour fumer le haschisch) au mètre carré.
Avec quelques douloureux sacrifices, on est arrivé au poids réglementaire. Ça, c'était le handicap technique. Le reste... Le reste c'est apprendre à vivre ensemble. Tout un programme.
Ménager des horaires pour apprendre à Petit Prince l'alphabet terrien qu'il n'avait guère eu le besoin d'étudier sur son astéroïde, lui apprendre à conduire la Puce (bien plus facile) et lui trouver des occupations pendant mes heures de travail.
Ça, ça c'est résolu en lui ouvrant un compte chez le loueur de vélos. Pendant que je vous écris, je le vois passer tous les quarts d'heure, rouge comme une pivoine (entre les pluies de mousson, il fait diablement chaud) descendant la rampe de Maru-Hity pire que Joël Robert au Grand Prix des Nations.
Il s'en sort bien, depuis le début, il n'a pris qu'une bûche, le premier jour à Durbar Square, devant le temple de Ganesh. Le voyant prendre ses virages avec l'angle limite, genou sorti à la Brian Steenson, sur son « Hero sport course » made in China, j'étais allé à la pharmacie acheter un flacon d'antiseptique et du coton, dix minutes après on étrennait la bouteille. Depuis, je la trimballe toujours dans mon sac.
Vivre à trois... Pendant toute la route qui nous reste à faire, et Shiva veuille qu'elle soit longue, nous serons trois. Excusez-moi. Il faut que j'aille arrêter un moment Petit Prince, à pédaler sans cesse comme ça en plein soleil, il va nous péter un joint de culasse.
Kathmandu, samedi
Une semaine de plus à Kathmandu. Vous savez ce qui m'arrive ? Non, je n'ai pas eu un deuxième enfant, j'ai affiché un panneau « no vacancies » sur la Puce. C'est autre chose : je commence à aimer Kathmandu, je commence à aimer le Népal.
Au début, le Népal et les Népalais me faisaient un peu chier. Le plus frappant, en dehors de leur incroyable placidité, est leur curiosité insatiable alliée à un sans-gêne assez surprenant.
Arrêtez-vous n'importe où, même en pleine campagne, pour retendre votre chaîne, mettre de l'huile dans l'Autolube ou n'importe quoi d'autre, et en l'espace de deux minutes surgissent du néant des gamins, adolescents et même adultes par dizaines, qui scrutent, palpent, commentent votre bécane, tout à fait comme si vous n'étiez pas là.
Une fois que vous avez poussé un coup de gueule pour qu'on cesse de tripoter votre poignée de gaz, vos commodos, bref tout ce qui est susceptible d'être tripoté, toute l'assistance s'assoit ou s'accroupit en rond autour de vous comme autour d'un conteur d'histoires.
Le moindre de vos gestes est commenté à haute voix, discuté, puis approuvé ou désapprouvé... Au nombre de voix. Très, très difficile de contrôler un allumage, par exemple, quand on se sent épié par cent regards, dans un brouhaha de commentaires dont on ne comprend pas un mot.
Quand la pince croco du testeur saute du « plus » du rupteur juste au moment où vous arriviez en face du repère, normal vous dites « merde ». Tous les spectateurs se mettent à rire, et commentent entre eux le mot bref que vous venez de proférer. « Bzz... bzz... bla... bla. "Merde !" Ma, bla, bzz bzz... hi ! hi ! hi ! "Merde !" bzz, bla, bla ! bla ! hi ! hi ! » ça dure une éternité.
Quand le boulot que vous avez à faire est simple et routinier, c'est supportable, ce genre d'ambiance de travail, et encore !... Mais lorsqu'il s'agit de réduire l'avance à l'allumage de l'équivalent en degrés de trois dixièmes de millimètre pour essayer de faire fonctionner un peu mieux une moto avec un carburant à très faible degré d'octane, il vous prend assez rapidement des rages meurtrières, des envies de faire éclater des crânes, d'arracher des yeux, de disperser des membres sanglants sur les cailloux tranchants de la route, d'enfoncer des cages thoraciques à grands coups de talons de bottes, bref litoti-sons en disant que ça met de méchante humeur.
Inutile de chercher à se cacher pour bricoler. Je suis sûr que si vous alliez réviser votre trapanelle dans une caverne sombre et inconnue à vingt six mille trois cent quatre vingt douze pieds sous terre, vous auriez encore cinquante Népalais pour venir commenter le spectacle.
Hé bien je m'y suis fait. Hier, j'ai résolu devant cent cinquante spectateurs de tous âges un problème de boisseau de gaz qui revenait mal. Je croyais que la transmission était morte (elle a 18 000 bornes ou quelque chose comme ça), mais balle-peau, ces transmissions japonaises durent des siècles.
En fait, c'est le pétrole lampant que j'ai utilisé une fois comme carburant qui avait gommé le boisseau. La présence des spectateurs ne me gênait plus. Bien au contraire, je me suis mis à ponctuer mes réflexions de « madshi-gny ! », qui est en gros le « merde » népalais, pour que ça rigole encore plus fort.
Ça a suffi à briser la glace entre les Népalais du coin et nous. Maintenant, chacun de nos passages dans Maru-Hity est ponctué de « Namastè ! » (bonjour). On se connaît un peu puisqu'on a rigolé ensemble.
Le paquet de « beedies » et la boîte d'allumettes sont miraculeusement descendus, au tabac d'à côté, de une roupie quinze paisa à une roupie juste, et plein de petites choses comme ça.
A moins j'y pense, que l'on soit plus gentil avec moi parce que je suis père célibataire ?
Kathmandu... Le Népal. Je crois avoir compris le secret... Non, quel secret ? La raison de la tolérance incroyable des Népalais. Sans la tolérance, le Népal n'existerait pas, tout simplement !
Pensez qu'au dernier recensement on dénombrait, sauf erreur, trente sept religions différentes au Népal. S'il y avait des guerres de religions, il n'y aurait plus un Népalais vivant. D'abord... Qui est Népalais ici ? Sont-ce les Newars, les Tomangs, les Gurungs, les Mangars, les Kirantis, les Tharus, les Thakals, les Bothyas, les Sherpas ?
Pour être Népalais, faut-il adorer Agni, Yama, Surya, Sakya-muni Prajnaparamita, Krishna, Indra, Ganesh, Brahma, Bouddha, Avalokitisvare ou Jacques Chirac ?
Le Népal, c'est une tour de Babel, alors, vous pouvez être de race aryenne, africaine ou moldo valaque, adorer la déesse Moto, le dieu Chillum ou le Lingam électrique, on ne vous en tiendra pas rigueur, on n'est pas à une ethnie ni à une religion près.
Comme la tour de Babel, le Népal va peut être s'effondrer et mourir, parce que le monde d'aujourd'hui, avide d'alliances et d'alignement (je ne veux voir qu'une tête) n'admettra plus longtemps que dans un tout petit pays on ait encore le droit d'adorer Dieu, Allah, Ganesh ou Karl Marx.
Au nord, la Chine, au sud l'Inde. La Chine a bouffé le Tibet, même si elle a du mal à le digérer, l'Inde a avalé le Mustang et le Sikkim, l'étau se referme.
Déjà, ici, ça sent la poudre. Emeutes, grèves, manifs, les montrouducutistes et les antimontrouducu-tistes préparent les lendemains qui saignent, et tapis aux frontières nord et sud, chinois et indiens attendent probablement que ça saigne suffisamment pour avoir une raison humanitaire de faire entrer le Népal dans leur rang.
Peut-être dans trois mois, peut-être dans cinq ans, province chinoise ou état indien ? Les paris sont ouverts. Toute considération politique mise à part, j'aimerais mieux les Indiens. Au moins, la frontière restera ouverte. Cela dit, j'en connais plus d'un qui aura un petit pincement au cœur le jour où la tour de Babel s'effondrera en silence.
Nom d'un chien... Qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà que je m'accroche au Népal. Remarquez, c'est la moindre des choses, Kathmandu ne m'a-t-elle pas donné un enfant ? Même sans la fumée des chillums, ici, je baigne dans une atmosphère irréelle. Il y a une distance invraisemblable entre ce qui était ma vie il y a un an, à Paris, et l'espèce de rêve éveillé que je vis ici.
Ici, il y a deux, ou plutôt trois catégories d'étrangers : il y a les mauvais coucheurs qui passent leur temps à râler parce que les hôtels pas chers sont cradauds (c'est vrai), parce que le service des restaus est terriblement lent, c'est souvent vrai aussi, parce que les Népalais sont curieux comme de vieilles chattes et rigolent à tort et à travers, c'est vrai, parce que, parce que... En fait les raisons sont innombrables.
Il y a les freaks intégraux, perdus toute la journée dans la fumée des chillums. perpétuellement enfermés dans leur « trip » intérieur. Ils ont au moins le grand mérite de vivre leur vie sans faire de bruit, mais la communication avec eux est parfois terriblement réduite.
Enfin, il y a ceux, « fumeurs » ou pas qui sont là parce que Kathmandu est une ville tout de même assez extraordinairement belle, même si en moyenne elle est assez crasseuse et ne sent pas que l'encens et le jasmin, que les gens sont souriants et très souvent sympas, et qu'on y vit à peu près comme on l'entend. Simplement heureux d'être là, en somme.
On vient ici pour voir et l'on y prend goût, alors on reste délibérément, ou bien l'on fait le coup « freudien » de la lettre qu'on attend, du fric que l'on se fait envoyer pour acheter un tapis tibétain à l'oncle Ernest, étant donné qu'un transfert bancaire d'Europe au Népal prend joyeusement quinze jours à trois semaines selon le sens du vent, ça fait un joyeux rabiot, de plus, il n'est pas interdit de vouloir plusieurs tapis tibétains, pas vrai ?
Les renouvellements de visas deviennent difficiles au bout d'un mois et demi à trois mois selon l'humeur des fonctionnaires, alors on retourne un petit moment en Inde, on redemande un visa consulaire à Delhi, et l'on recommence.
Il y en a, comme ça, qui sont ici depuis un an ou deux, et pas forcément des drogués frénétiques, n'en déplaise aux amateurs de drames humains, du « flip » à la une, c'est bon coco, gros plan sur la seringue de 150 ce et la veine du bras dilatée comme le Graff Zeppelin.
Avec Marcel et Brigitte de Paris, qui ont franchement loué une jolie maison avec du bois sculpté partout (350 F par mois), Monique de Bruxelles qui, le croirez-vous, attend des sous pour acheter un tapis tibétain à son frère, « docteur » Slim de Lausanne qui part demain à Delhi comme copilote d'autobus pour aller chercher un nouveau visa consulaire, et un paquet d'autres, on a formé une petite communauté.
On se prête tout, on se fait les commissions les uns des autres, on se passe tous les tuyaux possibles et imaginables, depuis le restau bon pas cher jusqu'au gars qui rentre à Paris par avion et qui peut y emmener le tapis de Monique ou bien le texte que je suis en train d'écrire, pour que les films ne risquent pas d'être piqués par un postier famélique qui se dit qu'une enveloppe gonflée comme une génisse amouillante doit contenir des tas de trucs qui valent plein de sous.
Bref, on s'entr'aide, on vit bien ensemble, on est heureux d'être là et que les autres soient là aussi. Bien sûr, ça pourrait, ça devrait être pareil ailleurs, partout. Seulement, il faut croire qu'ici c'est plus facile, puisque ça s'est fait spontanément, sans effort. Peut être, sûrement que l'ambiance de Kathmandu s'y prête, ajoutée au fait que nous sommes tous loin de tout, de notre passé surtout.
S'il est vrai qu'il y a des « paumés » à Kathmandu, Kathmandu n'est pas obligatoirement un lieu de perdition. Ceux qui sont « paumés » ici le seraient aussi ailleurs, peut-être, sûrement plus, puisqu'ici, au moins, on leur fout la paix.
Il paraît que c'est pareil dans le sud de l'Inde. Quand on partira d'ici, Puce, Petit Prince et moi je crois que c'est là qu'on ira... Tant pis pour la mousson, on trouvera des combinaisons étanches.
Je croyais que les pluies de mousson étaient chaudes, hé ben pas tant que ça.
Mercredi dernier, on puçouillait tran-quillosse du côté de Bhaktapur, à une trentaine de bornes d'ici, un coup de mousson surprise nous est tombé sur le paletot. Pluie chaude macache bono. j'ai chopé une bronchite, le lendemain matin, j'avais la voix de Paul 6 en fin de carrière.
Depuis, tcheu ! Tcheu ! Malgré les pilules ayurvédiques du Mahatmah Krashtonboudmou, je suis obligé de trimballer un seau de cent litres avec moi pour recueillir mes expectorations, sinon même les aveugles pourraient me suivre à la trace en tâtant du pied par terre, et les enfants me poursuivraient pour pouvoir y faire flotter leurs petits bateaux en papier.
Que ceux qui pensent que la mousson est la meilleure amie du motard m'envoient 50 kilos de ouate thermogène du docteur Chalumot, ils ont lamentablement perdu.
Faut dire que côté salubrité, j'ai dû déjà vous en parler il y a deux semaines, mais ça mérite d'être souligné à l'encre rouge. Le Népal, c'est pas ça qu'est ça. Les discussions entre routards au Népal ressemblent souvent à celles que tiennent devant leur camomille à la saccharine les grands-mères souffreteuses.
C'est à qui décrira la dysenterie la plus cataracteuse et sanguinolente, les nausées qui vous remontent le gros côlon jusqu'aux amygdales, la fièvre qui fait fondre le manche de la cuillère en acier chromé qu'on s'était mise dans le clapoir pour ne pas se couper la langue à force de claquer des dents, l'éraflure minuscule qui s'est infectée au point de vous faire le petit doigt gros comme le pneu AR du dragster de Russ Collins, enfin, pour les santés un tant soit peu fragiles, le Népal est tout de même très loin de valoir la Suisse.
En 1692, un Européen, si je me rappelle bien (j'étais jeune), c'était un grec nommé Axion Prophylaxis, est demeuré trois mois au Népal sans contracter la moindre maladie. Lorsqu'à l'âge de 311 ans, il se suicida, désespéré par son treizième veuvage, son corps fut un temps conservé à l'institut bactériologique de Séxéduvis qui le fit bientôt inhumer dans une île lointaine de la mer Egée, car la simple présence de la dépouille de Prophylaxis faisait tourner les bouillons de culture à trois cent seize kilomètres à la ronde.
A l'heure qu'il est (il est dix neuf heures seize à Kathmandu, dont l'heure officielle est dix minutes en avance sur celle de Delhi, en France je ne sais pas trop, avec l'histoire des horaires d'été et divers, je suis perdu), les vers n'ont pas encore réussi à entamer son épiderme.
Comment ? J'exagère ? Tiens, toi, non ! Toi là, saute un peu sur ta draisienne et viens voir par ici, je te parie dix flacons d'Intetrix qu'en trois semaines maxi tu te fais porter pâle. Non pas de l'Intetrix, ça ne marche pas pour les dysenteries d'ici, qui sont la plupart d'origine amibienne.
Le best seller local, c'est le Flagyl, 45 Roupies la boîte de 100, et pour l'analyse de... chose, c'est 15 Roupies à la clinique au coin de Dasrath Path, en face de la librairie américaine, on est prié d'amener sa... ses provisions, comme ici on ne vote pas souvent, il n'y a pas d'isoloir.
Parole, si le toubib de l'ambassade de France faisait payer ses consultations, il prendrait tous les matins son OW 31 pour aller à l'aéroport prendre son Mystère 20 personnel pour filer à Toussus le Noble prendre sa Harley XLCH 1000 plaquée or et aller chercher les 20 kilos de caviar de son petit déjeuner.
En fait, depuis la semaine dernière, il est en vacances, il comptait se faire un trekking dans l'Himalaya, mais c'est tombé à l'eau, tu sais pourquoi ? Ben... Il a chopé une hépatite virale.
Pourquoi tu tousses ?
En Afrique, entre deux gueules de bois, un toubib local me prétendait que le meilleur désinfectant interne, surtout pour les amibes, est le Whisky. Seulement y'a problème : sur les routes d'ici, à cause de la poussière, je bois à peu près cinq litres par jour. Faut tenir !
De plus, le whisky népalais est au Chivas Régal ce que l'huile de foie de morue est au jus de mangue ou de n'importe quoi de vraiment bon. Enfin, depuis que Petit Prince est avec moi sur la Puce, je me suis promis de tomber moins souvent...
Voilà Petit Prince qui déboule sur son vélo sport-course made in China. C'est l'heure de sa leçon de conduite sur la Puce. On fait ça le soir Koulosse discrétosse sur le lit d'une rivière presque totalement à sec, sur la route de Swayanbu.
A cette heure, il n'y a personne, et les alluvions juste un peu humides, c'est assez idéal comme terrain : en cas de bûche, on se salit, c'est tout. Il est super doué, le petit prince. Il faudrait qu'il fasse une école de trial pour enfants, tiens au Japon peut-être.
Dites les Moto-Clubs trialeux, quand xéxé que vous secouerez assez les puces de la fédé fran-çouaise pour qu'elle nous crache une division moins de 14 ans en trial, comme chez les British où les gamins peuvent trialiser à partir de six berges ? Des trucs super-safe, tout en bourbiers et en zones lentes dans du mou, enfin, vous voyez, quoi ?
Y'a qu'à demander conseil aux Godons, ca fait cinq ans qu'ils pratiquent le truc... Hein quoi j'utopise ? Je veux bien admettre qu'ici je vis un peu comme dans un rêve, m'enfin, de l'autre coté du Channel, ils la vivent, l'utopie dont je parle, alors ? Bon, c'est pas tout. Utopie ou pas, Petit Prince, Puce et moi, on va aller se taper notre leçon de trial le long de la rivière. Ici, on s'en fiche que Petit Prince n'ait que huit ans, il n'y a pas de fédé moto au Népal, alors, on ne risque pas le retrait de licence. A toute...
Ah ! Lea jacta est, comme on dit dans les bouquins que l'on peut se vanter d'avoir lu : ce jour sera sauf erreur le dernier que Petit Prince et moi passerons à Kathmandu.
Demain matin, à l'heure où blanchit la campagne et où les premiers chillums commencent à s'allumer dans les chambres d'hôtels louches de Jochen Tole dite « Freak Street », on va mettre les voiles, aller voir si le soleil brille mieux ailleurs, sur la côte orientale de l'Inde, par exemple.
Menu de demain, passer l'Himalaya et arriver à la frontière indienne, puis Patna et Calcutta, qui sera à priori notre prochaine longue escale. Avant de quitter le Népal, Petit Prince et moi avons fait, ces deux derniers jours, un petit tour d'horizon des lieux où les touristes à fric passent leur séjour kathmandoutesque, hier, on est allé à l'Oberoï Soaltee****.
Oh ! Pas pour y dormir, vous savez, notre petite piaule de Maru-Hity nous convient très bien, même s'il y a plus de cancrelats que de feuilles sur un basilic, même si l'on doit faire la chaîne avec deux vieilles boîtes de conserves, dont une qui fuit, pour emplir la chasse d'eau, même si... Non ! Ici, je crois qu'on se sentirait un peu ridicule de coucher dans un machin climatisé, où l'on nous changerait les draps tous les jours, (vous vous rendez compte ? tous les jours !!!) ousqu'on nous servirait des oeufs frits-bacon au lit sur un coup de téléphone (c'est vrai qu'on aurait le... le... téléphone !).
Bon. De toutes façons, le « single » à trois cents Roupies et des poussières par jour, c'est pas vraiment ce qui s'appelle dans nos prix. Au fait, trois cents Roupies népalaises, ça fait combien chez nous ? Attendez... Boah, à peu près cent dix francs, pas la mort, mais...
A vivre en Inde ou au Népal, où l'on bouffe comestible pour deux Francs dans un restau, où l'on se loge habitable pour quatre ou cinq Balles, bref où tout ce qui est essentiel coûte infiniment moins cher que par chez nous, on acquiert très vite une notion de l'argent disons... décalée.
Aussi subit-on un sacré choc lorsque l'on doit payer des trucmuches dont les prix sont plus ou moins internationaux : essence, communications téléphoniques, télex, visas, papelards officiels, hôtels de luxe, etc.
On va prendre un exemple. Puce, ma Mini Yam unique et préférée, possède un somptueux réservoir à essence qui peut contenir quatre virgule huit litres de jus de derrick. Ça signifie que quand je m'arrête pour faire le plein, si je n'ai pas touché à la nourrice de secours, c'est grosso modo quatre litres de « Château Aramco millésime 79 » que j'achète, ce qui me vaut généralement, en dehors du tiers-monde, un regard éminemment méprisant de la part des pompistes.
En France, cette orgie essencielle me coûtait autour de dix balles. Dix balles, qu'est-ce que c'est chez nous ? Que dalle, de quoi se payer un biftèque gros comme un paquet de Gitanes avec des frites molles qui puent le graillou au restau « chez Mimile », vin et service non compris !
Dix balles... Qu'est-ce que c'est, dix balles ? Dix balles, c'est vingt Roupies indiennes, vingt Roupies que je crache à chaque fois que je passe à la pompe. Vingt Roupies, dans pas mal de régions de l'Inde, c'est une semaine de salaire d'un ouvrier agricole. Vingt Roupies, ce sont cinq repas dans un restau pas trop cher. Vingt Roupies... Vous ne vous rendez pas compte, vingt Roupies ! ! !
Quand je suis venu ici de Delhi, en couchant à la belle étoile et mangeant dans les petites échoppes en bord de route, quatre-vingt-dix pour cent de ce que je dépensais passait dans l'essence ! J'en arrivais à regarder la Puce de travers comme une femme trop dépensière. Tu me reviens cher, tu sais, avec tes trois litres au cent ! Si j'étais parti avec une moto « normale » je crois que je serais devenu fou...
Autre exemple encore plus impressionnant. Savez-vous combien coûte un passeport cocorico de chez nous ? Ben mon pote, si tu ne passais pas tes vacances chez ta cousine de Palavas-les-Flots tu le saurais, c'est dix sacs, soit cent Balles eh nouveau franquiste. Ouiche, d'accord, c'est cher pour un petit carnet bleu minable avec la photo d'un mec même pas beau que t'as certainement déjà vu quelque part, même que la photo n'est pas fournie avec, il faut que ce soit toi qui l'amènes, en plus on t'estampe, on te demande plusieurs photos et on n'en met qu'une, l'horreur, quoi...
Quèque on peut avoir d'autre en France pour dix sacs ? Pas grand-chose d'intéressant en dehors d'un abonnement de six mois à Moto Journal : ça représente une bonne bouffe vin et service compris, un feu arrière complet (et encore !) pour ta moto de luxe, hè frimeur, bref point grand chose.
Ici, a Kathmandou, lorsque j'ai payé le passeport de Petit Prince, on m'a demandé cent francs comme à tout le monde, seulement, cent francs ici, c'est, au cours consulaire, deux cent quatre vingt Roupies et quatre-vingt-dix paisa, soit : cinquante-six steaks de buffle grillé avec frites (si !!!) et légumes à notre restau habituel, soit cinquante-six repas exotiques et plantureux là où nous nous trouvons. Soit : trente-cinq jours de logement au « Guardian Lodge » au bout de Maru Hity que je ne conseille pas because à partir de onze heures il faut faire le mur pour entrer et sortir et que c'est bourré de moustiques, alors disons dix-sept jours et demi là où nous logeons, Petit Prince et moi, ou encore, et là on tombe peu ou prou dans la lutte de classes, un mois à un mois et demi de salaire d'un employé népalais.
Vous mordez le topo ? Ici, c'est pas pareil. D'avoir vu de l'intérieur les résidences pour touristes à fric, après quelques bons mois d'existence disons... modeste, en Inde et ici, ça m'a fait penser que ce devait être un peu dur pour l'autochtone, même si, ici, il a l'air d'avoir l'indifférence solide.
J'imagine un employé de la Népal Rastra Bank, je dis celle là parce que j'ai appris qu'ils avaient fait une grève récemment, se disant qu'il lui faudrait craquer deux à trois mois de salaire pour passer une nuit, repas non compris, dans une chambre simple de l'Oberoï, de l'Annapurna Hôtel ou autres, devant lesquels il passe tous les jours en allant au charbon. Ouatch !
Si le père Zola n'avait bêtement cassé sa pipe, il viendrait illico ici faire son dernier best seller, « Qu'elle était blanche ma montagne »...
Bon... Petit Prince et moi, on est loin, très loin d'être assez friqué pour loger dans ces machins-là. Hier, Petit Prince, un peu fasciné par le quatre étoiles, m'a demandé combien de temps on pourrait rester là dedans avec le fric qu'il nous reste pour vivre jusqu'à notre arrivée à Calcutta.
Il a un peu toussé quand je lui ai répondu « un jour et demi, si on se passe de bouffer ». Néanmoins je lui ai demandé de choisir dans le menu ce qu'il avait envie de manger, il a choisi... un sandwich jambon-beurre. Ne riez pas, si c'est un truc aussi courant que minable chez nous, c'est ici quelque chose de tout à fait introuvable en dehors des hôtels internationaux où les gens veulent manger comme chez eux.
Cependant le côté « petit Français de classe modeste » de ce choix m'a ému et fait longuement réfléchir... Il m'émeut souvent, en fait, le Petit Prince, et me fait beaucoup réfléchir. Je suis content d'être en consultation permanente de sa vision du monde. Je ne ris pas de lui en disant « comme c'est charmant ! » Il me fait vraiment réfléchir.
N'empêche... N'empêche qu'ici, on triche, parce que, je crois, le tourisme dans le tiers-monde est toujours un peu, beaucoup de la triche. Si un jour on se trouvait pour une raison ou une autre dans la super-lerdemuche, j'aurais des copains, des parents, des Moto Canard ou autres qui nous enverraient des billets made in France, made in USA ou autres qui nous sortiraient bien vite du guêpier pour nous ramener à notre vraie place : celle de visiteurs venus de pays riches.
On ment, on triche. Salauds ! Bof, même pas. On paie partout le prix normal et même plus, même si l'on marchande tout à cause de la « distorsion » dont je vous ai parlé. Si ce sont souvent des gamins de l'âge de Petit Prince qui nous servent dans les restaus pas chers où l'on bouffe, ce n'est pas tellement notre faute. On en profite, on est complice, voilà...
Bref, on s'en va. En un sens, Kathmandu nous manquera, Kathmandu avec ses je ne sais combien de temples ou l'on prie non-stop pour des dieux aussi divers que variés, Kathmandu où l'on peut faire à peu près n'importe quoi et vivre n'importe comment, à condition toutefois d'être étranger !..
C'est le côté un peu flippant de la chose : ici, j'ai parfois l'impression d'être juste un peu trop étranger. Allez, il Faut aller se coucher, demain on se taille...
24 juillet 1979
Essayez un peu pour voir de deviner où l'on est... Perdu ! On est dans la salle de départ de l'aéroport de Calcutta ! ! ! A travers la baie vitrée, je vois un tracteur orange et blanc qui tire sept remorques de fret que l'on va coller dans le bide du DC 9 du Scandinavian Air System quand il daignera arriver, il est trois heures à la bourre, Inde oblige.
Savez-vous ce qu'il y a sur la cinquième remorque ? Une caisse de bois à claire-voie dans laquelle dort la plus belle moto du monde, ma Puce à moi.
On s'en va, direction Tokyo, et puisqu'il fallait attendre presque un mois pour le prochain bateau, on avionne. Pourquoi tant de hâte ? Je crois bien qu'on en a un peu ras le bol du tiers monde, et de l'Inde en particulier.
L'Inde après un peu plus d'un mois de Népal, c'est trop dur. Je n'aime pas l'Inde, peut-être ne suis-je pas allé dans les endroits qu'il fallait, parce qu'elle me rappelle un peu trop l'Afrique, peut-être que là aussi je n'étais pas allé aux bons endroits. En tous cas, je me retrouve dans la même position qu'au Niger il y a... oh... presque quatre ans, le temps passe : soit rester ici avec une mentalité de colonialiste, c'est-à-dire en considérant les Indiens comme des sous-hommes, tout juste bons à travailler pour nous à bon marché, ou paquer mes clous, prendre mon Petit Prince par la main et ma moto sous le bras, et aller me faire voir ailleurs. Même situation, même réaction, on s'en va...
Alors, mon coco, on fait la gueule ? On n'arrive pas à digérer le tiers-monde ? Ben oui, y'a de ça, je n'arrive pas à m'habituer aux ex-colonies, voilà. Ces pays ont été profondément, trop profondément marqués par une longue occupation venue d'occident. On leur a imposé un mode de vie, un système qui n'était pas fait pour eux, ils en ont gardé pas mal de travers sans toujours en assimiler les avantages.
Ajoutez à ça un énorme complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident et ça vous donne une ambiance que je n'encaisse pas, voilà... A part ça, tout va bien... On m'a fauché mon dernier appareil photo, mais ça, c'est un incident de parcours sans intérêt particulier.
La route s'est bien passée, mis à part qu'on a eu un peu froid dans l'Himalaya, pluie, brouillard, enfin on n'en est pas mort. On a failli écrabousiller cent vingt-sept Indiens, quarante-deux vaches dont quatre amouillantes, en quatre jours relax on a fait Kathmandu-Calcutta.
Calcutta... Quel drôle de bled ! Une densité de population absolument invraisemblable, on peut rouler tout droit pendant deux heures sans sortir de cette fourmilière, de cette jungle plutôt.
Ici personne ne fait de cadeau à personne, tout se vend, et quand je dis tout, c'est vraiment tout ! Devant la porte de l'Armée du Salut ou l'on crèche -ne haussez pas les épaules, ici c'est payant et plus cher que pas mal d'hôtels- il y a presque tous les soirs un marchand de n'importe quoi, « Haschich ? Héroïne ? Non ? Vous voulez une femme ? Une femme chinoise ? Un jeune garçon ?
Oh, ne croyez pas que ce soit ça qui me chasse, oh non ! Qu'à Calcutta on puisse louer une femme chinoise ou un jeune garçon et que dans toutes les rues il y ait des publicités pour les cliniques spécialisées dans les maladies vénériennes, ça me laisse plutôt froid.
Non. C'est le fait qu'on ne puisse parler cinq minutes avec quelqu'un sans que ça glisse dans l'affairisme, le fait que les « petits chefs » autochtones, ceux qui ont deux ou trois galons, adorent faire chier le riche étranger (ici, tous les étrangers sont des riches) pour lui montrer qu'il a du pouvoir, le fait que l'on ne puisse discuter de l'Inde avec un Indien sans qu'il vous dise que c'est le meilleur pays du monde...
C'est tout de même marrant d'entendre un Indien dire à un Américain que les States sont un pays où l'injustice sociale règne, lorsque l'on se trouve en Inde et que l'on voit ce qui s'y passe, enfin... C'est le fait de n'avoir pas pu avoir de rapports disons... sains avec un Indien.
On termine cependant notre séjour sur un grand rire. On est allé au centre culturel de l'ambassade de France à Calcutta histoire de voir un film français. Le film en question était exactement dans l'ambiance de Calcutta fin juillet en période de mousson. Il fait à Calcutta une chaleur humide étouffante, et vers deux heures de l'aprem' jusqu'à quatre heures, il pleut à seaux, mais à seaux ! !
Lorsqu'on est allé au centre culturel à pieds, ça moussonnait tout ce que ça pouvait : on n'y voit pas à dix mètres. Comme le système d'égouts de Calcutta date de la guerre des Gaules -en fait probablement de l'Empire britannique-, beaucoup de rues s'inondent.
Dans celle qui mène au centre culturel, Petit Prince avait de l'eau jusqu'aux cuisses. On marchait en chantant « Les bateliers de la Volga », il y avait des taxis, des rickshaws en panne avec leur moteur noyé un peu partout, qui riaient nous voyant passer en chantant, tout va bien, ce n'est que la mousson !
Le film, c'était « Mort d'un guide ». Après avoir vécu une heure et demie de la vie de guides de haute montagne dans les Alpes, se retrouver dans les rues de Calcutta après une pluie de mousson, ça vaut son coup de cidre...
Blague à part, dans une douzaine d'heures, si l'avion se décide à arriver, on sera au Japon.
Ouillaillaille ! Je crois bien que ça va nous faire un drôle de choc. Petit Prince et moi, même si nous ne sommes que depuis un mois ensemble, cela fait l'un et l'autre à peu près sept mois que nous vivons plus ou moins dans le tiers-monde, et vlan, on va d'un coup débarquer au pays du miracle industriel.
Ça fait une sacrée paie que je rêvais de voir le Japon, chuis tout zému. Douze heures, dans douze heures. Aouah ! Après l'Inde, je crois bien que ça va être le choc des mondes. Allez, je range mon bloc notes, j'ai oublié d'acheter des clopes hors taxes, et il paraît qu'elles sont chères là-bas. On se retrouve au Japon, nom de Dieu, ça fait tout drôle d'écrire ça...

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Japon
Shizuoka, dimanche
Au Japon... On est au Japon... Ça fait déjà trois jours et je ne me suis pas encore fait à l'idée. Pourtant, quand je regarde par la fenêtre de l'hôtel, je vois des boutiques tout ce qu'il y a de japonaises, avec des enseignes en japonais dans le texte, et, sur le pont là-bas au bout de la rue, je vois, tous les quarts d'heures, passer le Shinkansen, le train tout profilé blanc et bleu qui ramone à deux cents à l'heure.
Évidemment, il ne passe pas à deux cents ici, vu qu'il s'arrête à Shizuoka. Disons que quand il n'est pas arrêté sa vitesse de croisière est de 200 à l'heure. Je relis ce que je vous ai écrit de Calcutta, je parlais d'un choc, c'est vrai qu'on a eu un choc, le premier : les prix ! ! !
On est donc arrivé vers onze heures du soir à Tokyo, Petit Prince, Puce et moi. Vu qu'il n'était pas question de dédouaner Puce à cette heure-là, on s'est mis en quête d'un coin pour dormir.
Seulement, l'aéroport de Narita est à soixante-dix bornes du centre de Tokyo ! Habitués à l'Inde, pour cause, on s'est enquis du prix d'un taxi. Ça commençait bien : tarif minimum douze mille Yen, deux cent quarante Balles ! ! ! Le bus direct, deux mille trois cents Yen, etc.
En plus, il faut compter une heure et demie pour arriver au centre ville. Le plus sage paraissait de rester à Narita pour dédouaner Puce le lendemain matin. On est donc allé au bureau de tourisme, pour demander une place dans l'hôtel le moins cher de Narita. OK, nous a dit le réceptionniste, Narita Airport Guest House.
Il s'est mis à remplir le bordereau de réservation, j'ai respiré, because dans beaucoup de pays, les « guest houses » sont des machins pas chers. On m'a tendu le bordereau « voilà, neuf mille Yen ». J'ai fait gloups, 180 Balles pour l'hôtel le moins cher même à proximité d'un aéroport, ça commençait dur dur.
Faut dire que la « guest house » n'était pas à proprement parler un nid à cafards. Salle de bains avec de l'eau chaude, (si !) et qui marche, télé en couleurs avec une douzaine de chaînes, et qui marche aussi, téléphone d'où l'on peut appeler en direct tout le Japon et l'international (0051), un grand pucier confortable à souhait, mais 180 Balles, soit trois-cent soixante Roupies indiennes, cinq cents Roupies népalaises, l'angoisse ! Fini le tiers-monde, on entre dans un pays où les services sont chers.
Par contre on était fasciné par notre chambre : y'a plein de trucs qu'on tripote pour voir à quoi ça sert, tout a l'air neuf, tout est propre, et tout marche. C'est ça le plus fou, tant sur le continent indien on s'était habitué à ce que rien ne marche, jusqu'aux choses les plus simples : dans notre piaule de Kathmandu, par exemple, au delà des lumières, de la plomberie, de la robinetterie, du ventilateur qui sont des sources de pannes chroniques, ça allait jusqu'au porte-savon incorporé à notre lavabo fabriqué en Inde qui était incapable d'empêcher de glisser un morceau de savon quelque soit sa forme ou sa taille.
Sur le sub-continent indien, quelque chose qui marche est une exception, une source de surprise. Alors, Petit Prince et moi n'en finissons pas d'essayer des trucs et d'être surpris qu'ils marchent.
On n'en finit pas de tout regarder, surtout les machines : des machines pour tout : des machines à rouler, bagnoles de style américain, taxis jaunes et rouges, tous beaux et pleins de lumière, après les caisses indiennes, toutes semblables, ayant l'air toutes vieilles même quand elles sont neuves, choc !
Cyclomoteurs utilitaires innombrables, souvent pilotés par des mecs costard cratouze attaché case, apparemment ici ce n'est pas une honte de circuler sur un 50 ce, motos, bien sûr, mais moins nombreuses que je le pensais.
Ce qui m'a scié le plus est le nombre de minis Yam, et de mini-motos en général. Version tout terrain, version route, version café-racer, on roule mini tant qu'on peut. Voilà des gens de goût !
Machines pour tout. Machines à boisson, coca, orange, citron, café froid ou chaud, thé, bière, saké, vitamines A, vitamines B, vitamine C, sortez vos pièces de cent Yen, cloquez-les, et ça descend dans un grand bruit d'avalanche.
Machines à clopes, machines à jouets, machines à capotes, machines à dire la bonne aventure, machines à sous « Space Invader », le jeu qui fait fureur au Japon, machines à journaux, machines, machines, machines.
On n'en finissait pas de les dénombrer et de voir ce qui en sortait, plats froids, soupe chaude, journal du soir ou raton laveur. Tant qu'on y était, on aurait vu une machine à vendre des motos qu'on n'aurait pas été plus étonné que ça.
Il a fallu bouffer. Vu l'heure, on n'avait guère d'autre choix que le restau de l'hôtel, on s'est de nouveau heurté aux prix. Dix sept Balles le plat de spaghetti, même avec la sauce bolognaise, ça donnait à réfléchir. On a mis long temps à composer un menu qui ne nous laisse pas sur la paille.
Pour sûr, ça va être dur, c'est à un pays riche que l'on s'attaque, fini de se foutre du prix des plats parce que de toutes façons ça n'est pas cher pour nous. Fini de rigoler avec le tiers monde, parce que le tiers monde, ici, c'est nous...
Le lendemain matin, on est allé à la douane pour aller libérer la Puce. Les douaniers de l'aéroport n'en sont pas revenus. Quoi ? Vous êtes arrivés avec une moto ? Une moto japonaise ? De Calcutta ? Vous avez payé combien pour la faire emmener ici ? Mais... vous savez que pour ce prix, ici vous pouviez presque en acheter une neuve ? Ah, c'est votre moto... So, so, so...
Ils se sont mis à trois à feuilleter le manuel en trois tomes du parfait petit douanier, pendant que l'on sirotait, Petit Prince et moi, le soda qu'ils nous avaient offert. Après le soda, on a eu du thé, la valse des petits bouquins continuait.
A la fin, l'un des tabellions a ameuté les autres : il avait trouvé la marche à suivre ! Le chef s'est excusé en rougissant comme une jeune mariée : excusez-nous, mais, vous savez, c'est la première fois que quelqu'un arrive ici avec son véhicule, alors... on n'a pas l'habitude !
En fait il fallait aller à l'Automobile Club du Japon pour faire certifier le carnet de passages en douanes de Puce, puis revenir avec le formulaire numéro V1000, alors on pourrait obtenir la « custom clearance » et prendre possession de la Puce.
Je suis donc allé à l'automobile club, près de Tokyo Tower, la Tour Eiffel du coin, en train et métro. C'est ainsi que j'ai découvert l'horreur que pouvait constituer le fait d'être illettré. Ben oui, mon pote, illettré. Non, c'est pas vrai, tu ne peux pas savoir, non que tu sois spécialement plus gland que les autres, mais simplement parce que tu viens de lire ce que j'écris.
Illettré, non, tu peux pas savoir. Quand tu te trouves à la cambrousse ou dans le désert de Gobi, ça doit aller. Mais dans une grande ville, dans un lieu conçu pour ceux qui savent lire, oh, mec !!!
Le jap, tu dois savoir, ça s'écrit avec des tas de petits dessins tous plus compliqués les uns que les autres, et le Japon est une île, donc un pays qui a sur le plan physique, si j'ose dire, peu de contacts avec le monde extérieur. Mis à part les endroits très fréquentés par les rares étrangers, c'est partout écrit avec les fameux petits dessins.
Illettré... pour acheter le billet de train, regarder pendant cinq minutes une machine pleine de boutons, quarante-quatre sur celle là, sur lequel faut-il que j'appuie ?
Illettré... pour aller à la station Machincaca Sébézé ou j'sais pus quoi, faut-y que je prenne le couloir de gauche ousqu'y a marqué un petit bateau, une fenêtre et un petit bonhomme assis, ou çui là avec un pendu, deux yeux qui pleurent avec un grand nez, et deux T, un à l'envers et un à l'endroit ?
Illettré... la sortie, c'est le panneau vert avec plein de machins marqués dessus ou le rouge avec plein de trucs ?
Illettré !!! Demander, toujours demander, se faire guider par la main comme un aveugle, heureusement, les Japs ont l'air super kool, super serviables, parce que sinon, maintenant encore, je serais en train de tourner en rond dans un couloir de métro, à me battre avec des petits bonshommes avec une queue, des verres renversés, des pendus (le pendu, en jap, ça se lit « Hara ») et des petits bateaux.
Ça, il va falloir que je m'y fasse : ici, je suis illettré, et pas mèche pour en sortir : l'Arabe, c'est quelques jours d'attention, les caractères arabes ne sont pas les mêmes que les nôtres, ils ont souvent des formes différentes selon leur position initiale, médiale ou finale dans un mot, on a tendance à ne pas écrire les voyelles brèves (bof, il n'y en a que trois) mais il n'y a pas plus de caractères que dans notre alphabet latin.
Le japonais, autre affaire : il doit falloir, si on ne m'a pas raconté de salades connaître deux à trois mille caractères ou combinaisons pour commencer à lire le courrier des débutants. Pas d'espoir. Je suis illettré ici, et je le resterai jusqu'à mon départ. Sensation nouvelle, sinon agréable...
Le lendemain, je suis retourné à la douane, et j'ai eu ma « custom clearance », c'est-à-dire que j'ai été autorisé à importer ma moto japonaise au Japon. C'était pas fini, il a fallu s'assurer, depuis la Syrie je roulais sans assurance. Là-bas ça aurait eu l'air d'un gadget de luxe...
Ça a été dur... Une demi-journée. On m'a dit que les marchands de moto pouvaient fournir des assurances, je suis allé chez le concessionnaire Yamaha-Honda de Narita, de toutes façons j'avais des tas de bricoles à acheter pour la Puce : un phare standard japonais, oh, merveille, avec dix watts de moins qu'un européen blanc acheté en Suisse, il éclaire trois fois mieux, quant à le comparer avec le jaune français que j'avais au début, boaaah...
De la graisse, un casque petit format pour Petit Prince, introuvable au Népal ou en Inde, une seconde clé de 17, bref bien des choses. Le concessionnaire parlait un ou deux mots d'anglais, mais vraiment pas plus. Tant que ca a été des morceaux de moto, des vis de 5 pas ISO ou des rondelles Belleville, pas de probloque : j'ai assez traîné dans les magasins ou ateliers de moto pour savoir où l'on range d'habitude les choses, c'est international. Il a suffi de courir comme une puce d'un bout à l'autre du magasin, sous l'œil amusé du proprio, pour faire le stock complet.
Assurance, ça a été plus dur à expliquer : en fin de compte, il a fallu que M. Yamahonda passe un coup de grelot à un des copains qui parlait un peu plus anglais pour qu'on se mette au diapason. Essayez un peu d'expliquer « assurance » par gestes ! ! !
Chez Yamahonda, on ne pouvait pas m'assurer, because ma plaque d'immatriculation française. De toutes façons, je crois que même avec le pote au téléphone, on s'est mal compris. On m'a fait emmener en voiture devant une chouette truc style temple grec avec des banderoles pleines de petits bateaux, de pendus, de réchauds à gaz avec trois pieds -bref vous savez le japonais aussi bien que moi, maintenant- en me faisant signe « c'est là ».
Je me suis dit que les compagnies d'assurances japonaises avaient de bathes chouettes sièges sociaux avec une architecture folklo et tout, je suis entré, ou je ne m'y connais pas, ou c'était un temple ou quèque chose du même tonneau. Y'avait eu maldonne, je crois. Certes la protection d'un dieu est sans doute la meilleure assurance imaginable, mais ce qu'il y a est que les dieux aussi puissants et magnanimes qu'ils soient vous donnent rarement une attestation susceptible d'être montrée aux autorités.
Après avoir essayé de trouver un passant anglophone, je suis allé dans une librairie acheter un dictionnaire anglais/japonais, et je montrais à la cantonnade le drôle de salamalec écrit là dedans en face du mot « Insurance ». Bien longtemps après, on m'a fait trouver.
Après un long coup de téléphone au siège central de la compagnie (une plaque étrangère est aussi rare ici qu'un ours polaire dans le Hidjaz) ma Puce s'est retrouvée assurée, pour un an, pas de contrat temporaire.
J'étais mort de trouille au moment de la note, vu les prix effrayants en vigueur à peu près pour tout, eh ben non : cent dix Balles pour un an, cinq fois moins cher que ce que je payais pour la Puce à Paris. Ça y était, on pouvait aller chercher la Puce et prendre la route, le lendemain matin, c'est-à-dire hier... Autant le dire tout de suite, ça n'a pas été tout seul...
Custom clearance, assurance, on était en règle. Je suis retourné à la douane prendre la Puce, que j'ai poussée jusqu'à la pompe à essence la plus proche. Mon premier choc de motard au Japon a été là : le plein complet de mon réservoir totalement à sec cause règlements de transports aériens m'a coûté 611 Yen.
Oui, d'accord, ça fait douze francs et vingt-deux centimes, mais faut pas compter comme ça : après l'hôtel à 180 Balles la nuit, le plat de spaghetti à dix-sept balles et tous les prix démoniaques que j'avais payés jusqu'ici, ça m'a paru donné, dérisoire.
Ici, l'essence n'est pas chère. Sensation exactement contraire de celle que j'éprouvais en Inde. Autre monde...
Hier matin, on s'est donc mis en route très tôt, Petit Prince. Puce et moi, direction Hammamatsu, là où se trouve l'usine qui a vu naître ma Puce. A peu près quatre-cents bornes, on comptait y être à l'aise dans la soirée, en partant à cinq heures du matin. Ho là là, on ne savait pas à quoi on s'attaquait...
Partant de l'aéroport, on a pris l'express-way, qui rallie Narita à Tokyo proprement dit. à soixante ou soixante-dix bornes de là. Pendant les trente ou quarante premières bornes, tout a été OK : on a l'habitude de rouler à gauche, après quatre mois d'Inde et de Népal.
Au second péage (Oh ! ! les prix des péages, affolants !) on s'est fait virer de l'expressway pour cause, si j'ai bien compris, de cylindrée insuffisante.
Ça a été un désastre, parce que d'une part, l'expressway va direct de Narita à Tokyo, et que d'autre part ses panneaux sont inscrits en japonais bien sûr, mais aussi en caractères européens. On s'est donc d'un coup retrouvé dans une zone style proche banlieue de Paris, avec des coins, des recoins et des sens interdits dans tous les sens, et des panneaux indicateurs qu'on était infoutu de lire...
Diabolique... Ca a été diabolique. Imaginez-vous radiner pour la première fois dans la banlieue de Paris, de Lyon ou de Marseille, ne sachant ni parler, ni lire. On a roulé au compas, vers ce qui logiquement devait être Tokyo.
Après, comment allait-on faire pour trouver la route d'Hammamatsu ? Après avoir roulé je ne sais combien de temps, nous être arrêtés je ne sais combien de fois pour agiter les bras dans tous les sens sourcils levés, en demandant « Tokyo ??? » on a fini par arriver quelque part dans Tokyo.
Seulement, vu que nous ne savions même pas où nous étions, trouver la route d'Hammamatsu. ..
On a demandé à deux ou trois passants, mais on devait mal s'expliquer, ils nous disaient des tas de trucs en japonais qui ne nous apprenaient pas grand'chose. Le troisième nous a amenés chez un marchand d'accessoires auto, qui a sorti tous les plans, guides, atlas et mappemondes qu'il avait en stock, puis, après une longue réflexion, nous a amenés à la « Police Box », c'est-à-dire chez les flics.
Là, ils se sont longuement concertés puis nous ont dessiné un plan super-détaillé en couleur et en relief, pour nous indiquer la route à suivre. Le plan a bien marché au début, puis on s'est reperdu.
On s'est retrouvé devant une gare, où l'on a trouvé un oiseau rare : un japonais qui parlait couramment anglais ! C'est tout simple, nous a-t-il dit, il faut suivre tout du long la « Route No 1 ». Elle va à Hammamatsu. On a trouvé, en moins d'une demi-heure, la Route No 1, on s'est cru sorti de l'auberge. Point du tout ! Ça ne faisait que commencer...
Bon Dieu... La route n° 1... Je crois que je n'oublierai jamais... Après la panique du faubourg sans fin avant d'arriver à Tokyo, les innombrables arrêts pour demander si Tokyo était bien là, les innombrables arrêts aux feux rouges, les innombrables sens interdits à éviter pour aller on ne sait où, j'étais déjà pompé.
Que voulez-vous, depuis Athènes il y a... oh, merde ! Il y a huit mois, on n'avait pas circulé, Puce et moi, dans une grande ville comme chez nous, avec plein de sens interdits, plein de feux rouges et plein de bagnoles.
Des bagnoles, ici, il y en a... c'est pas croyable. Heureusement pour les gnaces à deux roues, très nombreux, surtout les cycloteux, les automobilistes japonais ne sont vraiment pas chiens : ils laissent toujours, vraiment toujours, suffisamment d'espace à gauche (n'oubliez pas, ici comme en Inde et au Népal, on roule à gauche) pour que les deux roues doublent quand ça se traîne ou remontent la file quand c'est bloqué.
Tout de même, n'ayant plus l'habitude de la ville, j'étais mort. Quand on a trouvé la route n° 1, on s'est arrêté pour bouffer. Il était onze heures et demie. En six heures et demie, on avait dû faire... soixante à quatre-vingts bornes de notre itinéraire, mais combien en réalité ? Ça restera éternellement un mystère...
On a bouffé une soupe aux nouilles vite fait sur le gaz, et on a attaqué la route n° 1. J'avais une hâte : sortir de la ville pour pouvoir rouler pépère, relax, le nez au vent, quitter cette putain de ville, qui après des mois de tiers monde, me flanquait la trouille.
J'imaginais la route n° 1 comme la Nationale 7, une fois sorti de la banlieue de Paris, avec une moto pas trop rapide, c'est assez pépère. Bon Dieu de Bon Dieu, quand c'est qu'on sort de c'te banlieue ??? Je me suis posé la question pendant des heures et des heures.
Pour une bien bonne raison, on est resté en ville pendant plus de deux cents bornes.
Le Japon n'est pas un pays, c'est une ville. En suivant la fameuse route n° 1, vous partez de Tokyo, vous arrivez dans les faubourgs de Tokyo, vous entrez dans les faubourgs de la ville suivante, puis dans la ville elle-même, puis dans les faubourgs de l'autre côté de la ville, puis les faubourgs de la ville d'après, puis... ça n'arrête pas.
La route n° 1, on l'a perdue au moins cent fois, parce qu'ici, d'une part, on ne peut pas lire les panneaux sauf quand, et c'est rare, ils sont aussi écrits en caractères latins, et d'autre part parce que la signalisation n'est pas fichue comme chez nous : quand la route va tourner, vous avez une petite flèche discrète sur le panneau bleu qui l'indique.
Au carrefour, par contre, il n'y a souvent rien, On s'est perdu, perdu, perdu, comme des pilotes d'enduro quand la pluie et le vent ont arraché les flèches du parcours, et on n'en finissait pas de ne pas sortir de la ville.
Quand on en est sorti, pas pour longtemps, on a abordé la montagne. Il commençait à faire sombre. C'était chouette, plus de feux rouges tous les 500 mètres (je n'exagère pas) pour sûr il faisait presque nuit, pour sûr, il y avait du brouillard dans la montagne et il faisait frais, Petit Prince râlait un peu, mais c'était chouette d'avoir un peu de route avec autre chose que des immeubles autour.
Il y avait aussi pas mal de motos avec armes et bagages, des motards en week-end, de toutes les cylindrées, depuis les Puces comme la mienne jusqu'aux Harley, toutes deux étonnamment nombreuses.
On se saluait, on se faisait des signes. Petit Prince a discuté pendant une demi-heure par signes avec une 125 qui nous suivait, sûr que c'était chouette.
Seulement, plus on grimpait dans la montagne et plus il y avait de brouillard. On reconnaissait les panneaux de notre route au fait qu'ils sont bleus, au bout d'un certain temps, on a commencé à s'inquiéter de ne plus voir de panneaux bleus. On était perdu dans la montagne.
Avec ces panneaux qu'on ne pouvait pas lire, ce putain de brouillard, on n'était pas sorti de l'auberge. On était arrêté au bord de la route à se gratter la tête, un automobileux... pardon, un automobiliste s'est arrêté pour nous demander, en anglais s'il vous plaît, s'il pouvait nous aider.
On était vraiment paumé. Le gars a mis une demi-plombe à nous trouver un itinéraire pas trop brouillardeux, donc pas trop en altitude, pas trop difficile à trouver, pas trop... En fin de compte, pour être sûr qu'on ne se repaume pas, il nous a accompagnés jusqu'à l'endroit où l'on ne pouvait plus se tromper.
A partir de là il suffisait de suivre les panneaux avec un petit bateau à deux mâts, une fenêtre avec trois vitres en un bonhomme agenouillé, pour retrouver notre route. Je cite ce mec là parce que là, on était vraiment paumé, que Petit Prince avait froid, mais le nombre de gars qui ont passé du temps à essayer de nous expliquer le chemin, à nous dessiner des plans (je dois à l'aise en avoir une douzaine dans mes poches), vous savez qu'ils sont chouettes, ces Japs...
Sorti de la montagne, on est arrivé ici à Shizuoka. Il était dix heures du soir, ça faisait donc 17 heures qu'on roulait et l'on avait fait, sur le plan de l'itinéraire, à peu près 300 kilomètres...
On a cassé la dalle dans un restauroute, et un mec rencontré là a téléphoné à tous les hôtels du coin pour nous trouver une chambre à un prix abordable, 4 800 Yen, 96 Balles. Pas cher pour le Japon...
L'usine Yamaha où nous sommes invités est fermée le dimanche et le lundi. On est donc resté ici, à Shizuoka. On est encore sous le choc du Japon.
Trop de différences entre l'Inde et ici, on n'arrive pas à assimiler ça si vite. La foule, les bagnoles partout, les feux rouges partout, cette chiée langue qu'on ne peut pas lire, tous ces mecs qui se cassent le tronc pour vous aider, le Japon en pleine poire après l'Inde, c'est trop, ça je l'avais prévu avant de partir de Calcutta.
Petit Prince, fort de ses huit ans, encaisse bien mieux que moi. Pour lui, passer de l'Inde au Japon est comme passer d'un jeu à l'autre : les règles changent, mais c'est toujours jouer.
C'est lui qui a raison : au fond, on joue. Seulement, je prends le jeu trop au sérieux. Aujourd'hui et demain, on se repose. Lundi, on a soixante-dix bornes à faire pour aller à Hammamatsu, je veux que la Puce revoie la ville ou elle est née. Après, on va essayer de voir, de sentir, de toucher le Japon. Ça ne va pas être trop facile, je crois...
Hammamatsu, Jeudi
C'est dur, dur... Je commence à paniquer un peu. Quelle galère de débarquer dans l'un des pays les plus chers du monde avec un enfant à charge et trois cents Dollars en poche.
Demain matin on va prendre la route de Osaka, avec comme viatique un plein d'essence et vingt-sept Yen, cinquante quatre centimes.
A Osaka, on va tâcher d'entrer en contact avec un mec qu'on ne connaît pas, mais dont un Japonais rencontré à Kathmandu la veille de notre départ nous a donné l'adresse, en nous disant que c'est son meilleur pote, qu'il est super-sympa et qu'il nous aidera.
A quoi ? A trouver du boulot, par exemple. Du boulot, du boulot... La seule solution ; d'après le gars de Kathmandu, c'est très facile de trouver un boulot temporaire au Japon, bien payé et tout.
C'est le seul moyen de continuer : on n'a pas fait le point, mais je dois devoir une montagne de fric à Moto Canard, il va falloir s'arrêter quelque temps pour recharger les batteries, Il faut trouver quelque chose, vite, vite...
On est allé faire une visite à l'usine Yamaha. Heureusement, l'importateur Yam en France, qui savait qu'on allait s'attaquer au Japon, avait prévenu Yamaha-Japon qu'ils risquaient d'avoir notre visite, parce que sinon...
Voyons... Essayons d'expliquer ça clairement.
Bon : déjà, avant mon départ, j'avais déjà une réputation de doux dingue. Il va de soi que plus d'un an d'errance à travers le monde n'ont pas amélioré la bête. En bref, j'crois bien qu'ils m'ont pris pour un fou.
Remarquez, quand j'y repense, il faut se mettre à leur place : imaginez que vous soyiez la Yamaha Motor C°, société anonyme au capital de je ne sais combien de centaines de milliards de Yen, second constructeur mondial de motos, et on vous annonce la visite d'un journaliste étranger.
Jusqu'ici rien d'étonnant, mais c'est alors qu'au lieu du journaliste attendu vous voyez radiner, un beau matin, chevauchant un GT 80 hors d'âge et pas lavé depuis le dernier orage, un chevelu pas rasé, fringue comme un clodo, accompagné d'un enfant de huit ans qu'il dit avoir trouvé à Kathmandu le jour de la lune de Shiva, qui ne sait pas ou coucher la nuit prochaine vu qu'il n'a pas un sou en poche, qui n'a même pas d'appareil photo vu qu'on lui a fauché son dernier du côté de Calcutta, qui cherche un boulot temporaire n'importe où pour survivre et continuer son voyage.
Déjà en Europe, on aurait tendance à appeler Police-Secours pour faire envoyer le mec dans un asile psychiatrique. Au Japon, alors... Je m'en rends compte progressivement, comparée au Japon, l'Allemagne passerait pour un pays bordélique et désorganisé, imaginez l'effet, Ouillallaille... Quel programme... Je me rends compte que je vais avoir une triple tâche : survivre et faire survivre mon Petit Prince, apprendre le Japon donc réapprendre la civilisation en général. Ça promet...
Chez Yam, ils n'ont pas appelé Police-Secours : après une conférence qu'ils ont tenue au débotté en nous demandant d'attendre dans une autre salle, ils ont fait un plan ORSEC, paré au plus pressé. Ils nous ont logés, nourris, arrangé un check-up médical pour Petit Prince, fourni pneus, chaîne, batterie, mâchoires de frein neuves pour Puce et même des fringues pour nous, histoire qu'on ait un peu moins l'air de romanos. On a visité l'usine, ou plutôt l'une des usines.
Mazette... Je n'avais jamais visité d'usines moto qu'en Europe, maintenant je commence à entrevoir comment, au Japon, on arrive à faire des bécanes nickel à des prix sans concurrence. Les chaînes tournent tellement vite, sans que les ouvriers aient le moins du monde l'air de se presser, que ça n'a pas l'air vrai.
A un bout, des morceaux de bécane, à l'autre bout, une moto qui ronfle impec, vrounch vrounch, et qui s'en va, et ça se passe à une vitesse hallucinante.
Bon. On reparlera de tout ça plus tard, si on arrive à se sortir de cette panique, on reviendra visiter l'usine, mais sérieusement comme il faut, impec et tout.
Pour le moment, il faut s'occuper de survivre et se sortir du kakâ. La pension complète au Mitsui Urban Hôtel à Hamamatsu aux frais de Yam, c'est le confort, la bouffe est bonne, le pinard japonais se laisse fichtrement bien boire, surtout le Mercian et le Sainte Neige, mais nom d'un chien il faut qu'on s'en sorte.
Bon. C est pas tout, ça, faudrait p'têtre que je vous parle un peu du Japon, jusqu'ici on était en panique, en transit, remarquez qu'ici aussi, mais à Hammamatsu, on est tout de même resté quatre jours, alors ?
Alors c'est fou, le Japon est sauf erreur le vingt deuxième pays dans lequel je m'insinue, et je crois bien que jamais de ma vie je ne me suis senti aussi dépaysé. Une chose d'abord, la langue ; ici bien évidemment on parle japonais, mais très peu de gens parlent la langue internationale, j'entends par là l'anglais ; jusqu'ici, étant donné que je côse français couramment dans le texte, que je spique fluently l'engliche, que je parlotte l'italien avec plein de fautes de grammaire, que je hable l'espanol avec des italianismes et que je bafouille vaguement l'arabe syrien, que je sais demander deux trois trucs essentiels en allemand et en grec, tout ceci étant le fruit commun de l'enseignement libre et gratuit et du voyage, j'arrivais à me faire comprendre à peu près partout.
Bon, dans certains coins (campagne yougoslave et bulgare, Turquie, et une fois en Utar-Pradesh, Inde) je me suis trouvé en face de gens avec qui je ne pouvais trouver un langage parlé commun. En ce cas, restaient les mains ! C'est fou ce qu'on arrive à bien parler avec les mains, même en-dehors des pays méditerranéens.
Ici, non, si vous essayez d'exprimer gestuellement quelque chose, on vous répond en paroles, les bras le long du corps, en japonais évidemment !
Ce n'est ni méchanceté ni mauvaise volonté, de toute évidence, mais dû au fait que le Japon est une île, et qu'en-dehors des très grandes villes, on n'a à peu près jamais affaire à des étrangers. Le langage des mains est donc totalement ignoré. Pas facile...
De temps en temps, on tombe sur quelqu'un qui a quelques connaissances d'anglais, suffisamment par exemple pour vous indiquer le chemin de tel truc : dans ce cas, ça donne un anglais adapté à la prononciation japonaise normale, ou les doubles consonnes, par exemple sont très rares. Ca donne : « Léfto, wône, tou, sri, righto, straighto, police box, righto, Yamaha cômpany ».
Généralement, après avoir expliqué deux fois ça, le gars sort un papier et un crayon et dessine un plan. J'ai les poches bourrées de plans que l'on m'a dessinés tout au long du chemin, rien que depuis notre arrivée à Hammamatsu on a bien dû en récolter un dizaine.
Bon. La langue, c'est une chose énorme, mais j'ai tout de même, en particulier chez Yamaha, affaire à des gens qui parlaient très correctement anglais ou français. Cela dit il y a eu pas mal de moments où en parlant la même langue on ne se comprenait de toute évidence pas du tout, sur le plan des idées, de la logique, de... je n'arrive pas encore à analyser, mais de toute évidence on ne parlait pas la même langue tout en parlant le même idiome, on terminait une conversation avec la sensation de n'avoir pas compris et de ne s'être pas fait comprendre.
On ne naît pas impunément à un tiers de tour de terre de distance. Ceci, c'est avec les hommes. Avec les femmes, ça va beaucoup beaucoup mieux, pour deux raisons apparemment: primo, il y a Petit Prince.
Ici, un enfant aux longs cheveux blonds et aux yeux bleu-vert, c'est un extraterrestre, une curiosité invraisemblable ; les hommes regardent le phénomène, mais la plupart du temps froidement, en coin, à part peut-être les vieux, mais je n'ai pas encore pu faire de statistiques.
Les femmes, par contre, y vont franco : elles regardent, s'exclament, s'approchent, contemplent, parlent, font parler, (mais ma parole, ça vit, ça n'est pas un mythe) touchent (des vrais cheveux blonds bouclés), mirent (de vrais yeux bleus) et embrassent en riant.
N'y voyez pas trop de symbole sexuel, d'une part Petit Prince n'a tout de même que huit ans, d'autre part, les Japonais et Japonaises n'ont pas l'habitude de voir des garçons à cheveux longs, et prennent dans 90 % des cas Petit Prince pour une princesse. Ou je me goure complètement, ou bien ici, à l'opposé de chez nous et de beaucoup de pays, les femmes sont plus « nature » que les hommes.
Du coup, jusqu'ici, j'ai eu des relations beaucoup plus faciles avec les femmes, une meilleure compréhension, de meilleures vibrations, quoi ! En Europe, misogynie à part, c'est plutôt le contraire, parce qu'en Europe, les femmes font du cinéma. Ici, apparemment, ce sont les hommes qui jouent un rôle. Bon, je dis ça, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule, impression personnelle, sensation du moment. On verra, plus tard...
Bon, c'est pas tout, il faut que je roupille maintenant : demain, il faut se tailler tôt. juste après le petit déjeuner, heureusement les ptits dej' japonais sont bien copieux à l'anglaise, parce qu'après, on ne pourra bouffer qu'à Osaka si le pote du pote est là.
On n'a même pas assez d'essence pour arriver à Osaka, faudra se démerder en route. J'ai voulu mettre ma chevalière, mon seul et unique bijou, au mont-de-piété, ils m'ont proposé 3000 Yen, soixante Balles pour une maltouze petite, mais en 18 carats dûment poinçonnée par la République Française, faut dire que peut-être ils ne voient pas souvent l'aigle français sur des bouts de joncaille.
Peut-être qu'ils confondent ça avec le tampon de la quincaillerie Borniol. Pas question de mettre au clou pour six sacs, surtout à 200 bornes du présumé point de chute (merde ! 400 bornes pour aller la récupérer) cette bagouze-là ; ce petit bout de jonc, c'est Anne, et Anne...
Ben... Ben pas au clou pour soixante balles, merde... Ben voilà. Je ne sais pas si j'ai fait une connerie ou pas en ne mettant pas ma maltouze au clou. On aura de l'essence jusqu'à Nagoya, normalement, et après ? Oh, on n'est plus en Inde ni en Arabie, mais doit y'avoir moyen de se démerder, tout de même. Je vais dormir...
On a eu du bol... Sur toute la ligne, tout s'est passé impecc : on est passé sur réserve vingt bornes après Nagoya, ou plutôt la dérivation vers Nagoya, puisque la route n° 1 la contourne. On était parti de Hammamatsu avec 27 Yen, cinquante quatre centimes, donc, pour le ravitaillement, faudrait magouiller...
Chez Yamaha à Hammamatsu, entre autres cadeaux, on nous avait filé une bombe anticrevaison. Je ne peux pas m'en servir, vu qu'il y a déjà du Fiat Proof dans mes chambres à air (cadeau de Godier et Genoud lors de mon passage à Viry, en Savoie il y a. oh... au début de l'été 78, Georges Godier a été le dernier mec du milieu moto qu'on ait vu en France).
Bref j'avais voulu expliquer que je ne pouvais pas me servir de ce truc à cause du flat proute, mais, on en a déjà parlé, incompréhension. En plus avec son étui en nylon spécial tout-terrain ça faisait franchement course sur la barre de renfort du guidon de Puce.
En roulant, j'avais la bombinette perpétuellement en vue, devant le compteur et le compte-tours. Pour être sûr de ne pas arriver trop tard à Osaka, on était partis à la fraîche. J'étais ensuqué, et Petit Prince aussi, faut dire que c'est marrant, on dort toujours en même temps.
Je ne peux pas dormir avant lui ; c'est normal, c'est moi le papa en quelque sorte. Seulement, je me suis progressivement rendu compte que souvent, pour lui, c'est pareil : il me parle de choses ou gestes que j'ai faits bien après l'heure où je le croyais endormi.
Donc, je roulais en somnolant, d'autant plus que la route était facile et très peu fréquentée, pour vous dire, à peine plus que la Nationale 7 au mois d'août. Bref, le désert, japonaisement parlant.
C'est là qu'au bout de quatre ou cinq heures, à force de me faire doubler et de darder un œil sur le compteur de Puce, je me suis aperçu que les Japs ont au moins un point commun avec les Français : ils ne respectent pas les limitations de vitesse !!! Non !!! Remarquez qu'au fond, si : ils se basent dessus, mais c'est toujours quinze bornes au-dessus.
Si vous respectez à la lettre les limitations, on vous double tout le temps. Si vous roulez avec quinze bornes de mieux, un fou vous double ou vous doublez une moule toute les demi-heures.
Bref, apparemment, la loi tacite est : le panneau plus quinze. Donc je roulais à 5000 tours, tiers des gaz, l'œil vague, et Petit Prince, derrière dormait. Je sais qu'il dormait parce qu'il me serrait plus fort et que sa tête pesait lourd entre mes épaules.
C'est là qu'il a fallu passer en réserve. Bon... Prochaine pompe, faudra s'arranger. Que pour-rais-je échanger contre de l'essence ? Ben... Mais oui ! La bombinette à pneus qui pendouille devant moi !
Une dizaines de bornes plus loin, une station sur la gauche. Je m'y engage, l'arrêt réveille Petit Prince. On descend, le pompiste radine, souriant. Dou you spike ingliche ? » Il sourit encore plus large, Ici, je commence à m'y faire, ça veut souvent dire « non », ou « je ne comprends pas » ou « je suis gêné ».
Je commence à expliquer par gestes « Essence, fini, fric, fini, ça, pour toi (la bombe anticrevaison) et je conclus en disant « OK ? »
OK, ça existe aussi en japonais, ça je l'ai vu sur des tas d'affiches de pub, partout, petit bateau à trois mâts, pendu, réchaud à gaz, fenêtre à quatre carreaux, virgule, OK ! Ils l'écrivent kif kif comme nous, « OK » est devenu un idéogramme.
Le gars a appelé le patron. J'ai refait deux fois de suite le même tabac, avec des variantes : essence « signe de l'index vers le bouchon de réservoir, avec un regard dramatique » couic ! (les deux bras qui se croisent comme les lames d'un sécateur). Donne essence (je décroche le verseur et rapplique contre le bouchon de réservoir) ça. (je fais sauter les deux boutons pression de la bombe et la tends vers le chef) pour toi !
Le chef se marre. Il va à la pompe, me fait le plein. Après il dit un truc en jap en montrant la route. Je comprends, les signes je comprends presque toujours. « Osaka ! » Il me dit un truc en jap que je ne comprends pas. Je prends l'air le plus ahuri possible, il reprend donc « Osaka, OK ? ».
Je réponds Haï », parce que j'ai tout de même appris ça. « Haï » c'est oui. Du coup, il dévisse le bouchon de ma nourrice de secours et y injecte deux bons litrons en prime.
Je le remercie en anglais, mais en m'inclinant. Même trip, on s'est pas compris, quand il m'a dit « Osaka, OK ? », j'ai compris « avec ça, tu y arrives ? », ayant répondu « oui » je ne sais pas pourquoi il me file un rab de benzine.
Petit Prince réenfourche la Puce, je réenfourche, je crois bien que Petit Prince s'est rendormi avant que j'aie redémarré la Puce. Au revoir, je m'incline sans rien dire, en souriant, à la dernière inclinaison, j'avais déjà embrayé, je me souviens du mot « arrigato », (merci) on se sourit encore, et en route vers de nouvelles aventures.
Etrange chose, dans un pays hyper-moderne je viens de me livrer à l'antique activité du troc. Je me marre. Le Japon m'intimide déjà moins...
On est donc arrivé à Osaka. On commence par traverser (ou longer ?) Kyoto, puis on se tape cinquante bornes de faubourg, j'ai repris l'habitude de me faufiler dans les encombrements, parce qu'ici, les automobilistes gardent leur file, laissent le passage à gauche pour les deux roues, bref n'ont pas les réactions de femmes saoules de tous les pays que nous avons traversés récemment.
On a l'impression qu'un Japonais réfléchit avant de faire une manœuvre sauf... Quelques motards qui naviguent dans les perpétuels encombrements dans le style ça passe ou ça casse.
Faudra voir, statistiquer ça de plus près par la suite. On a le temps. On a donc fini par entrer dans les faubourgs d'Osaka.
Des faubourgs... Peut-être à cause de la fatigue, ils m'ont paru bien pires que ceux de Tokyo, Yokohama, et a fortiori Shizuoka.
Des flèches dans tous les sens, des travaux, des demi-tours, des ronds-points, des trucs, des machins, heureusement, Petit Prince et moi on se rappelait, au moins à tour de rôle, comment s'écrit « Osaka » en japonais.
Si je me souviens bien, c'est un bonhomme avec bras et jambes écartés, puis un béta avec un gamma et un aain médial arabe, puis un tire-bouchon avec une seule griffe à droite. Je peux me gourrer, vu toutes les notes, plans, trucs et machins qu'on a accumulés en route, mais je crois bien que c'est ça. On est donc arrivé quelque part dans Osaka ou sa proche banlieue. Y'en avait de nouveau marre. Dès qu'on a pu, on s'est arrêté sur un trottoir illuminé, en face d'un bistrot-club de nuit.
Je ne sais pas comment ça s'est goupillé, mais à peine avais-je fait grimper Puce sur le trottoir qu'on s'est retrouvé entouré, Bon, y'avait du monde devant le bistrot, six ou sept motos, un petit éventaire épicerie-quatre saisons, mais, quoi, pas la foule.
Je n'ai rien compris : qu'est-ce qui les avait fait voir au premier coup d'œil qu'on était des êtres étranges venus d'ailleurs ? Pas Puce, ça non : un 80 Yam mini, c'est tellement courant au Japon que... Non. La plaque d'immatriculation ? Sais pas.
Sûr, elle a 6676 EG 92 inscrit en blanc sur noir, alors que les plaques ici sont écrites en vert sur blanc et sans caractères européens. Ma tronche, je dis non. D'accord, maman est née dans le Béarn, mais papa est pur Nord Viet vrai de vrai, et ici, tout le monde me l'a dit, on peut aisément me prendre pour un Japonais.
Petit Prince, alors, avec ses cheveux blonds qui dépassent tous azimuths du casque offert par Yamaha-Japon ? Je ne sais pas.
Toujours est-il qu'on s'est très vite retrouvé entouré comme quelqu'un qui proposerait à la criée des lingots d'or à dix sacs la douzaine. Dans le tas il y en a qui parlent anglais « Vous venez d'où, vous allez où ? Vous avez mangé ? » Madame épicerie-quatre saisons nous tend tout un tas de trucs qui se mangent.
Sûr on avait petit déjeuné comme des chancres en prévision de restrictions à venir, mais c'était déjà tard le soir, alors on a commencé à bouffer avant même de descendre de moto. Je commence à gormufler bouche pleine à madame quatre saisons qu'on est de France, elle ouvre des yeux comme des soucoupes, marque un temps, et nous dit « llasha imasen », on m'a expliqué que ça veut dire « bienvenue », en fait, ce n'est pas la traduction exacte, de toutes façons il n'y a pas de traduction précise du japonais en aucune langue, mis à part de temps en temps le chinois-mandarin, et encore ça dépend du sens du vent. Bref...
Où allez-vous ? » Je montre la lettre que mon pote jap m'a écrite à Kathmandu, en japonais dans le texte. Les mecs gaffent le nom et le numéro de téléphone, et me tirent par le bras vers une cabine téléphonique.
Ils appellent, et, tenant la fameuse bafouille-sauf-conduit, discutent longuement, ponctuant la conversation de « Haï », et de « EEE ».
Au bout d'un quart d'heure de conversation, ils raccrochent. Etant à côté du téléphone, j'avais entendu tomber des tonnes de pièces de dix yens que tous les gars enquillaient dans la machine.
J'étais comme un con avec les 27 yen que j'ai sortis de ma poche : « Je peux partager les dépenses ? » Ils ont rigolé. Pourquoi faire ? Ton ami sera là dans une heure... Ils sont repartis acheter un tas de chocolateries, je n'en ai guère mangé parce que je n'aime pas des masses le sucre, mais sûr que Petit Prince a dû prendre un kilo en une heure.
Alors un mec est arrivé, a cherché de l'œil l'étranger, a bien sûr attardé son regard sur Petit Prince qui n'a pas vraiment le physique japonais, puis a demandé alentour où était le gadjin qui...
C'est ainsi que, trente secondes après, je serrais la louche de Masanori Suzuki. Il nous a escortés jusque chez lui, Puce et moi suivant sa bagnole. Petit Prince est monté dans la caisse, on dira ce qu'on voudra, c'est souvent plus pratique pour un enfant qui veut dormir. On est donc parti à la queue leu leu, jusqu'à la maison de ses parents.
Notre première maison familiale japonaise, puisque jusqu'ici on n'avait couché qu'à l'hôtel, mis à part une nuit, mais là j'ai promis de ne rien dire, pourtant, il ne s'est pas passé quoi que ce soit de tellement répréhensible.
Demain matin, Petit Prince, Puce et moi, on va démarrer une vie de famille à Osaka, Japon. Y'a Masanori le copain en question, sa mère, son père, sa grand mère un peu gâteuse d'après ce que j'ai cru comprendre, et trois sœurs. La grand-mère vient de nous installer les matelas par terre, d'allumer un colimaçon anti-moustiques, et de partir sans rien dire. On va se coucher, demain il fera jour. Demain, on va essayer de vivre japonais...
On est au Japon... On vit au Japon. C'est-y pas Dieu possible. Le matin quand je me réveille, ça me saute à la figure. Ce qui me réveille, en général, c'est le « ding ! » clair comme le tintement d'un verre de cristal, d'une clochette, celle du temple de M. Suzuki père, qui se trouve dans la pièce ou l'on dort, Petit Prince et moi.
J'appelle ça un temple, en fait, c'est un meuble en bois sculpté à peu près de la taille d'un secrétaire, plein de portes, quand on ouvre les deux grandes du milieu, il y a tout un tas de trucs bizarroïdes dedans, et tous les matins, j'entends M. Suzuki qui prie d'un ton monocorde, en faisant tinter sa clochette de temps en temps.
Je ne bouge pas, chacun a ses dieux, moi c'est Priape et Bacchus, mais je suis tolérant comme tout. Sans bouger, j'ouvre les yeux, la première chose que je vois, les cheveux blonds de Petit Prince qui sortent en cascade de sous les draps, ce n'est pas la sonnette de M. Suzuki qui risque de le réveiller, Stéphane qui dort, c'est une citadelle, c'est la ligne Maginot.
Quand il s'endort impromptu, on peut le transporter au lit sans qu'il se réveille. Son Altesse Royale dort, le monde n'existe plus. Qu'il survienne une secousse sismique, une guerre de religions, une explosion atomique, repassez demain, les circuits sont coupés. Parole...
La plupart des enfants de son âge sont comme ça, mais il pousse le don jusqu'à des extrémités insondables. Huit ans... Je l'envie parfois : être absolument invulnérable onze heures sur vingt quatre, on doit se réveiller neuf chaque matin, nous, les vioques, quand on se réveille, on doit d'abord faire les comptes des jours précédents, puis en accomplir la suite.
Presque plus de jours neufs, bon, peut-être que de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre par rapport à la moyenne, mais merde, je suis chef d'une famille de deux personnes, une part et demie selon le barème des impôts, ventrebleu, Petit Prince, une demi-part, les cons...
Bref on n'a pas un rond, et l'on ne peut guère rester éternellement en parasites à Osaka. Pour ce qui est de trouver du boulot, pas mèche. Les règlements. Je suis arrivé au Japon avec un visa pour voyage d'études, mais statut 4-1-4. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de travailler.
Aidé par mon pote Masanori, j'ai essayé toute la semaine de trouver un travail au noir. J'ai failli trouver une place de maçon, ici les boulots pénibles sont payés cher, manque de pot ça a foiré.
Va falloir faire quelque chose. Moi, je me réveille avec ça dans la tête. Petit Prince, lui, va se réveiller neuf. On est au Japon, c'est évident. Il fait déjà plein jour dans la chambre, il faut dire que par rapport à celles de chez nous, les maisons japonaises ressemblent à des magasins modernes : tout en baies vitrées coulissantes.
Quand il fait jour, et c'est diablement tôt, en cette saison, on ne risque pas de ne pas s'en apercevoir. D'autre part, on est couché par terre, ou presque. Tous les soirs, la grand-mère sort de je ne sais où d'espèces de traversins qu'elle déroule sur le plancher... Enfin ce n'est pas un plancher ou peut être y en a-t-il un au-dessous, mais le sol est recouvert de petits tapis de la taille d'un homme couché, faits de je ne sais quelle matière entre la paille et le rotin, peut-être de la paille de riz, c'est marrant, blague à part ces petits tapis servent de mesure pour la surface des pièces ou maisons, que l'on compte en « tant de tatamis ». Remarquez, c'est plus humain que le mètre carré, comme mesure ; un tatami est un homme couché, un mètre carré, qu'est ce que c'est ?
Cette semaine de vie de famille au Japon a été plutôt difficile. C'était fichtredieusement inévitable, le Japon est une île, et une île très isolée, si j'ose pléonasmer ainsi. Un pays qui a un contact terrestre avec d'autres se mélange à ses voisins, adopte une partie de leurs coutumes. Pour un insulaire, tout étranger est un extraterrestre. Tiens, il y a un détail qui me revient tout de suite, c'était le premier repas que l'on a pris en famille.
On commence très souvent ici son repas par une soupe servie dans un petit bol à la chinoise. J'avais remarqué que beaucoup de gens mangeaient leur soupe très bruyamment, ça me faisait penser à la chanson de Jacques Brel « et ça fait des grands schlurp »...
Quand a commencé le repas, donc, tout le monde s'est mis à manger bruyamment sa soupe, sauf Petit Prince et moi, vu que sur la planète d'où l'on est tombé, on bouffe la soupe en apnée. J'ai eu la sensation que tout le monde regardait plus ou moins de notre côté, puis Masanori m'a dit « tu manges silencieusement »...
Je lui ai alors expliqué que, chez nous, il était impoli de schlurper, il a traduit mes explications à la cantonade, un grand rire a fait le tour de la table, et l'atmosphère s'est détendue. Ici il est impoli de ne pas faire de bruit en mangeant la Soba...

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Excusez ce silence de quelques semaines les gars, mais tous les problèmes qu'on avait ici, plus de nettes divergences de vue avec Moto Canard, avaient créé une tempête émotive sous mon scalp, il fallait attendre que tout ça se calme avant de reprendre mon stylo Mitsubishi, en vente dans toutes les bonnes librairies, 80 Yen.
On a dû quitter Osaka, où il n'y avait apparemment pas mèche pour trouver du boulot au noir. Heureusement, la première chose que j'avais faite en arrivant à Osaka était d'envoyer un mot a mes parents pour leur emprunter des sous.
Papa-Maman ont répondu présent par retour du courrier, et c'est avec un pécule de deux mille Balles de chez nous que Puce, Petit Prince et moi, avons levé les voiles d'Osaka.
Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on habite Tokyo, et si je devais résumer en une phrase ce que j'en ressens aujourd'hui, ce serait : « Ils se sont bien foutus de notre gueule » Qui ? Les mass média, les canards a sensations, les radios, les télés...
Ma foi, P'tit Prince et moi, on vit et respire à Tokyo depuis un bout de temps, on n'est pas mort ni se sent mourir. On avait parlé de distributeurs d'air pur sur les trottoirs pour ranimer les asphyxiés, j'ai dû mal chercher, je ne les ai pas trouvés.
On avait montré des photos de gens portant des masques en coton comme les chirurgiens, pour se protéger de la pollution, ça c'est vrai, on les trouve en vente dans tous les supermarchés, mais ce n'est pas pour se protéger soi-même de la pollution, c'est pour protéger les autres de la sienne.
Ben oui, on met ça quand on est malade, pour ne pas distribuer ses virus ou autres bacilles aux gens que l'on côtoie. Une arme contre les épidémies de grippe, si vous voulez...
Je trouve Tokyo vivable. Peut être parce l'on fait gaffe : à Shinjuku, à Shibuya, deux quartiers mahousses à grands buildings, hyper fréquentés, de grands panneaux lumineux indiquent en permanence le niveau de bruit et de pollution, et le dimanche, on ferme pas mal de rues à la circulation automobile pour que les piétons puissent se promener en paix.
Du coup, les grands magasins font jouer des orchestres pop sur le trottoir pour attirer la clientèle, on passe, on écoute, on regarde...
Des frimeurs du dimanche roulent leur caisse sur leur 1200 Harley. Quoi ? Douze cents ? Mais les plus de 750cc sont interdites au Japon ! Non, Monsieur. Il n'est interdit ni de vendre ni de posséder une plus de 750.
Le gouvernement a conseillé aux fabricants japonais de ne pas vendre les plus de 750 sur le marché intérieur à tort ou à raison, mais parce que la densité de véhicules, ici, est assez effrayante. Je parle surtout d'autos et de camions, parce que, au fond, c'est ça qui prend de la place, pas les cyclos ou les motos.
Partons du principe, en gros juste, que la « surface utilisable » du Japon représente la moitié de celle de la France. Les véhicules effectivement en circulation au Japon le 31 décembre 78, était pour les plus de trois roues de 34120 734, ce qui donne 1,7 fois le parc français, sur un pays pratiquement deux fois plus petit !
Ce parc, blague à part, augmente régulièrement de deux millions par an... C'est vous dire que pour circuler au Japon, il faut être prudent et patient, bien que le Japon fasse de gros efforts pour aménager son réseau routier, bien plus que la France, par exemple. Ici les statistiques ne manquent pas.
D'après la Fédération routière internationale, le Japon dépense 0,96 % de son produit national brut à l'aménagement routier, et la France 0,55 %. On peut mettre en parallèle à cela, pour rire, que selon l'institut international d'études stratégiques de Londres, la France dépense 3,6 % de ce même P.N.B. en armement, et le Japon... Zéro virgule neuf pour cent. Banzaï !
N'empêche que l'on trouve tous les très gros cubes chez pas mal de concessionnaires. Pourquoi ? Parce que c'est conseillé, pas interdit, de boycotter les grosses motos. La classe des classes, ici, c'est la 1200 Harley. On en voit beaucoup, beaucoup plus qu'en France en tous cas, ce qui est américain est à la mode. Les BMW tiennent la cote, mais nettement derrière. Quant aux nationalistes, ils peuvent rouler 1300 Kawa, 1100 Yam, 1000 Honda, mais il faut passer à la caisse : les Japonaises de plus de 750cc que l'on trouve ici sont réimportées des Etats Unis.
Il faut donc les payer un prix fabuleux, pour tout vous dire... Aussi cher qu'en France ! Ça les met au même prix que des Harley ou des BMW. Au fait, y a-t-il beaucoup de motos, ici ? Ma foi, encore pas mal, à la date déjà citée du 31/12/78, il y avait au Japon 10 045 622 deux roues à moteur en cours d'utilisation, soit 1,6 fois le parc français. Là dedans on compte 6 704 762 cyclos (U fois la France), 2 582 803 jusqu'à 125 (6.5 fois la France) et 758 057 motos (4 fois la France). Dans toutes ces catégories, sauf les 125, les ventes s'accroissent. Entre 77 et 78 les 50 ce ont accru leur ventes de 27,6 %. Les vélomoteurs ont baissé de 6,4 %, les motos jusqu à 250 ce ont accru de 39 %, les plus de 250 de 61 %. Maintenant que j'ai une adresse presque fixe et que je peux donc lire Moto Journal, je vois tout le monde angoissé par le nouveau permis. Sûr que cette tarte de Gérondeau s'est fourré le doigt dans l'oeil en appliquant les réglementations d'ici, où, je suis payé pour le savoir, il faut vraiment pousser des coudes pour circuler. Pour aller au taffe, la plupart du temps je prends le métro, ici c'est ce qui va le plus vite. Seulement, et c'est ça l'important, ça ne tuera pas la moto. Faites comme les Japs, mollissez pas. Faut dire que les Japs, de ce côté...
Bon, ras le bol des statistiques, mon horloge-chrono à rattrapante-réveil au buzzer ou en musique, (deux mélodies au choix) orgue diatonique-calculatrice à mémoire, (cent balles en solde à Shinjuku) commence à en avoir ras le bol de chanter les chiffres astronomiques, ah oui, elle émet une note par chiffre, le do grave étant le zéro.
Il y a un truc qui m'a vraiment fasciné ici, ce sont les cyclos utilitaires. Quand je dis utilitaires, c'est vraiment utilitaires : ceux qui livrent la bouffe chaude. Beaucoup de restaus ont un service livraison.
Vous êtes chez vous, vous avez faim et ne voulez pas sortir : vous téléphonez au restau et commandez à bouffer. On vient vous livrer la mangeaille... à cyclo, sinon ça serait au moins froid et peut être bien rance quand ça arriverait. Ces sacrés cyclos ont à l'arrière une caisse suspendue par un système de ressorts et d'amortisseurs pas possible, qui leur permet d'attaquer comme des morts, de prendre des angles pas possibles dans les virages sans casser d'assiettes ni même renverser les bols de soupe chaude. Une seule fois j'en ai vu un faire de la casse, mais c'était en rechargeant des plats vides...
Fascinant. A propos de soupe, c'est l'heure d'ailer croûter. Vous savez qu'est l'angoisse de ne pas savoir lire. Dans mon restau préféré (le moins cher) les plats ne sont pas, comme dans beaucoup d'autres présentés en fac-similé dans une vitrine. Le menu est écrit partout sur des banderoles, en jap évidemment, c'est joli mais ne m'avance pas à grand'chose. Alors... Hé ben je prends la même chose que mon voisin, que voulez vous faire d'autre ? J'espère que ça s'arrangera avec le temps...
Flûte de flûte... Encore deux semaines passées, et je ne sais toujours pas par quel bout prendre ce sacré pays. Je me demande si je ferais mieux d'en partir vite pour aller n'importe où, ou alors... Ou alors quoi ? Rester ici en perpétuel marginal ou encore essayer de m'adapter, de me fondre dans le pays, m'adapter...
Waoutch ! Tu parles d'un programme, pépère, je crois bien, maintenant, que s'adapter au Japon au point d'y passer totalement inaperçu, doit être à peu près aussi facile que de s'installer définitivement sur Vénus.
En un sens, je crois bien que j'ai déjà atteint l'un des objectifs de mon voyage : sauf erreur, j'ai atteint le bout du monde, le pays le plus dépaysant que j'aie vu sur la planète terre. Le bout du monde, c'est ici... Comment t'expliquer ça ? Tout, tout est différent, et pourtant ici comme ailleurs les gens ont deux jambes, les motos deux roues, les bagnoles quatre même si elles roulent à gauche. Le Japon est le vingt-deuxième pays dans lequel je viens traîner mes guêtres, et ça fera bientôt quatre mois que j'y suis.
Jamais je ne suis resté aussi longtemps dans un pays de façon continue, à part la France, tout de même. Eh bien, je suis presque aussi perdu, dépaysé et perpétuellement étonné que le premier jour, plus même, parce que je suis passé du stade d'étranger en visite à celui de résident au Japon.
Hé oui, à partir de deux mois de séjour il faut avoir une carte de résident étranger. Je suis résident au Japon. J'y bosse même si c'est pas très légal, vous me verriez à l'heure qu'il est, avec mon costard trois pièces, mes cheveux bien peignés et tout, j'ai l'air plus japonais qu'un japonais, tant que je ne bouge pas, ne parle pas, personne ne me jette le moindre regard.
C'est mon panard, ça, mon jeu favori dans tous les pays où je passe : en arriver au point où l'on me prend pour un autochtone. Mon costard, je l'ai acheté dans une sitchiya de Setagaya-Ku. Une sitchiya, c'est une sorte de mont-de-piété où les gens qui ont une fin de mois difficile viennent mettre au clou n'importe quoi, télé, chaine hi-fi, bijoux, fringues, godasses, tout.
Au bout de deux mois, si vous n'êtes pas venu reprendre votre truc, il est mis en vente, mais pas aux enchères, on le met en vitrine avec un prix (que l'on peut discuter) et vogue la galère. Grâce à ça, j'ai pu m'acheter une montre chrono digitale Seiko (cent dix balles) un réveil du même tonneau (cent balles) et mon fameux costard trois pièces, comme je Suis devenu un client assidu de ma sitchiya, j'ai eu un prix, je l'ai emmené pour 90 Belles !
Côté habillement, donc je suis impecc, strictement pas repérable. Pour le reste, je continue à aller de gaffe en bourde et de bourde en gaffe, tout m'étonne encore. On va essayer de prendre des exemples.
Au Japon, il y a très peu de voleurs, et très peu de resquilleurs. Du coup on se comporte à peu près partout comme si vol ou resquille n'existaient pas. Pendant des semaines, avant de prendre le métro -je ne fais presque pas de moto a Tokyo, il y a vraiment trop de circulation et je m'y perds tout le temps- je passais mon temps à demander « Otemachi, iko la des ka ? » (Otemachi -ou n'importe où je veux aller- c'est combien ?) pour prendre le bon billet vu que je ne sais toujours pas lire.
Maintenant, conseillé par ma copine Keiko, j'utilise une méthode beaucoup plus rapide : je prends le ticket le moins cher, et je paie la différence à l'arrivée. Si vous faites ça dans un train de banlieue en France, on vous colle cinquante balles d'amende. Ici pas, parce que l'on part du principe que vous avez fait ça parce que vous ne connaissiez pas le vrai prix, ou que vous avez eu en route l'envie de changer de destination, mais pas pour tricher. Vous êtes présumé innocent.
Si vous n'avez pas de billet du tout, on vous demande d'où vous venez, où vous allez, et l'on vous fait payer le prix, pas un yen de plus. Une fois, j'avais pris un billet trop cher. A l'arrivée, le contrôleur m'a remboursé la différence !
A deux stations de métro de chez nous, il y a Kiddyland. C'est un immense magasin de jouets, j'y emmène souvent Petit Prince. On y trouve tout ce qui peut amuser, depuis le petit gadget à trois sous jusqu'au machin hyperfectionné bourré d'électronique qui coûte une fortune.
Eh bien on peut tout tripoter, essayer tout ce que l'on veut, c'est admis, c'est là pour ça, c'est normal. Les rayons de jouets de tous les grands magasins sont des sortes de jardins d'enfants, on s'amuse, et l'on achète si l'on veut. Lorsque je dois aller quelque part et que Petit Prince n'a pas envie de venir avec moi, au travail par exemple, je l'emmène au magasin, je l'y laisse, et le reprends en revenant.
Ahurissant... Si les magasins chez nous en faisaient autant, peut-être bien qu'ils auraient plus de casse ou de vols que de ventes, Mais ici, c'est pas pareil.
Dans le même ordre d'idées, ici l'on voit partout des motos garées sans antivol, avec le casque accroché au guidon. Ben oui, pourquoi pas ?
C’est étrange : Ici je me sens différent. A Paris, les jours de dèche, combien de fois ai-je utilisé dans le bus un ticket déjà poinçonné dans le métro, combien de fois ai-je, même sans vraie nécessité, sauté la barrière du métro ?
Ici, je n'ai pas envie de tricher. Ça serait trop facile, ça ne serait vraiment pas sport... C'est relaxant, ce climat de confiance. Quand je vais à l'ofuro, le bain public, je ne me sers pas des petits casiers style consigne automatique qui servent à ranger les pompes, les grolles, quoi, pas les pompes à vélo.
Je laisse mes bottes parmi la multitude de croquenots qui jalonnent l'entrée, parce que personne ne risque de les prendre par erreur, étant donné qu'ici les gens qui portent des bottines tout cuir sont assez riches pour avoir une salle de bains chez eux, c'est que ça vaut une fortune, ici, le cuir. Donc pas de risque d'erreur, et comme apparemment le vol n'existe pas...
Tiens, les bains publics. Il y en a partout ici, et c'est nouveau pour un étranger venu de l'Ouest. On peut y venir sans son matériel, tout peut s'acheter sur place, mais c'est pas la classe, ça fait étranger.
Donc emmener son savon, une écharpe en tissu éponge qui sert de gant de toilette et sa serviette. Après l'entrée où on laisse ses grolles, on arrive dans une vaste salle pleine de petits casiers, c'est là qu'on se dessape. Quoi ? Pas d'isoloir ? Ben voyons Monsieur, je vous ai bien dit que c'était un bain public !
On se déloque donc complètement, oh ! j'ai bien dit complètement, toi le petit brun qui rougis comme une pivoine... On prend sur les présentoirs le matosse dont on a besoin, shampoing, rasoir jetable ou autres, et on va payer à la caisse.
Ensuite, on entre dans la salle de bains proprement dite. C'est une pièce grande comme un hall de gare, de petite gare tout de même, où une centaine de personnes se lavent en même temps. Pas de cabines séparées, bain public, quoi... Des rangées de robinets et de petites douches à la hauteur de genou, on prend un petit banc, une cuvette, et on se lave parmi la foule.
Une fois propre, on va se baigner. Eh oui, faut se laver avant d'aller au bain, car la baignoire est une sorte de petite piscine commune. Le bain ne sert qu'à se détendre, pas à se laver.
Ça détend d'ailleurs très bien, parce que c'est chaud, mais chaud ! Les deux ou trois premières fois, j'y ai tout juste trempé un orteil et l'ai retiré en rugissant, puis, à force de voir tous des voisins de 5 à 95 ans se tremper là-dedans, j'ai fini par y aller. Pschhhh... On ne reste pas longtemps là-de dans, heureusement parce qu'il n'y aurait pas assez de place pour mettre tout le monde en même temps, mais on en ressort tout frais, tout neuf. Tant mieux d'ailleurs, car j'en ai souvent besoin parce que...
Tiens, par exemple, je vais vous expliquer comment on fait pour ne pas dire non. Ici, on ne dit jamais non...
Ben non... Non et non, on ne dit jamais non au Japon. Pourtant il y a un mot, que je n'arrive pas à retrouver sur le moment, pour la bonne raison que je l'ai lu une fois sur un manuel pour touristes au Japon, mais qu'en quatre mois ici je l'ai entendu prononcer qu'une seule fois, par une nana, mais parce que je le lui avais demandé.
Sinon, même en posant des questions dont la réponse ne pouvait être qu'un non catégorique, je n'ai jamais réussi à le faire prononcer spontanément par un Japonais. Non, ici c'est le mot tabou, pas touche, ça brûle. Je vais vous donner un exemple récent, vécu et précis.
Pour faire des photos, j'avais besoin d'un flash électronique de forte puissance. Vu ma situation financière pénible, je me voyais mal en train d'investir du pognon dans un gros machin qu'il m'aurait fallu revendre ou abandonner au moment de partir d'ici, à cause du manque de place dans les sacoches de la Puce.
J'ai donc passé un coup de fil à l'ami Kajikawa, rédac'chef de Motorcyclist. Non ! malgré son nom anglo-saxon, c'est un canard 100 % japonais. Bref, Kajikawa m'avait plusieurs fois donné des conseils depuis mon débarquement a Tokyo.
Je lui ai demandé si, à sa connaissance, il existait une société louant des flashes a Tokyo. Il a réfléchi un moment, m'a dit qu'il pensait que oui, qu'il allait demander au service photo de son journal et qu'il me rappellerait tout de suite.
J'ai raccroché et attendu tout en bouquinant, au bout de deux heures j'ai commencé à me gratter la tête, d'autant plus que l'heure d'aller au boulot approchait. Ma copine Keiko m'a dit de laisser tomber : « s'il ne rappelle pas, ça veut dire que ça n 'est pas possible, et ça l'ennuie de te le dire ».
Bête comme un Européen, j'ai rappelé quand même. Effectivement, ça n'était pas possible, parce que pour louer ce genre de matériel il fallait faire partie de je ne sais plus quelle association. Ça m'a proprement scié : ça n'était pourtant pas la faute de Kajikawa s'il ne m'est pas possible de louer un flash électronique, malgré ça, il préférait ne pas me rappeler plutôt que de dire « c'est pas possible ».
Voilà l'une des façons de ne pas dire « non » : pas de réponse à une lettre, à un message quelconque, ça veut dire « non ». En fait, quand on est habitué à cette pratique, ça fait des économies de papier ou de téléphone, mais... faut s'y faire, quoi...
De même, si chez nous, vous allez au café « chez Suzanne » en face de la gare, et demandez s'il y a de la bière Kirin ou Sapporo, on vous répondra « non », mais si dans un bistrot d'ici vous demandez s'il y a de la birou Gueuze « Mort Subite », vous aurez de grandes chances que le barman, tout en sachant bien qu'il n'en a pas, fasse mine de regarder dans ses bouteilles avant de faire une réponse ou une mimique évasive. Eh oui, c'est ainsi, on n'aime pas dire non. Toute une culture...
Tiens, puisqu'on est dans les bistrots, parlons en.
Il paraît que la France est un pays de pochards, détenteur du record toutes catégories de la consommation d'alcool.
Le Japon ne se défend pas mal non plus, je serais curieux de savoir combien de kilomètres cubes de « Suntory Old » qui a l'air d'être le best-seller des whiskies au Japon (c'est un whisky japonais, bien sûr) il se consomme par an.
Surtout le vendredi soir, il y a du monde jusqu'à très tard dans les bistrots, et je vous garantis qu'on n'y suce pas de la glace, et qu'on se défoule sec, sans violence, mais on se défoule.
Le gadget-défouloir le plus rigolo à mon sens, que l'on trouve dans pas mal de cafés, c'est la machine a vous transformer en idole de la chanson. C'est incorporé à la chaîne hi-fi du bistrot. Un lecteur de cartouches stéréo-8 sur laquelle il n'y a que la partie instrumentale enregistrée. On vous passe un bouquin sur lequel il y a les paroles des chansons disponibles, vous prenez un micro, vous commandez votre chanson, et en avant la zizique, on vous passe la partie instrumentale, et à vous de bramer dans le micro, tout le bistrot vous écoute pousser la goualante, et vous applaudit souvent à la fin, même si c'était manifestement minable.
Le micro passe de table en table, et chacun y va de sa petite chanson. Folklo, non ? Ça se passe très gentiment, on ne se bat pas pour avoir le micro même quand le Suntory Old a coulé à flots, on supporte avec le sourire ceux qui chantent manifestement comme des pieds.
Ici l'on est très, très sociable. Je ne me sers que très rarement du machin en question, because je ne connais pas par coeur les chansons à la mode ici, et que le bouquin qui donne les paroles ne m'aide pas beaucoup. Quand ce sont des chansons en japonais, rideau, faudrait savoir lire, et si elles sont dans une langue que je parle, rideau tout de même : les paroles sont écrites dans la langue d'origine, mais pas en caractères de chez nous : pour faciliter la tâche des vedettes d'un soir, elles sont imprimées en katagana, un alphabet (enfin pas exactement un alphabet, chaque caractère est une syllabe) japonais dont on se sert entre autres pour écrire les mots étrangers.
Entre autres, pas uniquement. Il me prend une envie de vous expliquer ce que j'ai cru comprendre sur la logique de la langue japonaise en fonction de l'écriture, de la grammaire, de la construction des phrases parce que c'est fou comme une langue peut refléter l'âme d'un peuple.
Seulement j'ai un peu la trouille que 18 552 lecteurs ne se mettent à hurler à l'emmerdeur ou au cunilinguiste de mouches. En plus, si je commence a m'embringuer là-dedans, il va falloir entrer dans les détails, vous expliquer comment deux kenji accouplés pour faire un mot précis peuvent donner une prononciation qui n'a rien à voir avec celle des mêmes kenji séparés, comment il y a des gens qui simplifient leurs noms, ou plutôt les transcrivent phonétiquement en katagana parce que ce nom comporte un ou plusieurs kenji rares que l’homme vulgaire risque d'être incapable de lire.
Ben oui... Les kenji sont les idéogrammes d'origine chinoise. Il en existe des milliers, et si en lisant vous rencontrez un idéogramme inconnu, vous êtes incapable d'une part de savoir ce qu'il signifie, d'autre part, et c'est là le gag, également incapable de savoir comment il se prononce.
Boohh... Laissons béton, résumons-nous en disant que la langue japonaise est aussi différente des langues européennes que le Japon est différent de l'Europe. C'est hallucinant. Je vous l'ai déjà dit et me répète sans honte, de tous les pays que j'ai fréquentés, le Japon est de très loin le pays qui me semble le plus... au bout du monde.
Au bout du Monde nom de djeu. Je crois que j'y suis. Si Allah-el-rahman-el-rahim le veut, bientôt le voyage va se poursuivre, ma prochaine destinée sera le Canada anglophone, Vancouver, à six mille bornes d'ici par la mer.
J'ai l'impression qu'en arrivant au Canada, même si géographiquement je serai plus loin des Hauts-de-Seine qu'aujourd'hui, j'aurai déjà commencé à me rapprocher de vous. C'est dingue, ça fait des semaines que j'essaie de vous faire sentir ce pays où je vis, et je merdoie, et je patine, et je ne sais jamais par quel bout commencer, de quoi parler ou ne pas parler, simplement parce que tout est différent par tous les bouts et que je ne sais comment expliquer ça. Tout est différent. Eh merde ! Retournons un moment dans les bistrots...
J'appelle les bistrots japonais bistrots, mais en fait, comparés a ceux de chez nous, ils ressemblent souvent à des clubs : plus petits, plus intimes. De plus, on peut, comme dans les clubs, y avoir sa bouteille personnelle.
Chez nous, il y a les flippers, ici, c'est le « Space Invader », un jeu comme de juste entièrement électronique qui consiste en une guerre des étoiles sur écran de télévision, avec canons, Ovnis et sang à la une dans un raffut de véhicules spatiaux descendus à la roquette.
Gros avantage du « Space invader » sur le flipper : on peut couper le son et défendre sa planète en silence. Dans pas mal de bistrots, ces machines infernales servent de table. Ainsi pendant que vous sirotez votre Suntory Old, l'écran du « Space Invaders » vous invite en permanence à sortir vos pièces de 100 Yen pour défendre la terre contre les agresseurs du ciel.

Pour en terminer avec les bistrots, une chose de plus m'a beaucoup étonné ici : l'indulgence dont on fait preuve vis-à-vis des gens disons... pris de boisson. Si, chez nous, un individu en état de cuite avancée commence à faire du raffut dans un café, à apostropher les gens ou même seulement à s'endormir le nez sur la table, il est à peu près sûr qu'il sera plus ou moins aimablement invité à vider les lieux sans délai. Ici, non.
On excuse l'ivresse et ses conséquences. Bien sûr, je n'ai encore jamais vu quelqu'un provoquer une bagarre ou faire de casse, mais tout de même, ici, la marge de tolérance est bien plus grande que dans notre douce France, qui est pourtant une terre d'élection des vins et spiritueux. Laissez-moi vous conter une histoire vécue.
Peu de temps après notre arrivée à Tokyo, avec Petit Prince et mon amie Keiko dont je venais de faire la connaissance, nous étions allés casser la croûte dans un petit café-restau du coté de Kenji. On était tranquilles et peinards, pas accoudés au comptoir mais assis à une table, quand un vieux bonhomme, saoul comme un Japonais le vendredi soir, est venu regarder Petit Prince, qui, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus, passe ici à peu près aussi inaperçu qu'un cool baba dans un défilé militaire.
Après l'avoir examiné d'un oeil torve, il s'est mis à l'invectiver en japonais dans le texte. Il criait assez fort pour que tout le bistrot l'entende, mais personne, ni clients ni personnel, n'avait l'air d'y porter attention.
J'ai demandé à Keiko ce que racontait le bonhomme, elle m'a répondu négligemment « rien, il est ivre ». Comme pépé continuait son film, j'ai insisté. « Ce n'est rien, il est ivre, c'est un pauvre vieux, il a perdu la guerre, ça l'a rendu un peu fou ».
-Mais enfin, traduis- moi ce qu 'il dit !
-Non, je ne peux pas | traduire, c'est trop dégoûtant... Il croit que Stéphane est une fille... »
Ça m'a sacrement étonné : imaginez le résultat, si, même fin bourré, dans un café-restau en France, vous vous mettiez à faire des avances sexuelles à une fille ou un garçon de huit ans ?
J'en ai parlé avec beaucoup de gens, on m'a à peu près toujours dit la même chose. On n'est pas sévère avec les gens ivres, parce que tout le monde a été ivre au moins une fois dans sa vie, alors, il n'y a pas de quoi fouetter un chat...
Belle leçon d'humanité, cette tolérance vis-à-vis de l'ivresse publique. Par contre, il est très mal vu d'être ivre dans un banquet de mariage. Y'a pas, quand on est né au pays du Beaujolais Villages, le Japon est bel et bien le bout du Monde.
Le Japon américanisé... De prime abord, ça en a tout l'air. Les innombrables enseignes en anglais ou pseudo-anglais, le style de beaucoup de voitures japonaises, la mode des Harley ou des motos japonaises style américain, les jeunes qui vont acheter très cher des vieilles fringues américaines à Harajuku, la musique pop, les défilés des militants d'extrême droite, camionettes peintes en kaki avec des slogans d'ailleurs anti-américains aussi bien qu'anti-russes, uniformes paramilitaires et air martial.
Le Japon est-il une colonie des Etats-Unis ? Oh tonton, tu rêves ? La ville américaine la plus proche est à plus de 6000 km de mer, et qui pourrait « coloniser » un pays aussi monolithique que le Japon ?
Le Japon est un bloc redoutablement cohérent. Je dis redoutablement, parce que quand on est né au pays de Breiz Atao, du séparatisme corse, basque, où le citoyen moyen considère le gouvernement central comme un emmerdeur public auquel on résiste à coups de défense passive, on se sent admiratif mais un peu effrayé face à un pays aussi cohérent.
Admirable de voir les gigantesques et richissimes compagnies industrielles suivre les directives du ministère du commerce international et de l'industrie, qui pourtant n'a même pas le pouvoir légal de coller une amende à cinq balles.
Imaginez le gouvernement français demandant à deux compagnies privées concurrentes de faire alliance et partager leurs secrets de bureaux d'études pour mieux s'attaquer aux marchés étrangers, quelle rigolade ! C'est ce qui se passe régulièrement ici.
Admirable aussi de voir les particuliers mettre soigneusement à part leurs ordures ménagères combustibles et non combustibles qui sont ramassées séparément. Admirable de voir les pompistes fermer systématiquement, sans obligation légale, le dimanche dans le cadre des économies d'énergie, et les jours de grosse chaleur les employés de bureau abandonner le saint gilet et la sacro-sainte cravate, parce que, pour la même raison, les entreprises restreignent la climatisation.
Admirable de voir l'esprit d'équipe qui règne dans les entreprises, même en dehors du travail.
Admirable, mais parfois un peu effrayant pour le misérable gadjin que je suis ici.
Cette unité, c'est la force principale du Japon. Il va de soi que, sur un bloc aussi compact, l'influence américaine est extrêmement superficielle, et a souvent l'air d'une sorte de fantaisie folklorique. Rigolo de voir un mariage se dérouler à la mode plus ou moins occidentale, avant que les mariés courent changer de tenue pour se « remarier » aussitôt dans la tradition shintoïste.
Marrant de voir fêter le « thanks giving day » américain, qui est ici transformé en une sorte de fête du travail. Marrant de voir un jeune « in » en Levi's croiser une dame en tenue traditionnelle, avec le parachute dans le dos et tout le toutim.
Sûr, c'est « in » pour les gens riches de rouler en bagnole américaine avec la direction à gauche (je vous rappelle qu'ici, on roule à gauche) et d'avoir chez soi une pièce meublée « western style », avec chaises, canapés, tables et tout ces trucs qui prennent une place folle.
Seulement, la vente de voitures américaines représente 0,4 % du marché, moitié moins que les allemandes soit dit en passant, mais tout de même huit fois plus que les françaises, qui se tirent la bourre avec les suédoises pour le titre de lanterne rouge.
Sacré Japon. Un pays neuf et très ancien à la fois. Il y a des cartes de crédit à profusion, mais les neuf dixièmes des transactions se font en liquide. Les machines automatiques vous fournissent nuit et jour soupe chaude, clopes, bière, saké, journaux sexy ou pas, (pas de machines à alcool après 11 heures toutefois) mais même dans un supermarché, il serait extrêmement choquant de ne pas marquer l'entrée de chaque client par un sonore « ilasha imasen » (bienvenue) et sa sortie par un « Domo ari-gato gozaïmashita » (remerciements).
Ceci à tel point que dans les grands magasins, il y a des employées chargées de dire bonjour et au revoir. Pour pallier ce genre de contraste, on a récemment créé ici des machines automatiques parlantes, pour que l'automatisation devienne compatible avec l'élémentaire politesse.
Ce n'est pas demain que les japonais cesseront d'écrire en idéogrammes, ils sont en train de mettre au point des ordinateurs capables de lire les redoutables petits signes. Un travail de titan, mais qui leur permettra d'une part de rester japonais, d'autre part de s'assurer l'exclusivité du marché chinois en matière d'informatique.
Ce n'est pas non plus demain que le plumard extra-mou à l'occidentale remplacera le petit traversin que l'on installe le soir sur le tatami pour le ranger dans un placard au matin. Le Japon reste japonais et monolithique. Il est et demeure une île lointaine, où tout étranger de l'ouest se sentira quelque peu des allures d'extra-terrestre.
Tiens, pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est ici un étranger, je vais vous raconter mon expérience militaire au Japon. Jusqu'ici je n'avais pas trouvé l'occasion de vous raconter ça, mais l'histoire de gagner trois sous, je me suis engagé dans l'armée russe, même que j'ai été grièvement blessé en Mandchourie, sur la 52ème colline.
Comment, vous ne savez pas où se trouve la Mandchourie ? C'est simple : de chez moi, vous prenez le métro jusqu'à Yoyogi Uehara, là vous changez, vous prenez l'Odakiu-sen jusqu'au terminus. Là, vous êtes en Mandchourie.
Bon assez blagué, c'était un film qu'on tournait sur la fameuse (enfin, fameuse pour les Japonais) bataille de la 52ième colline, bataille qui a été gagnée par les Japonais, tiens, vous aviez deviné ?
C'est marrant, mais dans quelque pays qu'on soit, on fait plus souvent des films sur les batailles ou les guerres qu'on a gagnées que celles qu'on a perdues. Bref, on embauchait des figurants étrangers pour garnir les rangs de l'armée russe.
Ah là là ! Vous auriez vu notre armée ! Ça ne m'étonne pas qu'on ait perdu la bataille. Notre général en chef s'appelle Luc, il est français. Le général en sous-chef est anglais, quant a la troupe, malheur, je me suis amusé à faire un petit recensement, il y avait des Français, des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais, un Bolivien, quatre Israéliens, deux Espagnols, un Viet, bref tout sauf des Russes.
Par curiosité, j'ai demandé au responsable (australien) de l'agence de figurants qui nous avait embauchés s'il ne trouvait pas notre armée un peu disparate, il s'est marré et m'a répondu « aucune importance ! Tout ce qu'il faut, c'est n'avoir pas l'air japonais »
Ben oui... Si le Japonais moyen peut distinguer un Coréen d'un Chinois, montrez-lui un Brésilien en lui disant qu'il est danois et il prendra ça pour argent comptant. Alors, des têtes manifestement anglo-saxonnes ou sud-américaines dans l'armée russe, pourquoi pas ? Au fond, c'est vrai, il y a des tas de races en URSS.
En France, il y a vingt ans, tout ce qui était jaune était présumé chinois, et devient maintenant japonais. Au Japon, tout ce qui n'est pas jaune ou ne parle pas japonais est présumé américain, tout simplement parce que les Américains sont les étrangers les moins rarissimes au Japon.
J'ai récemment bavardé avec une nana qui venait de s'offrir un séjour à Paris. Je lui ai demandé ce qui l'avait frappé le plus, savez vous ce que c'est ? La diversité des races. C'est vrai qu'ici, on voit si peu de têtes non-japonaises que quand il s'en présente une, elle déteint comme une pivoine dans un champ de blé.
L'autre jour, dans la rue, j'ai vu... Devinez ? Un noir Américain. Tiens, déjà je dis américain, en fait je ne sais même pas s'il était américain, je ne l'ai pas entendu parler. Tout le monde le regardait en passant, je l'ai regardé comme les autres, parce que depuis le temps que je traîne en Asie, j'avais complètement oublié qu'il pût exister des gens tout noirs et avec des tronches comme ça.
Ici, je retourne au racisme primaire : un étonnement mêlé de crainte face à quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir. Rien d'étonnant donc à ce que les étrangers, ici, soient et demeurent des marginaux. Il faut avoir résidé dix ans au Japon pour espérer acquérir le statut de résident permanent.
La naturalisation ? Une procédure tout à fait exceptionnelle. On naît japonais, on ne le devient pas, sauf si l'on est quelqu'un qui fait honneur au Japon, comme récemment le chef d'orchestre coréen Seiji Osawa.
Etre japonais, c'est toute une tradition, une éducation, une culture.
Je viens de battre ici mon record de séjour continu dans un pays étranger. Le précédent record était l'Angleterre avec trois mois et demi. Qu'est-ce qui me retient dans ce pays bizarroïde qu'est le Japon ?
Justement le fait qu'il soit bizarroïde. Je suis en train de découvrir que je me comporte avec les pays comme Casanova avec les femmes. Chaque pays nouveau m'étonne, me fascine. Je cherche à m'y intégrer, à pouvoir y passer inaperçu. Lorsque c'est fait, je m'en vais, pour éventuellement revenir, mais la bataille est finie.
Le Japon m'accroche, car maintenant je suis sûr que la bataille est perdue pour moi : malgré ma tête qui peut aisément passer pour japonaise, je ne pourrai jamais passer inaperçu ici.
Je pourrais rester très longtemps ici sans cesser d'être étonné. Le Japon est un mur, parce qu'il est racialement et culturellement cohérent.
Hier, je bavardais avec une nana qui prépare une licence d'anglais, elle rêve de connaître les Etats-Unis et le Canada, l'Australie aussi car, normal pour une Japonaise, elle est fascinée par les grands espaces.
Je lui ai demandé si elle envisageait de s'installer définitivement dans un de ces pays, elle a eu l'air étonnée :
« oh non, de toutes façons, je retournerai au Japon...
-Pourquoi ?
-Eh bien... Parce que... Tout le monde ici pense comme moi !...»
Chez nous, les ethnies, les langues et les cultures se mélangent, parce que les pays se touchent les uns les autres. Celui qui est à Paris et à deux ou trois cents Balles à investir dans un billet de train peut en l'espace d'une nuit se retrouver dans dix ou quinze pays différents. Quand je dis ça à un japonais, j'ai l'impression d'être un Martien qui parle de sa planète.
Caché derrière l'URSS et la Chine, le Japon est un petit continent à lui tout seul, n'ayant pour voisins que deux grosses démocraties populaires de choc ennemies et pas spécialement faciles à fréquenter, plus la Corée qui est au Japon ce que l'Algérie est à la France. Au fond, le Japon est un vieux célibataire...
Ben dites... Ça fait une paie qu'on n'a pas parlé de motos, faut dire que dans la vie que je vis ici, une vie honnête de sous-prolétaire métro boulot dodo, neuf heures de travail de nuit, un jour de congé par semaine, la moto est sortie de mon univers, en une journée, où voulez-vous que j'aille avec mon bicycle a gaz ?
Ah, sûr, il y a la montagne, le Fuji-Yama à grosso modo deux cents bornes d'ici, avec le parc national, immense, mais par la route, c'est trop loin. Sur les nationales, je fais avec le vent favorable vingt cinq ou trente de moyenne, alors...
Et puis, à l'idée d'avoir à traverser Tokyo et Yokohama, j'ai des sueurs froides. J'ai aussi eu envie de prendre le train express « Shinkansen » pour aller à Kyoto, mais ça revient trop cher.
Depuis que Petit Prince et moi sommes installés à Tokyo, nous n'avons jamais quitté la ville. Faut dire qu'on y trouve tout, m'enfin... Parlons motos.
Commençons par le commencement : comment les motards sont-ils vus au Japon, le pays qui fabrique les motos. Eh bien, eh bien... è-to-nai... Largement aussi mal que chez nous, pire même, pour la bonne raison que certains d'entre eux sont aussi redoutables que chez nous et même pires, bien pires.
D'abord qu'est-ce qu'un motard japonais ? Ben... Nan-da... Un peu comme chez nous, ça peut être n'importe quoi, nai ? Il y a des routards pépères et koolosses, sacoches, top case, tente de camping par dessus le tout, qui, pendant les congés surtout, se baladent tranquilles et peinards de camping en camping, chevauchant leur d'un bout du monde, bécane équipée tourisme, qu'elle soit mini-moto comme ma puce qui est un engin très répandu ici, ou gros cube.
Comme chez nous. Il y a les doux frimeurs, en chopper japonais pour les pauvres, ou en Harley pour les riches, dont la tenue peut aller de l'ensemble Levi's-bottines relax Max au cuir clouté-croix de Malte aigle sur le dos. Comme chez nous. Il y a les de-course à bracelets échappement quatre en un libéré, combinaison de cuir, casque intégral et j'attaque comme à Suzuka... Comme chez nous.
Il y a plus, aussi. Ceux que les journaux anglophones appellent souvent les « hooligans ». Ils ne sont pas bien nombreux, mais comme ils sont toujours en bande et font beaucoup de bruit, généralement la nuit, on les remarque, on en parle beaucoup. Echappement libre, tenue agressive assez souvent à coloration néo-facho, du moins vu avec un œil d'Européen, esprit de bande et instinct kamikaze.
Fait divers relaté par le Japan Times : une bande de hooligans sévissait une nuit dans le quartier commercial de Shinjuku. La police tente de les arrêter, un policier se met au milieu de la chaussée pour en stopper un, qui met les gaz à fond et s'enquille le flicard en plein. L'agent de la force publique en avale son extrait de naissance. Le hooligan se gamelle dans la bagarre, il est capturé par la police, et là, je cite : « Il a admis n'avoir fait aucun effort pour éviter l'agent Machin ». En clair, il lui est rentré dedans volontairement.
Ça, on n'a pas tous les jours chez nous... Pourquoi eux et pas nous ? Peut-être parce que la société japonaise est très, trop bien organisée. Trop bien quand on la regarde avec des yeux d'Occidental.
Chez nous comme partout, il existe une « voie droite » pour devenir une personne respectée, qui fait un boulot à priori intéressant et bien payé. Ecole, lycée, prep, grande école, etc. Bon. Bien sûr, il arrive que cette voie droite ne mène à rien. Des diplômés au chomedu, ou faisant un boulot dans lequel ils n'exploitent pas du tout ce qu'ils ont appris, on en a. Par contre, il est possible de parvenir à un boulot intéressant et/ou payant sans avoir suivi la voie droite. Tous nos PDG n'ont pas fait H.E.C. ou Sup' de Co, tous nos graphistes ne sortent pas des Arts Déco, ni nos journalistes de l'école de Strasbourg, etc. Brèfle, on peut arriver à quelque chose, comme on dit, sans suivre la voie droite.
Ici, au Japon, celui qui sort de l'université ou d'une grande école avec son diplôme est quasiment sûr de trouver un boulot à sa dimension, dans une entreprise d'autant plus prestigieuse qu'il aura été bien classé pendant ses études. Impeccable. Parallèlement, il est a peu près impossible de parvenir a un poste intéressant et important par un autre chemin que la voie droite. Ça veut dire que celui qui rate son... appelons ça son bac pour simplifier, se sait condamné à vie à rester au bas de l'échelle. C'est un raté.
Le bac, chez nous, c'est un examen emmerdant, ici c'est la barrière à franchir a tout prix pour gagner une place honorable dans la société. Les étudiants pas hyper-doués bossent comme des fous à grands coups de cours particuliers pour passer le cap. Pour le recalé, c'est assez souvent la grosse grosse déprime, déprime que l'on s'exprime comme on peut. Plus une société est ordonnée et hiérarchisée, plus la révolte, quand révolte il y a, est violente. Les hooligans sont un cas particulièrement affirmé de la chose. Au sein du milieu moto, ils sont une frange tout-à-fait marginale.
Tout de même... J'ai été impressionné par le nombre de motards japonais qui se montent des échappements vrounch vrounch : il en existe pour à peu près tout ce qui roule, et de toute évidence, ça se vend très très bien. Bizarre...
Dans les pays méditerranéens où l'on s'exprime toujours fort, un échappement à 100 décibels fait partie de l'ambiance, mais ici où l'on entend rarement quelqu'un élever la voix, même au restau quand le garçon se fait attendre, ça a un côté choquant, déplacé.
Au fond, le pot bruyant, ça doit être la revanche des timides, le cri de ceux que l'on n'écoute pas parler. En tous cas, la moto n'a pas une bonne image de marque au Japon. Comme ailleurs, comme chez nous, c'est un défoulement, une sorte de révolte larvée.
On n'encourage pas la pratique de la moto : « vignette » à partir de 250 ce, permis difficile au-dessus de 400 ce, assurances chères... Enfin, pas délirantes comme chez nous, faut pas pousser. 11 faut compter autour de 3000 F pour deux ans avec une 500. Les assurances moto sont donc chères, pas par rapport à la France, mais par rapport aux assurances de petites bécanes, par exemple. Pour mon super-vélomoteur de luxe Yamaha GT 80, ma Puce adorée, je paie 5300 Yen par an, soit 90 Francs. A Paris, pour la même machine, je payais 700 Francs, soit 7,7 fois plus cher pour une garantie équivalente : tiers sans vol ni personne transportée.
Par contre, si je voulais assurer une grosse machine ici ça me coûterait à peu près la moitié du prix français. Décalage énorme, ici, entre grosses et petites cylindrées.
Tiens ! J'entends une Harley... Ah oui, c'est un mec qui habite pas loin de chez nous dans Motoyoyogi-cho, près d'un restau coréen où l'on va bouffer les jours de fête, il fait un genre de sukiyaki mode coréenne, pour 1300 Yen avec plein de viande, au moins cent grammes, le Pérou quoi...
Il a l'air un peu nœud sur sa 1000 Sportster, le gnace, il est taillé comme un casse-croûte de guerre et se prend pour James Dean ; avec ce qu'il a casqué sa draisienne, il aurait pu se payer trois 750 Honda, ou une seule et un voyage aux Etats-Unis, évidemment aux States avec sa 750 Honda personne le prendrait pour James Dean. Oh, je sais, chuis sectaire. Au fond je suis un vieux motard réactionnaire...
Ouf... Depuis la dernière carte postale, j'ai changé de job. Sans regret, je vous l'assure, bien que j'aie le plus grand respect pour la profession de garçon de restau, surtout depuis que j'en ai fait la fatigante expérience. Remarquez, j'avais déjà essayé le truc pendant les vacances quand j'étais étudiant, mais m'étais fait virer à la fin du premier jour pour cause de lenteur manifeste.
Vous imaginez donc facilement que lorsque j'ai fait mon premier jour, ou plutôt la première nuit à la Trattoria « alla Rampa », j'étais mort de trouille. Arriverais-je à faire au Japon un boulot que j'avais été incapable de faire en France ? Ça a marché, parce que là, je n'avais pas le choix.
Plus un rond et Petit Prince a nourrir, il fallait que ça marche. J'ai maintenant abandonné ma prometteuse carrière de garçon de restaurant pour amorcer une destinée de professeur d'anglais-français-italien dans l'une des innombrables écoles privées qui permettent aux Japonais de rattraper plus ou moins leur manque de pratique des langues étrangères.
Je vous ai assez parlé du Japon pour que vous sachiez maintenant que c'est un pays très isolé culturellement. Tous les Japonais apprennent l'anglais au lycée, mais il est enseigné dans la plupart des cas par des professeurs qui n'ont jamais mis les pieds dans un pays anglophone.
Que voulez-vous, le Japon est si loin de tout, il faudrait qu'un étudiant soit fils de riche pour se payer des séjours linguistiques en Grande Bretagne ou même aux Etats-Unis, si bien qu'ici, sur le plan de la conversation, un professeur de lycée est à peu près au niveau d'un bon élève de troisième en France.
Sur le plan de la conversation, je dis bien, parce qu'ils vous traduisent Dickens aperto libro. Seulement, maintenant, imaginez qu'un cadre supérieur de la Kokusaï Denshin Denwa soit envoyé à Boston pour négocier un contrat de télécommunication avec ITT. On ne lui demandera non pas de traduire une page de Dickens ou douze vers de l'oraison funèbre de César de Shakespeare, mais de savoir dire « si vous faites une O.P.A. sur la Graham Bell's Fana-tics C° dont nous sommes actionnaires à 34 %, d'accord vous devenez majoritaires, mais nous, ayant le contrôle sur la Matsushita Electrics C°, nous pourrons vous couper l'approvisionnement en bobines Gorgougnoff dont nous avons l'exclusivité ».
Ça, ce n'est pas dans Shakespeare qu'on le trouve, pas plus que des expressions fort utiles telles que « où sont les toilettes » ou « où puis-je acheter des cigarettes Mi-né » j'en passe.
L'une de mes élèves est fille d'un professeur d'anglais à l'université, et elle m'a avoué en rougissant que son père parle très mal anglais. Lire, oui, mais parler, non.
D'où une impressionnante floraison d'écoles style Berlitz, où l'on enseigne les langues étrangères ou simplement fait pratiquer la conversation en telle ou telle langue.
L'argument n° 1 de ce genre d'école est de fournir des « native speakers », c'est-à-dire des gens qui enseignent leur langue maternelle. Hébin ici, à la Robert's Academy of Languages je suis à la fois anglais, français et italien. La directrice n'est pas bégueule.
Auparavant, j'avais essayé de bosser chez Berlitz à Osaka, mais Berlitz au Japon c'est pas le pied : d'une part ils ne paient vraiment pas cher, d'autre part ils ne prennent pas de travailleurs au noir.
Voilà. Je suis prof. Peut-être plus pour longtemps, mon visa, déjà renouvelé une fois, approche sa date d'expiration, et j'ai bien peur que le bureau d'immigration m'envoie péter si je demande un second renouvellement.
Dommage, parce que ce métier me botte, et me permet de mieux découvrir les Japonais. C'est quand même chouette d'être payé trente balles de l'heure, même si c'est une misère quand on vit au Japon, précisément pour parler avec les gens que vous cherchez a découvrir, non ?
Le seul truc est que c'est parfois fatigant, du fait de ma trinanionalité. Il n'y a pas une seconde de repos entre les leçons, si bien qu'il m'arrive souvent d'être un Anglais natif de Hillington (Middx) pendant une heure, puis de changer de salle au pas de course en cherchant le bouquin dans mon sac pour devenir en trente secondes un Romain de la Piazza Vittorio à Rome, près de S.M. Majeure, et une heure plus tard de grimper les escaliers pour blinder à la salle 2 F toujours en fourrageant dans mon sac pour trouver le Cours de Langue et de Civilisation Française et pousser la porte en disant dans la langue de Tartuffe : « Bonsoir, comment allez-vous, monsieur Asahi ».
Baste, je n'ai pas à me plaindre, ici, il y a une Suissesse qui fait la même chose, avec l'allemand en plus... Y'a des jours où j'ai l'impression d'être un acteur de théâtre...
C’est mon nouveau job depuis trois semaines.
Maintenant que je l'ai abandonné et exorcisé, je vais vous parler un peu de l'ancien.
C'est vrai que je ne vous ai jamais parlé de mon boulot jusqu'ici, c'était déjà assez fatigant de le faire. Je ne vous ai jamais parlé non plus de notre domicile actuel, à Petit Prince et moi. Au fond tout ça va ensemble...
On habite dans un kibboutz Quoi ? Y'a des kibboutzim au Japon ? Il y en a au moins un à Tokyo. C'est le propriétaire lui-même qui appelle notre résidence le kibboutz, parce que les deux tiers des résidents sont des routards Israéliens, qui sont à peu près dans la même situation que moi : ils ont besoin de renflouer la caisse du bord.
La « résidence » où nous habitons est un groupe de logements d'urgence construits après la seconde guerre mondiale parce que Tokyo avait été intensément bombardé. Ça n'est pas véritablement le luxe, ça ressemble plus à un camping deux étoiles qu'à une résidence, les cuisines et les douches sont communes, y'a un téléphone à pièces -mais que l'on peut appeler- par immeuble, les chambres font de deux à trois tatamis, mais c'est très bon marché à louer, à la portée de gars qui gagnent trente balles de l'heure.
J'ai connu cette somptueuse résidence par l'intermédiaire d'un Australien qui était locataire ici et nous a quelque temps prêté sa chambre parce qu'il était hébergé par une Japonaise.
La vie est tout de même drôle : un arabophone qui vient de passer des mois en Syrie et Jordanie, à rencontrer beaucoup de palestiniens en exil, donc forcément pas très sioniste, qui se retrouve à crécher dans un kibboutz à Tokyo.
Eh ben on s'est adopté, cartes sur table, peut être que la présence de Petit Prince a aidé, la présence d'un enfant attestant de mon innocence. Ils ont ouvert de grands yeux quand je leur ai raconté comme à vous à quel point les Syriens et les Jordaniens sont des gens gentils, tolérants, hospitaliers, eux que forcément, la propagande de leur pays décrit comme des brutes, je crois qu'ils ont senti que je ne bidonnais pas, même Shlomo le plus parano n'a pas été imaginer que j'avais été envoyé à Motoyoyogi-cho, Tokyo, par el Fatah, spécialement pour saper le moral d'une dizaine de routards-réservistes Israéliens.
C'est par Salomon qui semblait leur leader, (que Tanaka-san notre vieux proprio appelle le roi Salomon comme il appelle sa résidence le kibboutz) que j'ai eu mon travail de garçon de restau.
Salomon avait ce boulot et trouvé autre chose, il me présenta donc au gérant de nuit du restau italien Alla Rampa. Ma dio serpe ! Le gérant de nuit est Sicilien ! On a tout de suite sympathisé entre latins, mais pas à cause de la langue italienne : Savatore ne parle pas italien.
Je vous jure, il ne parle que le dialecte sicilien. Il préfère parler anglais qu'italien, de temps en temps, il téléphone du restau chez lui en Sicile, je comprends un mot sur cinq. Ça m'a scié. Notez, peut être qu'il y a des Corses qui ne parlent pas français, j'sais pas...
De toutes façons, entre latins, pas de problème : quand en plus de mon travail de nuit alla Rampa j'avais mon devoir de jour de soldat du Tsar de toutes les Russies, pour le film dont je vous ai parlé, une fois j'étais si fatigué que je me suis endormi dans le métro en rentrant du front. Faut dire que s'endormir dans le métro, ici, est un sport national : les gens bossent très dur.
Je me suis réveillé à un terminus à deux heures du restau. C'est immense le métro de Tokyo. J'ai téléphoné à Salvo qui m'a dit non fa niente... Va te coucher, je vais trouver un gars pour te remplacer...
Salvatore, c'est exceptionnel. Faut que je vous raconte Satcho et Tencho, des vrais Japs purs de durs, eux.
Satcho (patron) était Japonais, il l'est toujours, mais pour moi, maintenant, c'est du passé. Un « selfmade man » comme il y en a beaucoup au Japon, étant donné qu'il a fallu repartir de zéro après la seconde guerre mondiale.
Il a commencé par gérer des cantines pour soldats américains à la fin de la guerre, maintenant il possède une dizaine de restaus plus ou moins de luxe à Tokyo.
Drôle de mec, vu sous mon angle, Satcho. Je ne connais pas son nom, ici, dès qu'il y a hiérarchie, on appelle les gens non par leur nom, mais par leur grade. « Satcho », c'est « patron ». Tout le monde appelle le patron « Satcho », comme depuis que je suis prof, tous mes élèves, quelque soit leur rang social ou leur âge, m'appellent senseï », professeur. Même des élèves du sexe dans les circonstances les plus inavouables, je vous le jure.
Bref Satcho. Un bosseur insensé. Riche comme il doit être, ça paraît totalement invraisemblable.
Souvent, à l'heure de fermeture du restau, donc vers quatre heures du matin, le voilà qui radine, en survêtement, et nous aide a faire le nettoyage du bouiboui. Quand il est là, je devrais dire que s'est nous qui l'aidons.
Où qu'il se mette,service, nettoyage du parquet en bois, des chiottes, vaisselle, il fait ça à une cadence qui me laisse sur le cul, moi ou les autres étrangers du sous-prolétariat.
Il peut radiner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on croirait qu'il ne dort jamais. S'il a l'impression que la moindre chose traîne un tant soit peu, il se jette dessus, sans faire de reproche à qui que ce soit, et l'expédie à une cadence qui ferait pisser Henry Ford dans sa culotte.
Je pense qu'il prêche par l'exemple, le Satcho : si t'es payé pour tel boulot, le fais en un quart d'heure et que le Satcho le fait en cinq minutes, même s'il ne te le dit pas, ça veut dire que tu ne bosses pas assez bien.
Satcho m'a donné des leçons de lavage de vaisselle, de disposition de plateaux au point de se retrouver avec un truc très lourd à porter mais équilibré de telle façon que si on le décharge dans l'ordre des choses à servir, il restera équilibré en permanence.
Le problème d'un plateau n'est pas son poids, mais son équilibre. Sacré Satcho : je te garderai beaucoup d'estime.
Idem pour mémoriser la commande d'un client, pour faire la caisse -le seuil de rentabilité de notre restau est de quatre cent mille Yen, 8.000 FF de chiffre d'affaires par nuit.
Pour rien au monde je ne voudrais faire ce qu'il fait. Cela dit je l'admettais comme chef, parce que j'ai vu de mes yeux vu qu'il ne répugnait pas a faire les plus débectants de nos boulots, et mieux que nous.
En France, souvent, un patron estime qu'il ferait n'importe quel boulot a la place de ses employés, et mieux que lui. Satcho, lui, le prouve. Sacré Satcho.
La semaine dernière, je suis venu avec Petit Prince bouffer dans mon ex-restau. On nous a invités, pas le patron qui n'étais pas là, mais l'ensemble du personnel.
Du coup, je suis resté jusqu'à la fermeture, et j'ai travaillé comme au temps où je bossais là, au nettoyage du restau avec mes anciens collègues jusqu'à cinq heures du matin.
Alors qu'on était en train de cirer le plancher. Satcho est arrivé. Il m'a vu, le démissionnaire qui maniait comme un Jap la machine à cirer, on s'est regardé, on a ri tous les deux, le rire au Japon je vous l'ai déjà dit, est souvent une manifestation de gêne ou d'étonnement.
Satcho et moi, on se sera côtoyé longuement sans se comprendre. Un bosseur pareil, pour moi, est une sorte de dinosaure, même au Japon. Tous les jeunes Japonais ne bosseront pas comme leurs parents l'ont fait. Demandez à Satcho ce qu'il pense de la nouvelle génération : des branleurs...
Tencho, ce fut autre chose. Le « Tencho », c'est le capitaine, c'était en alternance avec Salvo le Sicilien mon chef direct, un gars tellement caricaturalement japonais qu'on croirait qu'il fait exprès. Un bourreau de travail lui aussi, mais apparemment ni par intérêt ni par goût. Par devoir, par tradition.
Il s'agitait en permanence comme une fourmi et exigeait que tout le monde en fasse autant, même certains soirs où le restau était presque vide, et que le mieux à faire eût été, en logique latine, humaine dirais-je, de se relaxer un peu.
Il restait à peu près toujours à bosser après ses heures de service, même quand c'était manifestement inutile. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il n'allait pas rejoindre sa femme et ses enfants, au lieu de faire du rabiot sans sens, il m'a regardé d'un air mi-fataliste mi-méprisant, avant de dire « c'est la tradition japonaise ».
On a eu pas mal de prises de bec avec Tencho, j'ai été d'ailleurs surpris qu'il ne me fasse pas mettre à la porte. Peut-être que même au Japon ça devient difficile de trouver des gens pour travailler de sept heures et demie du soir à cinq heures du matin, ou alors, il y a autre chose que je n'ai pas compris.
Cela dit, si je suis bien content de n'avoir plus à passer la nuit à trottiner avec un plateau dans une salle de restaurant, je suis assez content d'avoir vécu cette expérience de sous-prolétaire au Japon. Ce fut plutôt fatigant mais très intéressant à vivre.
Bon je vous quitte pour aujourd'hui, dans une demi-heure, j'ai deux heures de leçon avec un doux rêveur fanatique d'opéra qui veut apprendre l'Italien en huit heures pour aller à la Scala de Milan, c'est mission impossible, même pour la part de moi qui est un Romain de la Via Machia-velli.
Les Japonais ne réalisent pas comme il est difficile d'apprendre un langage dont les conjugaisons sont extrêmement compliquées et qui saute souvent les articles.
C'est que le Jap, c'est du petit nègre, y'a quasiment ni cas ni temps ni conjugaisons, t'alignes des mots...
Je ne vous parle plus beaucoup de Petit Prince, ça ne veut surtout pas dire qu'il n'est plus là, mais... différemment. Il fait partie du kibboutz, quand je bosse, Keïko, Salomon et toute la clique lui tiennent compagnie. Le soir, il joue avec les gamins du coin, il parle japonais, je vous jure.
Un matin, j'ai eu une panne d'oreiller, la fatigue, c'est que sans m'en rendre compte je suis devenu bosseur, ici. Arrivé très en retard pour un cours, j'ai proposé en réparation à une élève qui devait la semaine suivante guider des touristes japonais à une expo de peinture en France, deux heures de cours gratuites dans un bistrot près de chez elle.
Evidemment, quand je me suis pointé pour le cours gratuit, c'était avec mon Petit Prince qui avait passé l'aprem' à Kiddyland. Je lui donne quelques pièces de 100 Yen pour qu'il joue à Space Invader sur la table à côté, et nous voilà avec l'élève, bidonnant en mots la visite d'une galerie d'art, avec tous les termes qui vont avec.
A un moment, l'élève n'a pas l'air de suivre : elle regarde ailleurs. « Nan dès ka ? » m'insurge-je en perdant mon latin. « Vous ne suivez pas... »
-C'est le garçon, il jure...
-Bien sûr il jure, il est en train de perdre au Space Invader, on perd tous au Space invader, c'est normal.
-Oui mais... Il jure en japonais ! »
Ah ben oui dis-donc dame, c'est vrai qu'il jure en Jap, il est moins con que moi, il est jeune, il s'adapte...
Tokyo, décembre 1979
Dieu me damne... Il faut que je rende Petit Prince. Sa mère avec son mec sont rentrés en France et l'exigent. C'est vrai que depuis le temps qu'il est devenu mon gamin, je n'envoyais que très rarement des nouvelles.
D'une part je ne savais pas où ils étaient, et envoyer des lettres dans le sud de la France quand tu n'as pas de réponse soit parce qu'elles n'arrivent pas soit parce que la réponse ne parvient pas parce que tu as changé d'adresse, c'est pas motivant.
Je n'étais pas motivé, non plus, Petit Prince est devenu mon môme. Je rentre de mes boulots de nuit, me couche à côté de lui, il se pousse un peu par réflexe, la plupart des nuits on arrive à changer de côté dans le pucier sans se réveiller tant on est habitué l'un à l'autre, et au matin, il me réveille d'un rugissement
« Eric, j'ai faim . ».
Il m'appelle Eric. Il est fantastique, à huit ans il fait pleurer les femmes sans les battre... Attendez que je vous raconte...
Umé-ko, une amie à nous, est une fille japonaise de peut-être vingt-cinq ans, gentille comme tout. Elle est tombée amoureuse de Mike, un australien très très drogué. Pas le pétard de temps en temps, le gars qui ne peut pas passer cinq minutes dans son état normal.
Il faut qu'il soit bourré, stone, speedé, piqué, quoi que ce soit. C'est un brave gars, pourtant, mais bon, il est comme ça.
Bref Mike a Umé ruiné financièrement et réputationnément parlant. Un soir de richesse, on mangeait chez le Coréen du coin avec Petit Prince, voilà Umé-ko qui vient se plaindre dans notre giron. « Mike ceci, Mike cela... ».
Et Petit Prince de lui demander, parce que c'est le genre de question essentielle que l'on poserait sur son astéroïde « as-tu de l'argent pour manger ? »
Ume-ko s'est mise à pleurer.
J'ai été très fier de mon petit.
Eh oui. Et puis c'est mon petit, quoi, merde... Il m'a choisi...
Tokyo, mardi.
Petit Prince est parti. Je l'ai emmené à l'aéroport de Narita avec autour du cou un passe d'enfant non-accompagné, direction Paris. On a pleuré comme des Madeleines, et une hôtesse l'a emmené. J'aurais dû bastonner, refuser, le cacher, je suis un lâche. Eh merde... le seul endroit où j'aurais pu le mettre à l'école eût été le lycée français de Tokyo, même si j'avais pu le payer on aurait été repéré en une semaine.
Ya Allah comme il me manque... Quand je sors de chez l'épicier, je regarde ce que j'ai acheté. Merde ! Je ne mange pas de yaourts, je ne, je ne, je ne... Je remets en place tout ce qui aurait été pour lui.
Tout de lui me manque : son odeur d'enfant, c'est merveilleux cette odeur de douceur. Qu'il me bouscule la nuit dans ses rêves, merde je croyais que je ne le sentais pas, mais ça devait m'être aussi bon que le fœtus qui savate le bide de sa vieille.
Il me manque de partout...
Hier, je suis allé au bureau d'immigration japonais, en insistant lourdement, j'ai obtenu quinze jours de rab au Japon, mais après, il va falloir lever l'ancre.
Le problème est que je ne sais pas où aller ensuite. L'idéal serait le Canada, mais les finances sont trop basses.
Autre solution, aller aux Philippines pour revenir ensuite au Japon avec un nouveau visa, et reprendre mon boulot de prof qui me plaît.
Ou alors, n'importe où, pourvu que le voyage ne soit pas trop cher, et que j'arrive dans un pays où l'on puisse vivre à l'économie. J'ai donné le numéro de téléphone du kibboutz à un agent de voyages spécialisé dans la braderie, le premier billet pas cher sera le bon.
A trois jours près, j'ai raté un Tokyo-Nouméa et retour avec une semaine d'hôtel en pension complète pour mille balles...
Comment, incroyable ? Ici, c'est un pays d'économie très libre, et l'on fait les affaires à l'américaine : si quelque chose ne se vend pas, on brade, les voyages organisés comme le reste.
Une semaine avant le départ, les tour-operators qui n'ont pas le plein bradent les places inoccupées pour une poignée de cerises. N'ont pas tort, les gars, il vaut mieux récupérer mille balles que de partir avec des places vides, non ?
Brèfle, dès qu'on... que je trouve un billet bradé pour quelque part, on se jette dessus. Ça me fait penser à une chose, utopique, bien sûr. Enormément de liaisons aériennes, les avions partent régulièrement à moitié vides.
Ne serait-il pas rigolo qu'un quart d'heure avant le départ des avions, les compagnies bradent les places vides aux enchères ? Vous imaginez d'ici « il nous reste vingt sièges pour Tombouctou, mise à prix, cinquante mille

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
États-Unis
Je cherchai à obtenir un visa longue durée pour le Japon, sans succès. Je décidai donc d'aller aux États-Unis, et alors que tout était presque prêt, miracle ! Une lettre venue d'Athènes m'annonçait que, sa mère s'étant séparée de son gars, Petit Prince pouvait et souhaitait revenir avec moi. C'est ainsi que...
Je poireaute à l'aéroport de Roissy en attente du retour de Petit Prince. Ça a l'air totalement irréel. Qu'Allah me l'ait confié une fois est déjà miraculeux, qu'il me le rende est vraiment d'un autre monde.
Bism-Illah ! Le voilà, ce petit brouillon blond, on s'est reconnu de loin, on s'entrelace, on génère la chaleur, on est la tendresse, on est plus heureux que tout.
El-hamd-elîah aas salamé ! Le temps de lui faire faire une révision générale chez le tabib du coin, on se retrouvait en Amérique, à Los Angeles, pour commencer par observer les motos américaines...
Amérique égale chopper. Chopper égale Amérique, Sitôt que la mode fut lancée par le snobinomercanti du coin, toute la presse moto s'en vint à la semaine de la moto à Daytona. Il fallait avoir vu Daytona pour avoir son brevet de journaliste moto ; je ne suis jamais allé à Daytona parce que je suis un sale réac.
Pour rentabiliser les frais de déplacement, on faisait chaque année un gros papier de fond sur la moto en Amérique et ça donnait chaque année sur six pages couleur les chauppères avec un angle de chasse à faire frémir un taux d'inflation, assez de clignotants pour faire croire que la France tourne à gauche, et des peintures telles que, si Boronali les voyait, il courrait ventre à terre passer son permis moto par correspondance. Bon. L'Amérique, c'est le chopper ?
Ben non. Des choppers, sûr, il y en a plus que le vendredi soir place de la Bastille. Cela dit, ici en Californie, paradis de la moto aux Etats-Unis à cause d'un climat de bord de mer, il y a aussi des motos. De tous les genres, comme chez nous. Comme chez nous, il n'y a pas de motard type.
Ça va du jeune homme un peu trop raffiné dont on dit qu'il en est, jusqu'à l'hyper-viril-CToix-de-Malte-barbe-de-cinqjours qu'en est peut-être aussi vu que les extrêmes se touchent, mais au moins ça ne se voit pas. Y'a des mecs normaux aussi, même s'ils ne sont pas toujours blancs.
Motos idem. Ça va de la 250 quatre temps absolutément de série au truc à coucher dehors. Et je te fous un compresseur, ou un carénage spécial qui donne une allure de Jaguar E, et je te téléphone une radio AM/FM stéréo ou quadriphonique et un émetteur citizen band, ou je te choppérise comme dans les canards français la semaine d'après Daytona.
Evidemment, étant donné que les motos et accessoires sont beaucoup moins chers qu'en France, et que le niveau de vie est plus élevé, on va loin... Tout cela pour dire que, si le chopper existe ici, et existe bien, il ne faut pas en faire une image de l'Amérique, comme le béret basque et la baguette de pain pour la France, même si ça fait bien sur une page couleur...
En France, il y a deux endroits où la moto fleurit plus qu'ailleurs : la région parisienne et la côte d'Azur. Je vous écris de la côte d'Azur américaine. Au fait, y a-t-il beaucoup de motos ? Dans l'absolu, oui. Par rapport aux autos, très peu. Comme ailleurs, comme chez nous. La grande mode, ici, c'est les patins à roulettes et le vélo, avec les mêmes niveaux de frime ou de délire que pour la moto : depuis le slip de bain jusqu'à la tenue de campagne, protège-genoux, protège-coudes, gants, casque, protège-molaires, protège-canines, protège-trou-de-balle, etc..
De trois ans jusqu'à mon âge et même au-delà, ça patine à roulettes, avec, Amérique oblige, les patins super-course, avec la godasse incorporée style patin à glace, ou ça vélote avec des vélos de cross guidon renforcé pneus à tétines moyeu frein que si Graham Noyce en voyait, il regretterait d'avoir fait de la moto. A part cela, des gens plutôt aimables, la conversation, même si elle est souvent superficielle et sans suite, se noue facilement.
Tout à l'heure, tout en scribouillant, j'ai allongé un bras mou vers mon paquet de « Vantage », il était vide. Sans lever les yeux, je l'ai froissé et jeté dans le cendrier. Aussitôt, mon voisin m'a tendu son paquet « vous en voulez une ? » De même, des gens, surtout d'ailleurs de sexe féminin, de toute évidence pas pauvres, vous abordent pour en taper une, comme ça, sans façon.
Hier j'ai fait le plein de « The Saviem », la 750 Guzzi « Ambassador » que me prête ici mon vieux copain Paulo-les-Bretelles. Ah ! Le rire ! avec 4 dollars (16,40 F au cours où j'ai acheté mes Dollars) j'ai eu droit à 3,1 US gallons (11,7 1) de super ; du coup, halluciné, j'ai laissé un pourliche au pompiste qui m'a regardé avec des yeux ronds, et m'a demandé des explications avant de l'empocher. Comme au Japon, sauf qu'au Japon on m'aurait rendu l'argent avec le même regard étonné. Traditions, traditions... Donc, ici, on paie cinq francs trente le gallon, soit 1,40 F le litre de super...
Parlons distances. Quand on débarque de Tokyo -Paris n'aura été qu'un transit- c'est proprement invraisemblable. A Los Angeles, il n'y pas de centre-ville, pas de quartier de ci ou de ça. Los Angeles est une gigantesque banlieue, où il est à peu près impossible de se déplacer sans véhicule. Pour le moindre petit truc, on se retrouve en train de parcourir des distances invraisemblables.
Etant donné que les bus sont plutôt rares et qu'il n'y a rien qui ressemble à un métro, autant à Tokyo il faut être un peu fou-dingue pour se balader en transport individuel, autant ici un androïde sans véhicule à moteur ressemble à un paralytique sans sa chaise roulante : irrémédiablement coincé.
D'ailleurs, ici, savez-vous quelle justification d'identité on vous demande lorsque vous changez un traveller's chèque, louez un vélo ou une planche de surf ? Ben voyons ! Le permis de conduire ! A seize ans en France, la carte d'identité devient obligatoire. Ici, c'est le permis de conduire. Comment pourrait-on ne pas l'avoir ? Tout compris, ça revient à 10 dollars (quarante et un Francs !!!!!) et il est très difficile de le... rater. Holà ! Je parle du permis bagnole, le permis moto, en Californie, c'est à 18 ans, mais également difficile à rater. Je sens que je vais repasser mon permis moto ici pour en avoir un de rechange.
Samedi soir...
Merde ! J'avais garé The Saviem en face d'un parkmètre pété, mais bien à droite pour que d'autres puissent en profiter. Un gars en Volkswagen s'est garé à côté de moi, et crac ! j'ai pris 10 $ d'amende, « deux véhicules sur le même emplacement de parking ». Les chiens ! C'est à vous dégoûter de ne pas être égoïste. En France, il me semble qu'on aurait laissé glisser, ou alors juste praliné la bagnole en double file... C'est dur, l'Amérique... Hier j'en ai déjà pris une pour m'être garé sur un trottoir comme chez nous, apparemment c'est interdit.

Hermosa Beach, dimanche
Coup de bol ce matin : en arrivant à la plage, j'ai vu une Oldsmobile qui se taillait en laissant deux heures et demie sur un parkmètre, il m'en faudra vingt comme ça pour récupérer mes 20 $ d'amende. Patience...
Du coup, si on parlait de Sous ? L'Amérique a acquis la réputation d'être un pays cher, ça doit dater des années 50-60 où le Dollar était fort, et où les pays européens ne pratiquaient pas comme aujourd'hui ce sport enrichissant de l'inflation à deux chiffres. Numéro un, la bouffe. Ention et damnafer ! C'est moins cher que chez nous.
Petit Prince et moi, on s'est mis à la tradition anglo saxonne. On fait un gros repas le matin et le soir. Sans se priver, on s'en sort par repas pour six Dollars à nous deux, 24 balles. Oh ! C'est pas de la cuisine à cinq étoiles qu'on se bouffe, mais c'est très mangeable et la salade n'est pas en supplément.
On a même le choix de l'assaisonnement. Y'a le French dressing, « assaisonnement à la française », un truc un peu douceâtre à base de ketchup, mais si, mais si, c'est French, et le blue cheese dressing a base d'espèce d'ersatz de Roquefort, pas terrible mais mieux.
A ce propos, je vais vous en raconter une bonne. Hier soir, Petit Prince et moi on est allé dans un restau cher -pour nous- en bord de mer, à Redondo Beach. Gueulez pas aux capitalistes, ici un restau cher, c'est 40 balles par tête. On est allé là parce qu'on y servait du « swordfish », de l'espadon. Blague à part, c'est bon.
Bref, quand on a côsé de la salade, la serveuse nous a demandé : « assaisonnement français, fromage bleu ou huile et vinaigre ? ». On s'est plié de rire, elle nous a demandé pourquoi, quand on le lui a dit elle n'a pas voulu nous croire...
Continuons avec la bouffe. On retrouve ici une tradition qui m'avait plu au Japon : on ne pousse pas outrageusement à la consommation. Vous pouvez entrer dans une gargotte pour y commander un hamburger-offre-spéciale à $1,25 salade incluse, sans boisson ni fromage ni dessert, sans que l'on vous fasse la gueule. Comment, il y a des endroits, des pays où l'on vous fait la gueule si... ? Je crois, je crois...
En ce moment, je suis dans un bistrot d'ambiance relativement intime en bord de mer, entre nous et la plage, il n'y a que la piste des patineurs-planches à rouletteurs-cyclistes, toutes les demi-heures, je vois Petit Prince passer à fond à fond sur son vélo « Texas Ranger » de location.
Le demi de bière est à 40 cents (1F60). Une affiche au-dessus du bar annonce que le mercredi soir, on brade les demis à 10 cents (40 centimes) till one keg blows, jusqu'à ce que le premier tonneau soit vide. Pas de problème : bouffe et essence sont nettement moins chers qu'en France.
Reste le logement. Moins cher aussi, excepté les hôtels : apparemment difficile de trouver quoi que ce soit en dessous de 10-12 dollars. Quand sera venu le moment de bouger de chez Paulo, je crois bien qu'on va investir dans une tente... Canadienne !
Attention !... Je vais effectuer pour vous un essai peut-être pas exclusif mais tout de même passionnant, et ceci en direct de la Californie du sud : je vais goûter un Chablis californien. Holà ! On m'a demandé si je le voulais avec des glaçons... Il mousse un peu, ça passe... Parfum presque inexistant. Goût très faible, aucun bouquet, vin doux et très plat ; c'est pas Byzance, 3/20 pour le Chablis Almaden, vive la France ! Cela dit, il paraît qu'en Californie on trouve aussi d'excellents vins. Jusqu'ici je n'ai goûté qu'un Bourgogne redoutable et un Champagne « fermenté dans sa bouteille » qui, glacé, avait la saveur envoûtante d'un mousseux consommé tiède. Bah, il nous reste du temps pour voir et goûter le reste...
Mardi après-midi
Héhé... Nouvelle expérience en face du parkmètre cassé, cette fois-ci, il y avait déjà une 400 Kawasaki. Comme, malgré des injections massives de quarts de Dollar, notre parkmètre s'entêtait à descendre vers zéro, j'ai garé The Saviem à côté de la Kawa. On va voir si en Californie, deux motos sur un parking équivalent à deux véhicules ou non. Si c'est non, on gagne un ou deux Dollars. Si oui, on en perd dix. C'est la roulette américaine.
Mardi soir
On a gagné à la roulette américaine : apparemment, une moto ici, c'est un demi-véhicule. Toujours ça de récupéré sur nos 20 Dollars d'amende... Ça pourrait bien nous amener à parler de l'inflation que l'on ressent ici dramatiquement a travers de petits détails : la pièce la plus courante ici, c'est le quart de Dollar, moins d'un franc. Il en existe aussi d'un demi-Dollar, mais elles sont plutôt rares, la plupart des machines, et en particulier les parkmètres, ne les acceptent pas.
On a cherché il y a quelque temps à lancer une pièce d'un Dollar, ça a été un fiasco. Il faut donc, si l'on fréquente les parkmètres ou autres machines à sous, être en permanence approvisionné en quarts de Dollars. Vous imaginez le tas de mitraille ! Certains parkmètres sont programmables jusqu'à 24 heures, à 1/4 de Dollar la demi-heure, ça fait 48 pièces à entasser dans le machin en tournant donc 48 fois la poignée à fond : n'allez pas après ça dire que les Américains ne pratiquent aucun exercice physique !
L'inflation permet aux automobilistes américains de muscler leurs avant bras, il suffit d'avoir deux voitures ou de changer de bras chaque jour, pour avoir rapidement les avant-bras de Popeye le marin, toot toot !
Toujours l'inflation, on a commencé à convertir des pompes à essence en litres. Vous vous rendez compte, en litres ! N'importe quoi ! Vous savez ce que c'est, vous, un litre ? Well, ça doit faire un petit morceau plus qu'un quart de gallon ou qu'un couple de pintes est-ce que je sais... Pourquoi donc des litres ? C'est que que le gallon d'essence a largement passé le Dollar cette année, que l'on n'avait pas prévu que cela pût arriver avant la venue du Messie, et que du coup les vieilles pompes ne peuvent pas être réglées sur plus de $0,99 le Gallon !
Vous vous rendez compte, plus d'un Dollar le gallon ! C'est facile de se marrer, mais je me souviens d'avoir ressenti le même choc lorsque la chose est arrivée en France, c'est-à-dire quand le litre d'essence a passé le cap du Franc... Diable. Il y a longtemps déjà, très très longtemps... Tout de même, le gallon à un Dollar trente... Bah, quand Puce aura franchi l'océan Pacifique, je laisserai là The Saviem et on fera 80 miles avec un gallon d'ordinaire à 1 Dollar 30... Ça vaut combien, au fait, chez vous, un gallon d'ordinaire ? Quoi ? Mais ça ne fait pas loin de trois Dollars et demi, ça ! Eh ben... Il s'appelle comment, votre président ? Nous c'est Carter, la petite pilule pour la foi ; dites donc, le vôtre, c'est la grosse... Je me marre... Je découvre l'Amérique à 1 Dollar 30 le gallon d'essence. On va pouvoir faire du chemin...
Torrance, jeudi
Meltingpot. pot pourri... C'est ainsi que les Anglais appelaient, et appellent encore probablement l'Amérique, les vaches. Le pire est que c'est absolument vrai. Qu'est-ce qu'un Américain ? Qui peut se prévaloir d'être de « race américaine ? »
Les Indiens, uniquement les Indiens. La ville américaine réputée la plus ancienne, c'est St Augustine, Floride. Elle date du 16ème siècle et a été fondée par les Espagnols. Les Indiens ayant presque disparu, il faudra attendre des siècles et des siècles pour que peut-être une nouvelle race s'ébauche, si elle s'ébauche jamais, à partir de ce gigantesque mélange de toutes les ethnies existant sur terre.
Après le Japon où la moindre tête non-japonaise se repère instantanément, c'est un choc pas croyable de se retrouver ici. On côtoie tellement de têtes différentes que si l'on croisait un Vénusien avec six yeux, des tentacules et une trompe, on passerait probablement sans le remarquer.
J'avais déjà eu des soupçons avant même d'entrer officiellement en Amérique, au moment de passer à l'immigration : une employée en uniforme des services d'immigration était chargée de canaliser la foule des arrivants. Un fonctionnaire, normalement, c'est le citoyen moyen type, non ? Eh bien, la citoyenne-type s'est cogné le pied dans un des poteaux en bois qui canalisaient la foule, que croyez vous qu'elle ait crié ? Shit ? Fucking hell ? Non... Elle a dit « scheise ! ». 0. K, ça veut dire « merde », mais... En allemand !...
Ça, c'était à New York. Ici, à Los Angeles, c'est pareil. D'ailleurs, Los Angeles, ça veut dire « les anges », mais... En espagnol... Dans un rayon d'un demi-mile autour de notre Q.G. chez Paulo les Bretelles, on peut pratiquer la plupart des langues de la terre.
Le marchand de « liquors » d'en face parle français et arabe. Il est originaire de Palestine. Le personnel de « Dino's Hamburgers » à côté, est presque entièrement mexicain. Au coin, le patron du restau « El Cabrillo » est coréen. On peut aussi parler russe, hébreu, polonais, croatien dans le quartier. Hier soir, j'ai emmené Petit Prince dans un restau français de Torrance Boulevard. J'y ai mangé un « beef chausser » (sic !) et le maître d'hôtel japonais m'a accueilli en japonais dans le texte, trompé par ma tronche de viet mâtiné de béarnaise qui me donne l'air de Hiro Hito jeune, avec la couronne en moins et les lunettes en plus.
J'ai répondu en français, ça a jeté un froid, cinq minutes plus tard, le patron irlandais est venu me dire qu'il ne fallait pas m'affoler si je ne trouvais pas la bouffe très française, parce que... enfin quoi... Bref. Le rouquin, au moins, était buvable, même s'il n'était pas français, mais les Irlandais américains qui tiennent des restaus français en Californie n'ont pas le même étalon que nous en matière de « carafe ».
Détestant jeter le vin, je suis donc sorti saoul comme un Polonais. Rentré à la maison, je n'arrivais pas à béquiller The Saviem. Après cinq minutes d'essais infructueux, je me suis aperçu que j'appuyais désespérément du pied en plein à côté de l'ergot de béquille. C'est dur l'Amérique...
Ici, c'est vraiment la tour de Babel. Tiens, le serveur du restau où je suis en train de scribouiller a l'air tellement italien qu'on n'en voudrait pas pour un remake de « La Strada » de peur que la critique aille dire qu'on en fait trop. Cela dit, il est probablement de nationalité américaine, même s'il ne s'en vante pas. C'est assez typique d'ici : on est Américain de naissance ou naturalisé, mais on conserve ses racines, ou l'on y retourne.
C'est encore une chose qui me surprend ici : on bavarde avec un tel ou un tel qui vous dit qu'il est un Allemand, Irlandais, Russe ou Moldo-Valaque. Cela dit, il y a 99 % de chances que le fameux Irlandais ou Mandchou soit de nationalité américaine, peut-être même que ses parents et grands-parents l'étaient déjà, mais les Etats-Unis sont un pays si grand et si neuf (204 ans depuis l'indépendance) que ça a l'air un peu idiot d'être Américain. Alors on se cherche des racines dans un autre pays, et ici, à part les Indiens, tout le monde en a...
Une fois que toutes les ethnies se seront mélangées, qu'est-ce que ça donnera ? Des Martiens sûrement. Ça y est ! J'ai trouvé ! On est chez les Martiens. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en faisant le tour du monde, j'apprenais à parler le martien. Langage éminemment hétérogène : Hi ! How are ya today ? Que tal ? Parla italiano ? W-aarabi kaman ? Ach zo ! So dès nè ! Et toi-là matelas ? C'est folklo le martien. Quand on est un peu perdu dans la salade, il n'y a qu'à parler anglais. L'anglais, c'est l'espéranto de cette Tour de Babel...
Flûte... Je suis arrivé aux Etats-Unis avec un permis international tout neuf, il est déjà passablement élimé. Il faut dire que je passe mes journées à louer des patins à roulettes, des planches de surf, des vélos ou des trikes pour Petit Prince, et que ce que l'on demande comme pièce d'identité ici ce n'est pas le passeport, c'est le permis de conduire. Bon... Il va être temps d'aller roupiller, demain, on doit se lever tôt pour aller dans un bled pas très loin d'ici qui s'appelle Anaheim. Vous ne connaissez pas Anaheim ? C'est pourtant célèbre : c'est là que se trouve un endroit bizarre que l'on appelle... attendez... Ah oui !
Disneyland...
Torrance, samedi
Waoutch ! Quelle panique ! On a passé la journée d'hier à Disneyland. J'ai vraiment pris un grand pied en franchissant le panneau « Entering Anaheim », et un autre gigantesque en garant The Saviem dans le parking moto de Disneyland. Sûr que ça me faisait plaisir de me trouver dans ce truc que j'avais regardé en bavant à la télé chez un copain quand j'avais l'âge de Petit Prince, mais surtout, quand il m'a adopté aux Indes, j'avais dit à mon Petit Prince que, si l'on pouvait aller aux Etats-Unis, on tâcherait de passer à Disneyland. Avec tous les imbroglios qu'on a eus en route, il avait paru de moins en moins probable que cela se fît. Et puis voilà. Dieu est grand, ça s'est fait hier.
Disneyland... Holàlà ! Je ne vais pas essayer de vous décrire ça, c'est colossal, c'est insensé, c'est 100 % américain. On a passé douze heures là-dedans à passer d'attraction en attraction, et on a dû en faire à peu près le quart.
Aujourd'hui, j'en ai encore la tête comme un compteur à gaz. Des montagnes russes qui vous font percuter dans l'obscurité des météorites avec des loopings et des soubresauts à vous faire remonter les claouis à la place des amygdales, des trains fantômes qui vous font passer à travers des avalanches et des cataractes, des balades en bateau à travers des paysages vraiment trop beaux pour être vrais, c'est affolant de vivre tant de choses en si peu de temps, et sans le moindre risque, le niveau de sécurité de tous ces engins est vraiment impressionnant.
Tout est automatiquement et impeccablement ordonné afin que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'il n'y ait pas un bleu, pas une écorchure, que rien ne vienne perturber le fonctionnement de cette immense machine à distraire les gens. C'est peut-être pour ça que, si je suis content d'avoir vu Disneyland et d'y avoir amené Petit Prince, « l'endroit le plus heureux du monde » ne me laissera probablement pas un souvenir très marquant, justement parce que rien ne peut y arriver...
D'ailleurs, l'endroit où Petit Prince est resté le plus longtemps, c'est l'île de Tom Sawyer, où il n'y avait que des rochers à escalader et des grottes à explorer. Là au moins, il a pu se faire un gnon au genou...
C'est pas tout, ça... Dans deux jours, on va quitter la Californie pour un temps. Ces vaches de japs n'en finissent pas de ne pas nous envoyer la Puce, et ici on a trop de tentations coûteuses, le pognon n'en finit pas de disparaître à vitesse égale à V + n. On est tout de même dans l'une des régions les plus chères d'Amérique, On va partir dans l'Ore-gon où l'on a un copain mécano moto, On se retrouve là-bas.
Milwaukie, jeudi.
Holà ! Ne rêvez pas, on n'est pas à Milwaukie (Wisconsin) là où se trouve l'usine Harley-Davidson, mais à Milwaukie, Oregon, tout près du volcan Ste Hélène qui a pété sec au mois de mai dernier, cramant quelques touristes et recouvrant les villes avoisinantes de cendres, au point que tous les concessionnaires moto et auto se sont retrouvés en rupture de stock de filtres à air.
En venant ici, j'ai commencé à réaliser un peu la particularité numéro 1 de l'Amérique : ses dimensions. Oh, on n'est pas bien loin de Los Angeles, même pas 2000 bornes. On a suivi la route Los Angeles-San Francisco-Portland, ce qui est de loin le plus impressionnant dans ce parcours, c'est le vide : les distances sont invraisemblables d'un bled à l'autre, surtout après le Japon, c'est assez effarant de faire cent bornes ou plus sans voir quoi que ce soit qui ait l'air habité.
Et encore, on est dans une zone relativement peuplée, en allant plus à l'est, paraît-il, on trouvera des régions qui nous feront paraître surpeuplé le désert de Californie. Pour le moment, on habite chez Luc, un Français émigré qui exerce ici le digne métier de mécano moto.
Menu de la semaine, passer mon permis et trouver du boulot. Passer mon permis parce que j'ai toujours eu envie d'en avoir un de rechange, et trouver du boulot parce que notre période californienne a sérieusement endommagé les finances. Tout un programme...
Milwaukie, c'est une ville de banlieue, près de Portland, à deux cents bornes de la frontière canadienne. Il faut que j'essaie de vous décrire un peu ça, c'est assez étonnant.
Apparemment, pas mal d'Américains ont un côté romanichel : dans l'avenue où l'on habite, il y a toute une série de terrains pour mobile-homes, ce sont des maisons mobiles, pas des caravanes, des baraques construites en matériaux légers que l'on peut trimballer sur un ou plusieurs camions semi-remorque. Quand on change de boulot ou que l'on a marre de l'endroit où l'on habite, on s'en va louer un espace ailleurs et l'on y fait amener sa mobile-home.
En l'espace d'une journée, on vous branche l'électricité, l'eau et l'égout, le téléphone, on vous pose le gazon préparé à l'avance que l'on livre avec sa terre, en bandes, et que l'on installe comme un tapis. Il n'y a plus qu'à planter le poteau de votre boîte aux lettres modèle approuvé par le postmaster gêneral, et vous voilà chez vous.
Etonnant. Il y a bien sûr des maisons normales, généralement construites en bois comme au Japon, et des appartements. Les ensembles d'appartements ressemblent souvent plus à des hôtels qu'à des résidences telles qu'on en voit chez nous, un peu à cause de l'a peu près inévitable et très pratique « coin laundry », blanchisserie commune que l'on fait fonctionner à coups de quarts de Dollar, aussi à cause de l'inévitable panneau « appartements disponibles ». Là aussi, on bouge beaucoup, ça va, ça vient, ça déménage, ça emménage, ça bouge.
Tout est loin, aussi. Pour aller acheter de la bouffe ou du film photo, par exemple, j'ai en gros une quinzaine de kilomètres à faire. Du coup, tout est prévu pour l'automobile, des parkings partout, des boîtes à lettres à hauteur de fenêtre d'auto, des comptoirs drive-in devant les banques pour banquer sans descendre de sa caisse, idem chez les marchands de hamburgers, cinémas drive-in installés dans des terrains en proche banlieue, où l'on regarde le film de sa bagnole, des bagnoles partout, des motos aussi, nombreuses et jamais utilitaires. La moto, ici bien plus encore que chez nous, est un jouet.
Milwaukie, vendredi...
Recalé ! Recalé ! Ention et damnafer, et glarque et poutche ! J'ai loupé mon permis de conduire. C'est dur l'Amérique... Je me suis fait recaler comme un puceau, nom d'un chien ! Au code ! Bah, pas grave... Au fond, c'est le permis auto que je viens de rater...
Houlà ! J'en vois qui commencent à me jeter des pommes pourries, des épluchures de betterave, des vieux mégots et des pots de chambre. Objection, Messeigneurs, objection, non coupable ! C'est vrai qu'il y a une heure, j'ai été vu au D.M.V, où j'étais venu au volant d'une Chevrolet Impala pas vraiment neuve, tentant d'attenter de passer mon permis auto.
Vrai, mais à cela une bonne et excellente raison : ici, en Oregon, on ne peut passer son permis moto que si l'on a déjà son permis auto. Je n'ai pas de permis auto. Pour pouvoir obtenir un permis moto américain, oregonien en l'occurence, il faut que je passe d'abord le permis auto, c'est bizarre mais c'est comme ça.
Permis auto, permis auto... Ça va pas la tête ? D'abord, hier, je ne savais pas conduire une auto. Luc a sorti sa vieille Dodge, pas de panique mon pote. Ça ne fait que cinq litres trois de cylindrée, ça n'a que huit cylindres, tout le monde sait conduire ça... Tu tournes la clé, tu mets le levier de vitesses sur « drive », tu accélères avec le pied droit, tu freines avec le pied gauche, et quand ça ne va pas où tu veux, tu tournes le cerceau en plastique devant toi.
C'est tout ! C'était tout. Hier à onze heures du soir, j'avais appris à conduire une auto. « Demain, tu loues une caisse chez Rent a Junker (littéralement: louez une épave) à 8dollars par jour, et tu vas passer ton permis... » J'ai émis des objections : comment louer une voiture si je n'ai pas de permis auto ? Comment aller jusqu'au D.M.V sans permis ? « Tu montres ton permis moto français, ils n'y verront que du feu ». De l'audace, de l'audace !
Ce matin, Luc en allant bosser m'a déposé dans la 82ème avenue devant chez Rent a Junk. J'ai loué une épave. Quand on m'a demandé mon permis, au lieu de sortir l'international qui est écrit aussi en anglais, j'ai sorti mon trois volets rose tout rafistolé. Je n'étais pas plus fier que ça : en face des deux cases tamponnées, Al et A, il y a écrit « véhicules de plus de 50 cm3 sans excéder 125 cm3 » et « motocycles avec ou sans side car », j'avais tout de même un peu la trouille que...
Eh bien non. La grosse dame qui s'occupe des locations a regardé mon carton rose d'un air ahuri, m'a dit « ah c'est en français ? Je n'arrive à rien lire ». Elle m'a demandé où étaient mon nom et le numéro du permis et m'a loué une immense charrette de douze ans d'âge avec 130 000 miles au compteur.
Automobiliste chevronné par près d'une heure d'entraînement la veille, j'ai tourné la clé, mis le levier sur « drive », appuyé sur la pédale de droite, et remontant la 82ème avenue puis la freeway 123 jusqu'à la sortie vers Gladstone, j'ai garé mon salon à roulettes à côté du D.M.V. Diable ! J'allais essayer de passer mon permis auto... Le D.M.V, « Département des véhicules à moteur » de Gladstone, c'est un petit immeuble moderne, sans étage. J'ai pris la file « driver's licences » et, quand ça a été mon tour, j'ai dit «je voudrais passer mon permis de conduire.
-Vous avez un permis d'un autre état ?
-Ben... Oui, français.
-Bon, si c'est un permis d'ailleurs que les Etats-Unis, il faut passer l'examen complet »
Trois pièces d'identité dont une avec photo, demande à remplir, « quand vous aurez rempli votre demande, vous la mettez dans le panier ici, et vous attendez qu'on vous appelle »
J'agrippe un spécimen (gratuit) du manuel oregonien du conducteur, et retourne dans « ma » Chevrolet pour le lire en diagonale. Le code de la route, c'est international, quôa... Une demi-heure et quatre cigarettes plus tard, j'ai l'impression de connaître en gros le code de la route oregonien.
« Fais gaffe aux distances et aux limitations de vitesse » m'a dit Luc. Ah là là ! 20 miles à l'heure dans les zones scolaires ou les business districts, 25 dans les quartiers résidentiels, les parcs et le long des plages, 55 miles sur routes et autoroutes, distances d'arrêt de 40 à 44 pieds à 20 mph, 108 à 124 pieds à 40 mph, 132 à 165 pieds à 55 mph, les phares doivent être visibles d'au moins 500 pieds, on roule en code si l'on suit un véhicule a moins de 350 pieds.
En allant mettre ma demande dans le panier des candidats à l'examen, je me murmurais des tas de trucs en pieds et en miles...
Fwouèdwick Twouenne Douk ! » C'est mon tour. Derrière un paravent, il y a six machines à rétroprojection, avec un clavier à quatre touches pour sélectionner une réponse, et une touche « score » a presser pour confirmer. Pas de limite de temps. Marrantes ces machines, on dirait un peu des flippers.
« Mistuh Twouèn Douk, meuchine neumbeur ouane ! » Arc-bouté sur le flip, je suis prêt à faire ma partie gratuite... Ça s'allume en couleurs. Problème de priorité élémentaire. Clic ! Réponse n° 2. Clac ! Score... « juste » s'allume en vert. Ça continue avec les priorités. Clic ! Clac ! Juste. Clic ! Clac ! Juste... Ah ! Que faire si vous vous retrouvez avec deux roues sur le bas côté ?
1/Vous vous mettez debout sur les freins.
2/Vous mettez gauche toute.
3/Vous vous mettez entièrement sur le bas-côté et vous vous arrêtez.
4/Vous ralentissez et tournez à gauche sans brutalité.
Etant donné qu'il n'y a pas de réponse « je ne fais rien, j'aime le tout-terrain » ni « je me mets à pleurer et j'appelle ma mère », allons-y pour la 4. Score... Juste !
Je me vois déjà avec un sans faute quand ça commence à se gâter : ici, on a le droit de griller un feu rouge, sauf indication contraire, pour tourner à droite à un carrefour, et même pour tourner à gauche si l'on s'engage dans une route à sens unique. A droite, je savais. A gauche, je ne savais pas. Si l'on refuse un alcootest, 120 jours de retrait de permis, pas trente ni soixante ni un an. Je commence à encaisser des « wrong » rouges suivis de l'énoncé de la réponse juste pour faire mieux la prochaine fois. J'ai beau secouer le flipper, ça marque plus des masses.
Dans la panique, j'ai rendu obligatoire la présentation des papiers d'assurance (c'est bon pour la France, des mesquineries comme ça) et je n'ai pas vu un feu de voie ferrée... Examen terminé, retournez au guichet. Un bonhomme poivre et sel pianote sur un clavier, mon résultat sort avec un bruit de crécelle. « Well, -me dit-il avec un sourire sympa-vous avez score 68 points sur 100, et le minimum est de 75. J'ai peur qu'il vous faille étudier ça encore un peu ». Il me tend un nouvel exemplaire gratuit de l'Oregon Driver's manual. Je suis recalé.
Je sors mon portefeuille pour payer l'examen, « non, vous n'avez rien à payer tant que vous n 'avez pas votre permis ! » Ah bon...
Bon, Maintenant, je vais potasser à mort ce fichu code de la route oregonien, et lundi on repart à l'assaut.
Milwaukie, lundi...
Je l'ai eu... Sur le coin de la table, il y a un morceau de plastique jaune gros comme une carte de crédit, avec ma tronche en bas à droite. « Oregon driver's licence » J'ai passé mon permis auto, j'ai changé de camp ! Ce matin, je suis allé louer une plus belle bagnole chez Ugly Duckling (Vilain petit canard). J'adore les noms de ces loueurs de bagnoles d'occase.
C'était un superbe station wagon Chevrolet Malibu jaune, à 12 dollars la journée plus 10 cents du mile. J'ai repris la route du D.M.V. J'avais le super moral pour le code, un peu moins pour la conduite bien que j'aie roulé 100 miles avec la bagnole que j'avais louée vendredi.
Pour cause : ici, on peut avoir à 15 ans un permis d'apprentissage qui donne le droit de conduire à satiété, à condition d'avoir à bord un titulaire de permis normal. Ça veut dire que quand un Oregonien passe son permis, à seize ans, il a déjà un an d'expérience derrière lui. Moi, bon, heu... j'ai 200 bornes d'expérience.
Au flipper, j'ai fait très fort : 92 sur 100. Non mais ho... Ensuite, contrôle complet de la vue : acuité, perception des couleurs, des distances, ça va...
Voulez-vous un permis d'apprentissage ?
-Ben... non, je voudrais passer le test de conduite...
— Vous vous sentez prêt ?
— Ben... heu... Oui, j'espère...
— Bon, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Pourriez-vous repasser cet après-midi à quatre heures ? »
Ouahlàlà, le temps que ça prend de passer son permis dans ce pays...
J'ai repris la Chevrolet et je suis allé bouffer en ruminant le futur test de conduite. J'avais fait rigoler les copains hier en demandant « est-ce qu'ils font faire des créneaux ? » Luc m'a regardé en se marrant et demandé « t'as déjà vu un Américain faire un créneau ? » C'est vrai qu'ici il y a partout des parkings grands comme des aérodromes, alors, un créneau...
A quatre heures moins le quart, j'étais de retour dans la salle d'attente du D.M.V. A quatre heures moins trois, on m'a appelé, on m'a donné une pochette en plastique avec mon dossier, mon numéro d'ordre et un petit pamphlet concernant le test de conduite, « Votre examinateur est soucieux de vous voir montrer votre capacité de conduite optimum, et essaiera de vous aider à dominer la nervosité ou l'anxiété dues à l'examen. Il limitera la conversation à vous donner des instructions, pour que vous ne soyez pas distrait. Votre conduite ne sera pas discutée pendant l'examen. On ne vous tendra pas de piège, on ne vous demandera pas de faire quoi que ce soit d'illégal. On ne vous demandera rien qui ne tienne de la conduite normale d'un véhicule... »
L'examen de rêve, quoi ! A quatre heures, j'attendais dans ma Chevrolet sur le parking réservé aux cobayes. A quatre heures trois, un bonhomme d'une cinquantaine d'années, un peu ventru, s'approche de ma brouette.
Merde, Un vieux ! Allumez vos phares... Clignotant gauche... Clignotant droit. Il fait le tour de la Chevy, clignotant gauche... Droit... Freinez... Klaxonnez... Tout marche. Le bonhomme monte dans mon tank, boucle sa ceinture, et nous voilà partis...
Dix minutes de slalom en ville. A gauche, à droite, tout droit, à droite... J'ai fait deux virages à gauche en intersection into wrong lane. Ben oui, en France lorsqu'on tourne à gauche à un carrefour, on doit aller directement dans la file de droite de la route où l'on s'engage ; ici on va dans la file de gauche, ce qui blague à part évite des tas de cafouillis comme on en voit dans les carrefours de chez nous.
Ceci plus le droit de griller le feu rouge pour tourner à droite, ça réduit les congestions aux carrefours. Cela dit, après quatorze ans de circulation à la française, il faut un moment pour s'y faire. J'ai aussi été un peu vite dans une zone limitée à 20 miles. Bof, j'ai fait 75 sur 100, le minimum.
A quatre heures vingt-quatre, je souriais béatement devant la machine Polaroid à faire des permis infalsifiables, coup de flash, et voilà. Me voici titulaire du permis auto. Coût de l'opération, tout compris, neuf Dollars, trente sept francs trente cinq centimes au cours d'aujourd'hui. Ça revient à combien de passer son permis chez vous ? Quoi ? Vous blaguez... Bon. Demain je vais passer mon permis moto. Ce soir, je potasse l'Oregon motorcyclist's manual, gratuit bien sûr...
Milwaukie, mardi...
Dans la poche, c'est dans la poche,.. Aujourd'hui à 14 h 30, ma driver's licence est passée du type « A » (driver, donc auto) au type « Al » (Driver/motorcycle). J'ai été super au flipper, je savais qu'une moto en Oregon doit avoir au moins un frein, des clignotants si elle a été construite après 1973 ou doit être conduite la nuit, qu'il faut éviter de se mettre debout sur les freins dans un virage, que quand on gamelle, il faut se débrouiller pour ne pas laisser sa jambe sous la moto, que la nuit il peut être utile de suivre une bagnole pour profiter de ses phares et repérer les bobosses au mouvement de ses feux arrière, que l'on peut amortir les grosses bosses de la route en se mettant debout sur les repose-pied, que quand on roule en groupe, il est bon de se mettre en quinconce, qu'il vaut mieux ne pas freiner quand la seringue se met à gui-donner...
En fait, j'ai fait une seule bourde au code, et encore, objection votre honneur ! La première chose que conseille le manuel du motard oregonien si le boisseau de carbu se bloque en position ouverte, c'est de débrayer. Moi, qui suis économe en soupapes, je préfère kill-switcher ou couper le contact d'abord, Bof, on ne va pas faire un procès pour ça...
Le test de conduite... C'était assez symbolique, Je suis venu avec la 900 Kawa de Luc, on m'a fait faire trois huit, quelques zig zags, freiner et passer des vitesses, comme je ne menaçais pas de passer mes vitesses avec le frein arrière, de freiner avec l'embrayage ni de me mettre par terre en faisant un demi-tour serré, on m'a renvoyé devant la machine Polaroid pour me faire un permis Al. Mon permis auto tout seul aura vécu 22 heures. Vive la bécane nom de Dieu !
Voilà... En deux jours, j'ai passé les permis auto et moto. Coût de l'opération, 9 dollars tout compris pour l'auto et sept pour la moto. 16 dollars pour les deux permis, soixante-six francs quarante. Je suis mort de rire... A l'occasion, il faudra que je passe mon permis poids-lourds...
Histoire d'inaugurer mon permis tout neuf, j'ai emmené Petit Prince faire une balade le long de la Willamette, un grand fleuve navigable qui vient du sud et traverse les plus grandes villes de l'Oregon pour aller se jeter dans le Pacifique après Columbia, pas très loin d'ici. Quand elle traverse la grande ville de Portland (grande en surface mais à peine 360 000 habitants), ça donne un paysage assez diabolique de draw-bridges, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français...
Enfin des ponts qui se soulèvent pour laisser passer les bateaux ; de temps en temps il passe d'énormes cargos sur la Willamette. Il y a de ces ponts dans tous les styles, les plus vieux, tout en métal, ont une esthétique assez sinistre.
Sous l'un de ces ponts, j'ai été amusé de voir des pêcheurs. En plein milieu d'une ville moderne, et à côté de ce pont sorti d'un film d'Alfred Hitchcock, c'était un peu déroutant. Nous sommes allés les voir histoire de rigoler, ils me faisaient penser aux pêcheurs de la Seine à Paris, qui sont toujours là mais n'attrapent guère que des capotes anglaises ou autres trucs pas tellement mangeables.
J'allais tenter une vanne du genre « z 'avez pas les moyens de vous acheter des capotes françaises, pour avoir besoin des les pêcher ? ».
A ce moment-là, devant mes yeux ébahis, ça a mordu sec et un gnace a ramené une carpe grosse comme un pot d'échappement de 500 Vélocette. Je lui ai demandé si ça lui arrivait souvent, « Oh, joliment souvent, on prend aussi des saumons, des... des... » je n'ai rien compris au reste de l'énumération qu'il m'a faite, je ne suis pas très fort en poissons en anglais.
Ce que j'ai compris, c'est que dans ce fleuve qui traverse toutes les villes principales de la région, fleuve navigable qui plus est, on pouvait pêcher de tout jusqu'au saumon... De deux choses l'une, ou bien par ici on est encore assez écolo, ou alors les villes sont suffisamment éloignées les unes des autres pour que la nature arrive à être la plus forte.
Pêcher le saumon au milieu d'une ville de 350.000 habitants plus les banlieues, sous un draw-bridge hitchcoquien en face d'une énorme usine de je ne sais quoi devant laquelle se garent des paquebots japonais de 200 m de long, je trouve que c'est du douzième degré. C'est bizarre, l'Amérique.
Portland, mardi
Je vous fiche mon billet que vous ne devinez pas où l'on habite aujourd'hui. A Portland, OK, mais où exactement ? Au Hilton, au Marriott ? Au Benson ? Au Best Western ?
Holà... Motel 6 7Y.M.C.A?
Haha ! Non ! A l'Armée du Salut... Portland Rescue Mission, pour être précis. En un mot, on est dans la dèche, pas moyen pour le moment de trouver un petit boulot noir des familles, alors on dort et on bouffe où c'est gratuit, il faut dire que ça ne manque pas, les miséreux d'ici peuvent faire cinq ou six repas gratuits par jour.
Tenez, pour vous donner une idée : à six heures et demie, ouverture de la Blanchet House. Café, viande, pommes de terre, pain, beurre. Ça, c'est dans la 4ème avenue nord-ouest.
De 7 heures à 10 heures, Portland Peniel Mission, dans la 6ème avenue nord-ouest. Café, donuts. A 9 heures, Portland Rescue Mission, pain, beurre, café, porridge, douche chaude, fringues gratuites.
Onze heures et demie, lunch à la Blanchet House, viande, pommes de terre, soupe aux légumes, pain à volonté.
Trois heures, Armée du Salut, soupe à la viande -parfois- et aux légumes, sandwiches, hamburgers ou hot dogs et fruits en fonction des donations faites par les supermarchés.
Quatre heures, église St-Francis dans la llème avenue sud-est, soupes, sandwiches.
Sept heures, Portland Rescue Mission. Soupe excellente, quoique parfois un peu trop épicée, le cuisinier est un Çheyenne, il a souvent la main lourde sur le piment.
Huit heures et demie, Union Gospel Mission, troisième avenue nord-ouest. Soupe, sandwiches.
Voilà, ça peut faire huit repas par jour, avec le seul inconvénient d'avoir le service (messe) obligatoire partout à part la Blanchet House. Cela dit, les messes valent leur pesant de cacahuètes. Selon le type de confession auquel le truc appartient, ça a sa petite touche personnelle. A la Rescue Mission où l'on habite pour la semaine, ça doit être des adventistes du troisième étage, c'est la Bible à mort. Pendant trois quarts d'heures, on vous explique un passage de la Bible et l'on vous dit et vous répète que Dieu ne vous demande pas d'être parfait, juste de croire, et vous serez sauvé. Et paf, on nous fait chanter « Trust and obey », « The old rugged cross »
Tout ces chants édifiants sont dans un bouquin de 218 tubes, qu'on nous prête dans la chapelle, le 1er au hit-parade, c'est l'Old rugged cross. Ensuite, les croyants du coin viennent nous chanter des chansons religieuses dans tous les styles : gamins de huit ans qui nous chantonnent « Jesus is my savior », couples retraités qui interprètent des duos. Le plus folklo est un mec d'une vingt-cinquaine d'années, guitare électrique, orchestre enregistré sur bande magnétique, qui chante le gospel dans le style country music.
Après on demande des témoignages, deux ou trois mecs se lèvent à tour de rôle pour expliquer quand et comment Dieu les a sauvés. Après on se retape encore deux ou trois tubes, on demande si quelqu'un veut se convertir et l'on va bouffer. Jésus se vend bien à la Rescue Mission : y'en a à l'aise 20 % qui écoutent, et 30 % qui chantent.
A l'Armée du Salut, on joue plus sobre : c'est toujours le même pianiste, avant le service il joue (bien) du jazz. On se tape quatre à cinq chansons, moins qu'à la Rescue Mission, mais par contre à l'Armée du Salut on ne saute pas de couplets. Un sermon du genre volontariste et direction la salle à manger. Ça paie moins : 10 % chantent et à peu près autant écoutent.

Tout ce folklore tourne autour du quartier de Burnside bridge : c'est le vieux Portland, le centre ville en fait. Le quartier pourri. La concentration de clochards y est impressionnante, les trottoirs de Burnside sont perpétuellement parsemés de bouteilles de Porto blanc californien, qui est le Préfontaines des clochards du coin.
Dans la journée, toute cette faune cuve le Porto sur les trottoirs, pour taper dix cents ou un quarter au bourgeois qui passe. Si l'on descend Burnside street, trois avenues plus loin on entre dans le quartier chic du Portland Mail, cinquième, sixième avenue, Broadway, on passe de la cloche aux boutiques de luxe, sans transition.
La nuit, ça boit sec et ça castagne de luxe. Le matin, on compte les coquards. Revenons un peu à notre Rescue Mission : on n'y trouve pas que des clochards, mais aussi pas mal de gens simplement venus bouffer à l'oeil. On y entend souvent pendant les repas des phrases inattendues dans ce genre de lieu du genre « j'ai garé ma bagnole à tel endroit, j'espère que je ne vais pas avoir un parking ticket (contredanse) »
C'est l'Amérique !
Côté logement, c'est une auberge de jeunesse de chez nous, en plus propre. Le seul côté à la limite gênant, c'est que l'on doit se lever a six heures, une heure plus tôt qu'à l'auberge de jeunesse d'Hichigaya où l'on a habité à Tokyo. Heureusement, en ce qui concerne Petit Prince, Bill, le superintendant de la boîte, a fait une exception, il a droit à la grasse matinée.
En me levant, je vais chercher fortune à la « Western Temporary Agency » des fois qu'il y ait un petit boulot à 3,10 dollars cents de l'heure, mon pote, c'est la vie... Le problème, c'est que des boulots même à $3.10, je n'en ai pas encore eu l'ombre d'un. C'est la dèche.
Portland, lundi
Dure la vie d'artiste. J'ai cherché du boulot comme photographe, garçon de restaurant, busperson (ramasseur de vaisselle sale), plongeur, ballepeau. Au Japon c'était bien plus facile, parce qu'un étranger est un être mystérieux tombé du ciel, et que de ce fait on ne lui demande pas de références. Ici, il n'y a pas d'étrangers, tout citoyen du monde est un peu américain, puisque l'Amérique est un pot pourri de la faune du monde entier.
Du coup on demande des références locales. La recherche d'un boulot, aussi, je pensais que ça se passait « à la cow-boy », je te plais, tu me plais, et puis c'est dans la manche. Ben non. Ici, à Portland, Oregon, on fait remplir une demande, avec mention des boulots précédents, que voulez-vous, c'est pas tellement ma faute si mes derniers employeurs étaient au Japon ! Adresse (aux Etats-Unis bien sûr) de personnes qui vous connaissent depuis plus d'un an (!).
Après on vous téléphone ou ne vous téléphone pas pour vous convoquer et Hébin, hébin... C'est pas la gloire. Ça s'arrange pas. Comme le dit si bien Petit Prince, plus ça va, plus c'est pire. C'est dur l'Amérique. C'est dur et c'est doux, c'est bizarre...
A la Rescue Mission, donc une sorte d'armée du salut, on a coulé huit jours tranquilles. Les adventistes du troisième étage et nous, ça marchait impec. On avait dispensé Petit Prince du lever à six heures du matin, on lui laissait accès libre et permanent à la télé et à la salle de ping-pong, c'était le paradis, plus près de toi mon Dieu et tout et tout.
Théoriquement, on ne peut pas rester plus de sept jours par mois à la Rescue Mission mais Bill, le superintendant, et le reste de la clique nous auraient bien laissés rester jusqu'au retour du Messie.
C'est vrai, j'ai complètement oublié de vous dire qu'ici, il y a une tradition marrante : on s'appelle toujours par le prénom, quand on se présente, c'est toujours par le «firstname », le « premier nom », Jules, Théophraste ou Basile. Le nom de famille, ici, s'appelle le last name, le « dernier nom ». C'est ainsi qu'en Amérique, du moins dans la partie de l'Amérique où nous nous trouvons aujourd'hui, on peut fréquenter des gens pendant très longtemps sans jamais connaître leur nom de famille, un peu comme dans le milieu motard, la ressemblance s'arrêtant hélas souvent là, comme ailleurs...
Brèfle, c'est alors que le chef en chef est rentré de vacances avec sa famille. Ben, oui, sa femme et ses enfants, c'est un pasteur. Al, le cuisinier Cheyenne, m'avait dit « eh oui... Tout va redevenir comme avant ».
Ça voulait dire que la discipline allait revenir dans les rangs de la Rescue Mission, le pasteur adventiste du troisième étage sans ascenseur a bien la gueule de l'emploi : sec du haut jusque en bas, le parler dur, la phrase brève. Pas de « baby sitting » ici, Pas question que Petit Prince reste ici quand je vais chercher fortune à la « Western Temporary Services ». D'abord un enfant avec un vagabond fauché... Il devrait vous être retiré...
Ah l'enfoiré...
Ça j'ai pas aimé... Mais pour qui se prend ce cul béni ? Pour Dieu en personne ? Charogne...
Petit Prince, c'est Dieu qui me l'a confié, peut-être pas précisément celui des adventistes du troisième étage sans eau courante, sans toilettes et sans ascenseur, mais Allah, le vrai, celui qui sait ce qui est en nos cœurs, celui que les agnostiques appellent hasard ou fortune.
Voilà-t-y pas un calotin constipé, un fonctionnaire du soit-disant service divin, qui décrète que... Tiens : « Ceux qui brisent les liens que Dieu a noués, voilà les perdants » (Le Coran).
Je crois que je n'ai pas été aimable avec le brigadier Macalotte. Toujours est-il que Petit Prince n'a plus voulu remettre les pieds à la Rescue Mission, même pour manger. Sur les conseils de Bill, on s'est rabattu sur l'Armée du Salut.
C'est là qu'un beau matin, je suis allé petit-déjeuner à la Rescue Mission. Seul, Petit Prince était resté roupiller dans la piaule d'hôtel que l'Armée du Salut nous avait fournie pour quatre jours. Alors que j'ingurgitais ma deuxième ration de porridge, Bill est venu me voir, et, avec un regard gêné, m'a demandé si je pouvais passer au bureau après mon petit déj', tiens, me suis-je dit dans ma Chevrolet intérieure, La Calotte aurait-elle retourné sa liquette ?
Histoire de ne pas jouer les inutiles, pendant notre séjour à la Rescue Mission, j'avais aidé de mon mieux les tâcherons du lieu, peut-être que le chef en chef a fini par penser qu'il serait plus utile de me faire bosser ici, en échange de notre pension plutôt que... Erreur...
Quand je suis entré dans le sacro-saint bureau, il y avait Bill dans ses petites godasses, Monseigneur de Macalotte avec sa gueule d'inquisiteur et... un flic...
Cinq minutes plus tard, je me retrouvais en douceur, dans une bagnole de police, et on allait chercher Petit Prince. Ça lui a fait un sacré choc de me voir arriver avec un lardu... Vingt minutes après, les flics nous amenaient aux services de protection infantile.
« On va mettre l'enfant into custody » dit le cogne d'un air benoît. Quoi, à la DASS américaine, Petit Prince ? J'étais sur le cul : non mais c'est pas vrai, ils sont à côté de leurs pompes, les mecs ?
Interrogatoire séparé, devant la responsable des services de protection infantile, une dame d'une quarantaine d'années, avec une bonne tête et un peu la voix de Françoise Dolto, un être humain, quoi !
A la fin des interrogatoires (Petit Prince d'abord, moi ensuite, puis nous deux ensemble), elle a regardé le flic en souriant et lui a dit que, bien sûr, la situation était inhabituelle, mais qu'elle ne voyait aucune raison de nous séparer, Petit Prince et moi.
Le flic a avalé sa salive, « mais, mais... Vivre comme ça, sans famille, sans argent, sans aller à l'école, sans maison...
-Mais, a dit la dame, quand vous étiez petit, ça ne vous aurait pas plu de parcourir le monde, comme ça ? »
Le flic a dit... « Mais... » et puis rien. Il nous a ramenés à l'hôtel, en me recommandant de bien surveiller Petit Prince. Comme s'il fallait.
L'alerte avait été chaude. Je m'en suis aperçu de façon tout à fait mathématique en allant à la Blood Bank. Pour le moment c'est notre seule source de revenus, ici : deux fois par semaine, je vais « donner » du plasma sanguin à 7 dollars la première prise et 11 dollars la seconde de la semaine. Ce matin là, on m'a refusé : ma pression artérielle maximum était descendue de 104 à 82. Après ça, n'allez pas me dire qu'on n'aime pas avec le cœur...
Cela dit, c'est pas la joie. Toujours pas l'ombre du soupçon d'un boulot. Pas de problème pour la bouffe, je fais la tournée des meilleurs endroits, j'assiste benoîtement aux messes, et au moment du repas, j'enfourne le meilleur dans mon sac pour l'amener à Petit Prince.
Comme c'est lui qui bouffe toute la viande, mon taux de protéines, contrôlé régulièrement à la Blood Bank, baisse progressivement. Ça n'est rien, mais c'est un peu déprimant, cette galère. Pas le pied de jouer aux parasites en gravitant de la Rescue Mission à l'Armée du Salut, la soubrette de l'hôtel nous a conseillé d'essayer aussi St-Vincent de Paul, mais on ne va tout de même pas tous les faire...
Demain il faut qu'on quitte l'hôtel Clifford. C'est la fin des quatre jours offerts par l'armée du Salut. J'ai tubé à St-Vincent de Paul, ils n'ont pas de piaules disponibles pour demain. Alors, demain ? Je n'ai pas eu les 11 dollars de la Blood Bank, pas moyen de raquer une chambre d'hôtel. Demain ? Eh merde, demain, on verra...

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Portland, lundi
C'est le gag : on tourne en rond. Samedi soir, on a couché sous le pont de Burnside. C'était bien. Un peu frais la nuit, mais un routard local nous a prêté des couvertures. Il y a de la faune sous Burnside Bridge, du clochard aviné, du vagabond, du routard-sac-a-dos, de tout. Quoi de plus normal que coucher à la belle ? Ben voilà.
Dans un jardin public en plein milieu d'une ville grouillante de Cadillac, avec au-dessus du nez des rampes d'autoroute, ça n'a pas le goût sauvage d'une nuit à la fraîche en Inde. Et puis, à propos de fraîche, c'est très frais au petit matin.
On s'est réveillé tout humide de rosée, sûr que sans les couvertures du routard, on aurait attrapé la castapia. C'est plus l'été, quoi, merde ! Si qu'on aurait du fric, on retournerait en Californie, d'un autre côté si qu'on aurait du fric, on n'aurait pas à coucher dehors...
Dimanche matin, je suis retourné à l'assaut de St-Vincent de Paul. On a eu une piaule pour deux jours, dans le même hôtel qu'avec l'armée du Salut, mais à l'étage au dessus, avec salle de bains particulière et télévision.
On est lundi matin, à midi il faut qu'on se trisse. Du coup, suivant le conseil des clochards du coin, dans une demi-heure, je vais au welfare. C'est l'assistance publique. Les collègues clodos prétendent qu'ils sont susceptibles de nous fournir des food stamps pour avoir de la bouffe gratosse dans les épiceries, un logement peut-être même du fric, il faut venir avec une lettre disant qu'on va être vidé de l'endroit où l'on habite pour cause de manque de fric.
Le patron de notre hôtel, qui a l'habitude, m'en a fait une. Ça a l'air complètement débile le truc, vous vous imaginez venir en touriste dans un pays, tomber en panne de fric et du coup aller demander des allocations familiales ? N'importe quoi... Seulement, dans la situation où l'on est, le mieux est encore de tenter... n'importe quoi...
N'importe quoi... Ça continue. Nous voilà ce soir dans une baraque prêtée par une fondation catholique à des réfugiés vietnamiens. On n'a pas eu les allocations familiales, faut quand même pas pousser mémère !
Le welfare nous a envoyés à un autre service qui nous a confiés à un prêtre catholique de choc qui nous a parachutés avec la « Hài Hong family ». Sont sympas les réfugiés viet, mais d'une part, je ne parle pas viet, et ils parlent anglais comme des jonques thaïlandaises, d'autre part, comme je suis porteur d'un passeport issu par le gouvernement viet actuel, je subodore qu'ils me prennent pour un démon envoyé par le fantôme de l'oncle Ho pour tirer la nuit les orteils des traîtres à la patrie. Drôle de situation...
La maison est typiquement américaine avec deux salles de bains grandes comme des cathédrales, on se fait des concours de plongée pas possibles dans la baignoire avec Petit Prince, je le bats de vingt secondes en apnée, pourtant il devrait me battre, il fume pas un paquet par jour, je n'arrête pas de lui expliquer que pour économiser l'air, il faut faire le mort, mais il faut qu'il s'agite en plongée. Bah... Peut-être qu'il veut me faire gagner...
Demain, on doit aller voir notre prêtre de choc pour voir ce qui se passe. Allez, dodo.
De réfugiés en réfugiés, nous voilà avec des Cubains, au « Matt Talbot Center », à l'origine un asile pour alcooliques ou drogués repentis. Le repentir se vendant apparemment de moins en moins bien, dans cette espèce d'auberge de jeunesse, il y a une majorité de réfugiés cubains.
Le courant passe bien, que voulez-vous, c'est comme ça : je suis un Viet qui ne parle pas viet mais se débrouille en espagnol.
Mon premier acte, ici, a été de rédiger en espagnol un télégramme pour un des cubains qui voulait annoncer à sa conmadre restée à la Havane avec leur fille qu'il est en Amérique, qu'il a trouvé du boulot chez un concessionnaire Porsche, qu'il l'aime et que...
J'ai eu beau tasser le texte, ça a dû lui coûter un super-max, son petit mot de billet. La conmadre va croire qu'il a trouvé un poste de manager à 150 000 dollars par an, le pauvre, sous-prolétaire aux Etats-Unis à 3,10 dollars de l'heure, c'est pas Byzance, et la promotion sociale ne va pas si vite quand on ne parle pas anglais, ne sait pas même écrire l'espagnol et qu'on n'a pas l'ombre d'un diplôme valable de ce côté-ci. Que cherchent-ils ces gars ?
Le plus vieux a cinquante-huit ans et sucre les fraises qu'on croirait qu'il a passé sa vie à piloter une Norton Atlas. Ils trouvent le boulot dur et mal payé, et encore, la piaule ici ne leur coûte que 20 dollars par semaine, et pour combien de temps ?
Je bavarde avec eux, ils me font souvent l'impression d'être des adolescents fugueurs. Bizarre, Si un jour j'allais à Cuba, pour voir ? Boh. Le problème, pour le moment, n'est pas là. Ça nous fait un sursis, ce refuge.
Côté bouffe, pas de problème, je continue à faire la tournée des bouffes gratis de la ville avec des sacs en nylon pour ramener la part de Petit Prince. Pas le luxe, mais en mettant de côté toute la viande pour lui, j'arrive à lui faire des bouffes convenables.
Deux fois par semaine, c'est la fête : je vais à la Blood Bank « donner » du plasma sanguin. Sûr, c'est pas le panard de passer deux plombes avec une aiguille de tapissier dans le bras pendant que les shadocks pompent, mais ô joie, à la fin du chemin de croix, de passer à la caisse et de partir en froissant les billets verts dans ma poche...
Avec les sept bucks de la première saignée, je me sens Onassis, en moins mort. Avec les 11 de la seconde, je suis Rockefeller... Onze Dollars. Même pas cinquante balles... Je vous jure qu'avec ça, quand je les pelote dans ma poche, j'ai l'impression de posséder le monde.
L'avantage de la dèche, c'est que ça revient moins cher de se sentir riche. Et puis, et puis... Il y a autre chose. Ouais... Autre chose que je n'arrive pas encore à analyser, mais je crois bien qu'ici, l'argent me fascine. Pourtant, c'est pas spécialement beau, un Dollar, d'un côté c'est tout gris avec deux chiures vertes et la gueule à Washington, de l'autre c'est tout vert, ça n'a pas l'aspect délicieusement cucul des multicromies suisses, c'est massicoté à la mords-moi-le-noeud, faut se lever matin pour en trouver deux avec la même marge, c'est dévalué à mort, et pourtant...
Et pourtant, j e vous garantis que quand je sors de la Blood Bank avec mes quelques Dollars, que je les roule dans ma poche en descendant Washington Street vers le centre de la ville, je prends un pied pas possible. Souvent, je m'arrête pour les sortir de ma poche et les regarder. Ça n'est pas le fait d'être dans la dèche. J'en ai connu de pires en Egypte, au Japon, en France aussi, jamais des petits bouts de papier ne m'avaient fasciné comme ça, même quand j'étais dans la patouille jusqu'aux cheveux. Non, c'est autre chose, c'est nouveau. Ça doit être l'Amérique...
Portland, samedi...
Aujourd'hui, Petit Prince et moi avons commencé et aussitôt terminé une nouvelle carrière : cueilleur de loganberries, sorte de grosses mûres. Au départ, l'annonce dans le canard était alléchante : « on demande des cueilleurs, grosses loganberries sans épines, payé au poids, se présenter à la Johnson farm »
Tiens, tiens...
Le problème était d'y aller. Le boulot commençant à six heures du matin, à quatre heures et demie, Petit Prince et moi étions debout pour aller prendre le bus sur Union Avenue.
A six heures, un seau en plastique accroché à la taille, on commençait à cueillir comme des bêtes. A sept heures quinze, on avait empli deux racks de quinze livres, on se voyait déjà riche, le flip est qu'on n'avait pas demandé combien on payait le rack.
On a fait une drôle de tronche quand la contremaîtresse nous a filé 2 Dollars 10. Merde ! Sept cents la livre, vous voyez le temps qu'il faut pour cueillir proprement une livre de mûres ?
Petit Prince a craqué. D'une part, parce que c'était vraiment trop mal payé, d'autre part parce qu'il aime bien les mûres. Il en a un peu trop bouffé. Overdose, quoi...
J'ai continué le boulot, pour n'arrêter qu'à l'heure où le picking se termine, treize heures.
En sept heures de boulot, on s'est fait huit bucks et quinze cents. Pas de repas gratuit, même pas un coup à boire, sur le chemin du retour Petit Prince crevait tellement la dalle qu'on s'est arrêté au Mac Donald's de Gresham où il a goinfré deux big Macs à $1.25 avec un coca « Big Deal » à 65 cents. Merde ! $2.60 de bus pour aller à la ferme, plus $3.15 de secours d'urgence, ça fait $5.75 de frais pour gagner $8.15 en sept heures de boulot, ça fait $2.40 de « net income », soit environ 0,34285714285714 2857142857142857 Dollar de l'heure !
Non mais ho ! Je sais bien que ce boulot, comme dirait la copine Dana qui, aux dires confirmés de mon pote Luke, est 300 % américaine côté radinisme, nous a apporté $2,40 qu'on n'avait pas avant, mais pas question de me lever et surtout peut-être de faire lever Petit Prince à quatre heures et demie du matin pour aller gagner 0,3428571428571 et quelques de l'heure, même si on ne les avait pas avant on ne les aura pas après, pour aider les Johnson à toujours avoir les Cadillac de l'année, faut dire aussi qu'ici, quand on parle de « pauvres fermiers », c'est pour rire ! Debout, les damnés de la terre !... Nous ne serons plus pickers à la Johnson's farm, du moins, je présume...
Portland, lundi...
Que diable suis-je allé faire dans cette galère, et pourquoi y ai-je entraîné Petit Prince ? J'en ai un peu ras zobi. On n'avance pas d'un pouce. Moi à courir les petites annonces avec de moins en moins d'espoir, Petit Prince qui n'a rien de mieux à foutre qu'à regarder la télé, fut-elle en couleurs, parce que nous habitons à Burnside, quartier pourri des alcoolos et réprouvés de tout poil, sillonné nuit et jour par les bagnoles bleues et blanches de la Portland Police, saturé de viande saoule, bref le quartier où l'on amasse les réfugiés et les perdus justement parce que c'est le plus pourri.
Quand je remplis une demande de boulot, arrivé au chapitre « adresse et n°de téléphone », je ne peux pas mettre « 222 NW Couch, 222 23 79 » parce que ça voudrait dire « quartier des drogués, réprouvés et alcooliques, Enfer » Alors, je mets l'adresse et le numéro de téléphone de Dana à Beaverton, peut être bien que je loupe tout parce qu'elle est rarement là pour répondre au téléphone, peut être que, peut être que...
J'en ai plutôt ras-le-cul. Rien n'avance, rien.
Portland, lundi...
Un miracle... Oh... Un petit miracle, mais comme dirait Dana, un miracle qui n'était pas arrivé avant. Ce matin, je suis allé comme souvent à six heures à la Western Temporary Services lire mon journal en attendant un éventuel boulot temporaire ; à 9 h 45, comme d'habitude, Terry, le marchand d'esclaves, a fermé les lourdes de l'agence, au moment où j'allais partir, « pouvez-vous me rappeler votre nom ? Fred ? Ça fait pas mal de fois que je vous vois ici, je vous mets sur la liste pour le Mémorial Coliseum ce soir».
C'est ainsi que j'ai été Janitor de minuit à huit heures ce matin. Nettoyer un stade après un concert pop aux Etats-Unis, tout un programme. Le sol recouvert de graillou de Pepsi Cola évaporé, des déchets de toutes sortes dans des quantités absolument invraisemblables.
En arrivant au Coliseum avec les 17 autres temporaires de la Western qui allaient aider les employés réguliers du Colisée à faire un truc presque propre pour le lendemain huit heures, j'ai regardé la scène, parole, les écuries d'Augias, à côté, c'est la Suisse.
Ben à huit heures, quand on est parti, c'était pas propre, mais ça en avait presque l'air. Moi, j'avais mal aux reins, mal aux mains, j'étais un peu dizzy mais j'avais fait mon premier boulot aux Etats Unis, et j'avais aussi compris que j'étais à côté de la plaque. Pendant que je moppais le Coca, pardon, le Pepsi par terre, un de mes collègues d'un soir m'a demandé : « Found some good dope ? -Waddya mean ? »
Encore un coup, j'avais compris les mots, mais pas le film, comme on dit. « Found some good pot ? » Ben non, je n'avais trouvé ni dope ni pot, même pas un centième d'once de vieille colombienne moisie, et je n'ai même pas osé dire que j'avais trouvé infiniment mieux, trois paquets neufs de pop corn au caramel qui feraient un petit déjeuner paradisiaque pour qui vous savez. Bon, je suis à côté de la plaque, mais j'ai tout de même gagné vingt-trois Dollars et vingt cents, avec les onze Dollars de la Blood Bank demain, ça va être... l'Amérique...
Portland, jeudi...
La chance tourne ? Après avoir fait chou blanc hier et ce matin à la « Western », je ruminais ma tristesse assis sur une chaise. Linda, l'une des bonnes âmes de notre centre pour Cubains, drogués et alcooliques repentis, est venue me voir en me demandant texto : « Do you mind washing dishes ? ». (Ça vous ennuie de laver les assiettes ?).
Je me suis marré, et une heure après, j'étais plongeur temporaire chez Aldo, dans la sixième avenue. Une sinécure, la retraite avant l'âge. Trois assiettes et autres trucs à prélaver avec un jet d'eau savonneuse sous pression, mettre dans la machine et remettre en place. J'ai fait du style et du zèle et ai discrètement planté des jalons pour bosser là-bas toutes les nuits, à $3.25 l'heure, ça serait... L'Amérique !
Portland, vendredi
Diem perdidi ! O erreur ! O connerie monumentale ! J'ai raté le coche. Toute la matinée, jusqu'à deux heures, j'ai attendu un coup de téléphone de Aldo's, espérant y rebosser ce soir et peut être les nuits suivantes. Après j'ai vaqué et suis parti vendre mon plasma à la Blood Bank. Ça a duré plus longtemps que d'habitude, faut dire que le vendredi, les « donneurs » à 7 ou 11 dollars sont là en masse. Bref, quand je suis revenu au refuge des junkies et alcoolos associés, Aldo's avait téléphoné et embauché un autre mec pour la nuit. $20 évaporés. C'est dur l'Amérique...
Portland, dimanche
Deuxième chance : encore une fois, un mec du centre est venu me demander si ça m'emmerdait de laver des assiettes. Une heure après j'étais au « John's Meat Mar-ket ». Y'avait du boulot, certes, J'ai trotté pendant sept heures de la machine à laver la vaisselle à la cuisine, au salad bar, au bar, j'ai balayé, j'ai moppé, y'avait du taffe, J'ai fait $19.50, Bienvenus !
Portland, lundi
Rien, nada boulot. Ça fait rien, il nous reste 9 dollars d'avance. Ce qui merde, par contre, c'est qu'il va bientôt falloir quitter le Matt Tal-bot Center, le curé en chef a décrété que Petit Prince et moi n'étions pas qualifiés à bénéficier de cet abri, catholique par dessus tout. Boah, les « cool cats » du centre ont l'air de vouloir faire traîner les choses, On verra...
Portland, mardi
Une semaine sans écrire un mot. Normal, le monde se renversait, et comme disait le père Musset, « l'homme n'écrit rien sur le sable à l'heure où passe l'Aquilon » Le monde a basculé.
Mardi, coup de téléphone du « Meat Market » pour redemander un plongeur, j'y cours et y bosse comme un python foutu. Félicitations du jury, Bravo, vous avez fait super ! Ça vous intéresserait de bosser ici à temps partiel ou plein temps ?
Devinez ce que j'ai dit ! Merde, plongeur, c'est pas la gloire, mais vingt bucks cash par soirée, tu parles ! Vous revenez demain soir ? A deux plombes du mat' je suis rentré du boulot, me suis couché à côté de Petit Prince qui en écrasait comme un sonneur, je me suis régalé à le regarder dormir, c'est fabuleux un enfant qui dort...
Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allé écrire dans la salle à manger, et à six heures, comme Morphée se refusait toujours à me prendre dans ses bras, je suis allé à l'agence Western.
Une heure après, je montais dans une bagnole vers un nouveau boulot, Mamma mia ! Le pire que j'ai jamais eu dans ma chienne de vie, encore que... disons l'un des pires.
Du caoutchouc issu de vieux pneus broyés à mettre en sacs de 50 livres et mettre en piles de deux fois 14 sacs. J'ai commencé à la machine. Quand on n'a pas dormi la nuit précédente, au début, c'est un peu flippant.
C'est tout con, la machine est un revolver à six coups qui tourne d'un cran toutes les quatre secondes. Il suffit de prendre un sac en nylon neuf sur la pile, de le décoller, l'ouvrir, et le mettre autour de la bouche qui passe devant vous, avec la trace de moulage en face de la mâchoire de droite.
La mâchoire... Les mâchoires... Deux gros trucs en acier qui se referment automatiquement toutes les quatre secondes pour emprisonner le sac qui va se prendre 50 livres de vieux caoutchouc dans la gueule, holàlà. Cool, à froid comme ça, c'est rien, mais après une nuit blanche, c'est le flip absolu. On se voit déjà les mains prises dans ce piège à con, entraîné par le machin pourri, recouvert de caoutchouc jusqu'à la centième génération.
Et c'est super safe, les mâchoires sont actionnées par des vérins pneumatiques avec des évents jusqu'au point crucial, C'est-à-dire que si les mâchoires rencontrent la moindre résistance avant le point X où elles doivent serrer le sac, elles n'ont aucune force, il a fallu que je me fasse prendre la main trois fois de suite avant d'en être presque sûr...
Après, c'est presque le paradis, pschiiiii, les mâchoires qui s'ouvrent de l'autre côté pour larguer le sac plein au collègue, Bziiiii le revolver qui revolve, Floutch, flatch, flouwatche, je mets le sac en place. Pschiiiwouwatch ! Les mâchoires qui se ferment. Tout dans le rythme : si tu le perds pendant une seconde, c'est la merde pendant des minutes entières... Pschiiii, Bziiii, flop, flatche, flouwatche, poiiiwouatche, c'est la rumba du sous-prolétaire.
Alléluia ! Je me voyais déjà faire carrière dans le pschiii, bziii, flop, quand on m'a dit « bon, c'est ton tour par là... »
Là, s'agissait de prendre les sacs de 50 livres, de les agiter-avant-de-s'en-servir, pour que le caoutchouc se répartisse partout, de les vider de l'air qu'on respire, et de les entasser jusqu'à la quatorzième génération.
Là, j'en ai chié comme un Russe émigré aux Etats-Unis, ou un Etat-Unissien émigré en Russie. L'horreur. J'appelais ma mère in-petto mais comme elle n'est pas dans mon petto mais dans le Loir et Cher, ça n'a pas aidé des masses.
J'ai donc bossé, bossé, bossé. A deux heures de la fin du shift de huit heures, je n'étais plus qu'un bout de viande qui essayait de bouger des sacs de caoutchouc.
Je me disais : « je laisse tomber, rien à foutre, je perds 3,10 dollars et je vais me coucher ». Je regardais aussi d'un oeil assassin un gros lard qui s'était bien démerdé pour rester à la machine et ne pas bouger un sac.
Fumier, va ! Après tu vas faire du jogging ou coûter du fric à Medicaid avec ton hypertension !
Merde, au cul les trois derniers Dollars, j'arrête... On est quatre, si j'arrête, quatre égalent zéro. Un pour mettre les sacs vides, un pour prendre les sacs pleins et les mettre dans la machine a souder, un pour les secouer et les aplanir, un pour les entasser en pile de 14, si j'arrête, tout s'arrête, et on est quatre à avoir $3.10 dans le cul. Les miens sont mon problème, les autres... S'ils sont là c'est qu'ils sont dans la dèche, travailleur, n'arrête pas la machine à faire survivre les clodos...
Je ne sais pas comment j'ai fini la journée, toujours est-il que vers les cinq heures, je touchais un chèque de $23.20 et que je retournais à notre refuge, non sans passer chez Burger King au coin de la 6ème et Burnside pour prendre un double cheeseburger pour Petit Prince.
Une heure et demie pour me laver et prendre mon service au Meat Market. Quand, à mon arrivée, on m'a dit : « il faut partir ce soir », Je le savais. On devait aller au Broadway Hôtel pour une nuit et se démerder après.
O.K. J'étais prêt à déménager nos oripeaux et me laver vite fait avant de prendre mon service. Manque de pot, pas de Broadway Hôtel. « Vous savez où dormir ce soir ? » Non... Sur le coup, j'étais trop crevé pour me rappeler qu'on m'avait dit que Petit Prince et moi étions théoriquement logés cette nuit-là, fallait repartir bosser.
J'ai vaguement lavé une de mes deux chemises, j'ai pris une douche en laissant dans la baignoire une couche pas croyable de caoutchouc, et je suis allé au boulot après qu'on m'ait dit que je n'étais pas sérieux de n'avoir pas prévu mon logement pour la nuit et qu'on verrait ça quand je reviendrais.
A deux plombes du mat', je suis revenu de mon lavage de vaisselle avec de nouvelles félicitations du jury. J'ai la cote au Meat Market.
On m'a dit que j'avais jusqu'à sept heures et demie avant de mettre les voiles. Je suis allé me coucher. A sept heures et demi, deux officiels de la boîte nous faisaient lever, Petit Prince et moi.
J'ai agrippé le téléphone pour trouver immédiatement un hôtel à prix accessible pour que nous puissions continuer notre nuit de sommeil. Seulement... Seulement, l'Oregon, c'est l'Oregon, un état de vieux, je pense. Toujours est-il que c'est « no kids no pets ». Enfants et animaux sont interdits un peu partout.
Vous cherchez un appartement ? Les petites annonces disent très souvent : « adultes seulement » quand elles sont pudiques, « pas d'enfants ni d'animaux » quand elles le sont moins, « pas d'animaux ni d'enfants » quand elles sont claires et nettes.
Hôtels très bon marché, même trip. Au bout d'une heure d'appels à jet continu, j'ai piqué l'une de ces rognes dont tout Moto Journal sait le secret. Elles sont une accumulation de trucs et de machins, dont, de l'extérieur, on ne voit qu'une petite partie.
Brèfle, j'ai ex-plo-sé et suis parti en balançant les valdingues dans l'escalier, emmenant Petit Prince qui, lui non plus ne comprenait pas trop ma rogne.
On est parti dormir près de Burnside Bridge, Le soleil tapait déjà bien, J'ai roupillé en pointillés... C'est Petit Prince qui m'a réveillé.
Je l'entrevoyais se balader le long de la Willamette, il est arrivé en clamant : « Fred ! Y'a un mec qui dit que si on ne sait pas où aller, on peut venir chez lui ». J'avais la flemme et je n 'y croyais pas trop.
Je lui dis de venir ?
-Ouais... »
C'est ainsi, à côté de Burnside Bridge, que, précisément le matin où j'avais le plus besoin de lui, j'ai rencontré Lawrence. C'est ainsi qu'on habite maintenant une grande, grande maison pleine de piliers, de fenêtres à vitraux et de recoins comme on en voit dans les films de Hitchcok.
C'est ainsi que, aussi, je viens d'apprendre que j'ai obtenu un numéro de sécurité sociale aux Etats-Unis. Ça y est. Je crois qu'on a conquis l'Amérique !!!
Je vais essayer de vous présenter Lawrence d'Amérique (gag abscons) et la maison où l'on vit maintenant. Lawrie l'a achetée 5 000 dollars, deux briques, après qu'elle ait souffert trois incendies de suite. La baraque est absolument démente. Hitchcoquienne. Une maison de schizophrène au troisième degré.
Elle est grande, mais pas très, selon les normes américaines. Seize pièces sur trois niveaux. Y'a pas de quoi chier une pendule, mais elle est à mon sens un reflet d'une certaine vieille Amérique, un peu schizo, un peu parano.
Des coins, des recoins, de petites fenêtres partout. Trois escaliers pour passer du rez-de-chaussée au premier étage. Des portes partout. Instinctivement, dès le premier jour, Petit Prince l'a appelée « la maison de la sorcière ». En bref, la baraque est tellement torturée et mystérieuse que Petit Prince n'ose pas aller seul de notre chambre à la salle de bains la nuit. Il essaie, pourtant, mais lorsqu'il ouvre notre porte et se trouve face au couloir avec des portes dans tous les sens...
Et puis, l'odeur... L'odeur de vieux bois. Comme la plupart des maisons de la région, c'est aussi vrai en Californie et... au Japon, la maison est à 90 % en bois. Elle a quatre-vingt cinq ans d'âge, et surtout en cette saison où il pleut beaucoup en Oregon, elle sent le vieux bois.
La nuit, elle n'arrête d'émettre de petits grincements, couinements, on la sent vivante. Bref, Petit Prince en a peur, et il faut que je l'attende devant la porte des chiottes s'il y va la nuit.
J'adore cette baraque, parce que dans ce pays de 204 ans d'âge, où tout bouge à une vitesse effrayante, elle a l'air de surgir d'un passé immémorial. Au fond, 85 ans, c'est pas si loin de la moitié de l'histoire de ce pays.
J'appelle les Etats-Unis un pays mais je sens, je sais déjà que ce n'en est pas un. D'accord, avec un seul visa on a accès à cet énorme morceau de continent, ça, c'est le côté administratif. C'est comme si un jour, il suffisait à un Américain d'obtenir un seul visa de la Confédération Européenne, ce n'est pour autant que la Suède et l'Italie seraient deux pays semblables.
Y'a pas, c'est un good deal, le visa américain : c'est un des rares à être gratuit et en couleurs. En plus, il est valable pour cinquante pays. Nous y voilà, Etats Unis d'Amérique : cinquante états, cinquante pays.
Il y a quelques semaines, nous étions en Californie. Californie du Sud devrais-je dire, parce que la Californie toute seule est aussi grande que la France, et que par conséquent, il y a autant de différence entre San Diego (Californie du Sud) et Eurêka (Californie du Nord) qu'entre Lille et Toulon.
Entre San Diego et Eurêka, par exemple, il y a en gros 1500 kilomètres, vous voyez le film ? Aujourd'hui, on est en Oregon. Pour commencer, on ne parle pas la même langue qu'en Californie.
Quoi ? Quiquadit si ? Pas du tout. Un exemple simple... En Californie du Sud, quand vous dites « Saint-Cloud » (merci), on vous répond généralement « hoquet » (ça va). Ici, en Oregon, on dira « ouelcome » (bienvenu) ou, très souvent « choure ». Aha ! Quexa veut dire ? Hébin « sure » ça veut dire « sûr ». Le fameux « choure » est une abréviation de « you are surely welcome », « vous êtes sûrement bienvenu ».
Seulement, pour un étranger, « hoquet » et « choure » quand on dit « Saint Cloud », ce n'est pas la même langue. Tout simple ! Hoquet, c'est du californien du sud, choure, c'est de l'oregonien de l'ouest, deux langues différentes...
Même genre de problème, j'ai appris l'anglais à Londres, du coup, quand je ne comprends pas ce que l'on me dit, je dis « sorry ? » (désolé) d'un air interrogateur. En Californie, ça marchait bien. Ici, on dit « pardon ? ». Je ne vous traduis pas. Du coup, la première fois que l'on m'a dit : « Hi Fred, what's hap'? », what's hap' étant l'abréviation de « what is happening » (qu'est-ce qui arrive, c'est-à-dire comment ça va ?), j'ai répondu « sorry ? », on m'a répondu « pardon ? ».
C'est pas de la tarte. Tout ça pour vous dire que les Etats-Unis ne sont pas un pays, même pas administrativement... Par exemple, en Californie, état frontalier, il existe un permis spécifiquement moto (permis 4) valable pour tous les deux roues de 0,1 à 100.000 ce, et même le titulaire d'un permis « 1 », l'équivalent du « Cl » français (semi-remorque de plus de je ne sais combien de tonnes) ne peut piloter un vélosolex.
La loi en Californie est ainsi faite qu'il est extrêmement difficile de poser légalement son cul sur un deux roues avant 18 ans, et de toutes façons jamais sans un permis spécial. Ici, en Oregon, il existe un permis cyclomoteur (même genre de daube qu'en France, 30 MPH et pédales), mais pas de permis moto spécifique : le permis moto est une annexe du permis auto, on peut donc le passer à 16 ans et une minute, juste après avoir passé le permis auto. Un titulaire de permis auto peut conduire un cyclo.
Il y a quatre permis en Californie. Moto, auto, camions/bus et remorques.
Chez nous, en Oregon, il y a « cyclo », permis au fond totalement bidon vu qu'il n'est pas plus facile à obtenir qu'un permis auto, un permis auto, et un « chauffeur », valable pour poids lourds avec ou sans remorque, bus et tout et tout. Vous voyez le film ?
Encore, pour l'instant je ne vous parle que de deux états frontaliers et dans le seul secteur des permis de conduire. Les Etats-Unis, cinquante états, cinquante pays. Bref, on est en Oregon dans la maison de la sorcière, en fait, il y a cent ans, un mec comme Lawrence aurait probablement été brûlé comme sorcier.
C'est... disons un américain de gauche. La maison de la sorcière est une sorte de refuge pour dissidents de tout poil. Le courrier, la plupart du temps adressé à des personnes dont le nom ne me dit rien, mais qui ont dû habiter ici par le passé, porte souvent des en-tête bizarres : comité pour l'amitié américano-iranienne (dieu sait que c'est pas la saison), aide aux réfugiés espagnols, association des scientifiques concernés (par quoi ?).
Bref, une copieuse partie de ce que l'Amérique peut compter d'associations bizarres. Lawrence lui-même appelle son domaine « la maison des inadaptés mentaux ». Inadaptés mentaux. Il y a de ça...
La preuve, actuellement, on est six a fréquenter assidûment la maison. Je dis assidûment parce qu'il y a aussi beaucoup de va-et-vient, et ben si l'on décompte Petit Prince qui n'a pas encore l'âge de ce genre de choses, il y en a deux qui... Non, vous n'allez pas me croire, pourtant c'est vrai, il y en a deux qui n'ont pas... Ah non, je ne peux pas dire ça, après vous allez sauter la page en disant « il raconte n'importe quoi, ce routard a la noix, parce qu'il a trouvé une carte de presse et un permis moto à la place d'une photo de footballeur dans un paquet de chocolat aux pousses de bambou, il se figure qu'il peut nous faire prendre des chambres à air de Vélovap pour des H4 occultés pour cause de raid aérien, non ».
Ben si, j'vais vous le dire, et tant pis si vous ne me croyez pas : en décomptant donc Petit Prince et en me comptant moi, donc sur six y'en a deux qui n'ont pas de voiture. Quoi ? Vous ne faites pas de crise cardiaque ? Vous ne vous récriez pas ? Vous ne hurlez pas à l'invraisemblance ?
On voit que vous n'êtes pas d'ici. La bagnole, dans le coin du monde où nous sommes, c'est le prolongement peut être pas naturel mais en tous cas indispensable de tout Orégonien qui se respecte un tant soit peu.
Luc, par exemple, qui a été notre hôte pendant nos premiers temps en Oregon, est est un motard invétéré. Il avait ici deux Kawa dont j'ai fait ample usage, une 900 ZI et une 750 H2. Tiens, la ZI je vous en avais parlé, mais la H2 tiens, il se passait tant de trucs dans ma tête et autour à ce moment-là...
Un vieil os, plié de partout, sans freins ou presque, que Luc avait acheté 75 dollars (trente sacs) en pièces détachées. Il avait commencé à la remonter, puis, un peu déprimé par l'état général des morceaux de la pauvre trois pattes, l'avait laissée béton. Comme j'avais du temps libre, j'ai fini de la monter et de la faire marcher.
Wah, les mecs, ça faisait sept ou huit ans que je n'étais pas monté sur une 750 Kawa, en bon état c'est déjà impressionnant, mais une H2 pliée, sans freins, en pots de détente, sans papiers, (ici, c'est pas grave), sans assurance (c'est pas grave non plus tant qu'on ne se plante pas), avec une immatriculation (californienne) périmée depuis quatre ans (ici, on renouvelle son immatriculation tous les deux ans).
Ouh, la crise ! ! ! J'ai baigné dans le rire et l'illégalité.
Bon, merde ! C'est pas de moto que je voulais vous parler, c'est d'autos, A.U.T.O.S. Donc, Luc, motard invétéré, a deux motos, sûr, mais aussi une auto. Une vieille Dodge qu'il a achetée cent sacs, d'accord, mais il vit en Oregon, donc il a une auto.
Des mecs sans auto, sûr, j'en ai connu ici, surtout en baignant dans le milieu des clochards, réfugiés ou autres réprouvés de tout poil. Un clochard sans auto, ici, est un clochard vrai de vrai tombé bien bas ; pas de bagnole, pourquoi ? Le permis, tout le monde l'a, on le passe ici à seize ans comme on demande sa carte d'identité en France.
D'ailleurs, un permis de conduire ici, ça coûte le prix d'une carte d'identité en France, moins peut-être, je vous l'ai dit, quand je l'ai passé, permis de conduire tous frais inclus, manuel, examen, photo, ratages éventuels, neuf Dollars, trente sept francs 80 !
La carte d'identité oregonienne (d'ailleurs également délivrée par le département des véhicules à moteur, c'est dire qu'on n'en sort pas) ici coûte trois Dollars, douze francs soixante. Avouez que si, à seize ans, vous aviez eu le choix entre une carte d'inden-tité à 12,60 F, ou un permis de conduire à 37,80 F (jamais plus, les ratages sont gratuits) vous n'auriez pas hésité des masses !
Bref, le permis, bof... La voiture... Ici, on achète une bagnole d'occase, une bonne belle grosse un peu rouillée mais qui tourne bien pour 300 dollars, disons cent sacs pour faire un compte rond. Une petite bagnole, faut être riche, c'est beaucoup plus cher. Si l'on n'est pas regardant côté état général, climatisation qui ne marche pas, freins fatigués, rouille ou bobosses, il n'y a plus de minimum de prix. On peut avoir un truc qui roule pour rien. Quand je dis rien, c'est RIEN.
Bref, ne pas avoir d'auto, ici, c'est une déchéance ou un vice. Ici, en Oregon, peut être qu'à New-York ou San Francisco ce n'est pas pareil, mais San Francisco est en Californie du Nord, et New York dans New York State, ce sont d'autres états, dont d'autres pays. Pas de bagnole en Oregon, oh certes ce n'est pas interdit pas la loi, mais c'est tellement bizarre... Je crois bien que c'est un peu à cause de ça que je n'arrive pas à trouver un boulot un tant soit peu suivi.
Quand on se présente quelque part pour un boulot, la première chose que l'on a à faire est de remplir une demande d'emploi. Même dans un petit restau minable où l'on postule un travail de « busser » (ramasseur de vaisselle sale) on commence par remplir une demande, et immanquablement se trouve la question : avez-vous une voiture ? Marque... année... est-elle assurée ? Nom de la compagnie... N° de police d'assurance. ..
Sur certaines demandes, on va jusqu'à imaginer l'inimaginable « sinon : (pas de voiture) comment viendrez-vous travailler ? ». Pas de voiture, c'est la Bérézina. La marginalité totale. N'avoir pas de voiture ici, c'est comme n'avoir pas un centime d'argent liquide en France, il faut être soit très riche, soit vraiment très pauvre, soit franchement marginal.
Ici, on peut tout, tout payer avec sa « Visa » ou sa « Master Charge », donc le citoyen le plus moyen peut n'avoir pas une dime en poche. Par contre, pas de voiture...
Sûr c'est possible, mais alors, il faut avoir une position, pouvoir exhiber des « credentials » tels que... On admet ici qu'un humanoïde n'ait pas d'auto comme on admettrait qu'un musicien soit aveugle ou un danseur soit pédé. Le cas à part, avec tout un « background » derrière. Oui, je sais, c'est le cas de le dire...
Je reverrai toujours la tête qu'a fait la secrétaire de Personnel Pool, une agence d'intérim moins minable que la « Western » qui m'a fourni mon premier boulot de balayeur, quand elle a vu que j'avais coché la case « pas d'auto ». You guys've got a transportation problem ! (vous les mecs, vous avez un problème de transport). Comme j'étais tout seul en face d'elle, quand elle disait « vous les mecs », elle devait parler des clochards en général. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Personnel Pool ni des autres boîtes où j'ai laissé une demande d'emploi, C'est dur l'Amérique...
Lundi.
C'est le gag, les mecs... Le big big gag... Je vous écris cette nuit de l'Acropolis. Ah non, le gag, c'est pas ça, je ne me suis pas retrouvé parachuté en Grèce par une opération du Saint-Esprit ni de la Western Airlines : l'Acropolis, c'est un bistrot à l'angle de la 15*™ et Burnside Ouest, il s'appelle l'Acropole parce que le patron est grec comme trente-cinq kilos de Feta, mais on est toujours à Port-land, Oregon, Etats-Unis d'Amérique.
Alors, le gag ? Par la fenêtre tout en petits carreaux du bistrot en question... Attendez... Je suis obligé d'écrire par rafales, je suis éclairé par une horloge tournante suspendue derrière le bar, publicité pour « Budweiser, la reine des bières », à travers la vitrine disais-je, je vois une Ford L.T.D. « Country Squire » qui me sourit de toute sa calandre et me fait des clins d'œil avec ses quatre phares... C'est ma voiture...
Si, si, c'est pas des blagues, j'ai tous les faffes à mon nom, j'peux vous les montrer, c'est moi le proprio de GGN 218, un break de pas loin de six mètres de long, huit places plus les bagages, tous les sièges arrière repliables pour transformer l'autobus en maison roulante, moteur V8 de 400 Cubic inches (Si les 80 CI des Harley dernier modèle font bien 1340 ce, ça fait donc 6700 ce pour mon auto), boîte automatique, toutes commandes assitées, air conditionné... Une auto A-ME-RI-CAINE !
Mon auto. Je l'ai achetée cash avant hier soir à un pello qui partait bosser en Alaska, et liquidait par le fait même tous ses biens mobiliers. L'a craqué quand j'ai posé le pognon sur la table. Le cash sur la table, ici encore plus qu'ailleurs parce que l'argent liquide devient un moyen de transaction exceptionnel, ça fait baisser les prix.
J'ai acheté mes six mètres de tôle emboutie, sept litres de cylindrée, huit pistons et trois cent chevaux, pour cinq cent vingt cinq Dollars. Deux mille deux cent quarante francs. Y'a pas, que l'on mesure ça au mètre, au kilo, au centimètre cube, au prix du piston ou au cheval vapeur, c'est pas cher. C'est l'Amérique !
Je suis puissamment mort de rire. Il s'est passé tellement de choses, dans ces derniers jours, que ce n'est qu'à l'instant, en sortant du boulot, après avoir écluse la moitié du « mug » que je me tape à l'Acropolis en sortant de mon boulot, vers une heure du matin (neuf heures chez vous) que je réalise le truc.
C'est pas un rêve éthylique, c'est vrai qu'il est là, mon char d'assaut vert clair avec de vrais flancs en faux bois véritable, son « roofrack », galerie de toit parfaitement intégrée à la ligne de l'engin, bref, me voilà avec une auto potentiellement mobile (je l'ai mise sur le parking du restau d'en face), après, si je ne me trompe, environ cinq mille quatre cent quatre vingt sept jours de moto comme unique moyen de locomotion personnel.
Mais pourquoi ? Quia ? Quomodo ? Quando ? Quibus auxi-liis ? Quia mollescevis ??? Quia, porque, perche, li anno, je devrais dire because, je veux être Américain... Pour un temps. Je vous ai dit, il y a... Je ne sais plus, ça fait en gros deux ans et demi que j'ai foutu la clé sous le paillasson, et un jour ou plusieurs, je vous ai dit que mon pied n'était pas de traverser en coup de vent un pays et d'en faire une rapide photographie, mais de me fondre dedans, de m'y intégrer, d'y devenir insivible.
Ça a pas mal marché en Egypte, en Syrie, en Jordanie, ça a foiré en Inde parce que je ne voulais pas, au Népal et au Japon parce que je ne pouvais pas, ici je sens que ca va marcher en plein, et que surtout vu de chez vous, ça risque d'être le rire.
Normal que ça marche. En Amérique, à part ce qu'il reste des Indiens, tout le monde est étranger, donc personne ne l'est. La langue, c'est de l'anglais orégonien ici, californien en Californie, texan au Texas, mais ici tant de monde se déplace tant d'un endroit à l'autre que partout où je suis jusqu'ici allé, se mélangent les accents des cinquante états de l'Union, ou pire.
Les papiers. J'ai passé mon permis de conduire orégonien. C'est la pièce d'identité N°l. J'avais lu dans « La semaine de Suzette » que la première chose à faire quand on débarquait en Amérique était de demander un numéro de sécurité sociale. J'ai reçu ma carte la semaine dernière.
Je suis l'humanoïde n° 543 98 2231 en Amérique. Le jour où ma carte de Social Security est arrivée, je l'ai insérée dans un portefeuille normes américaines que je me suis acheté chez J.K. Gill, normes américaines, c'est-à dire très petit et bourré de pochettes transparentes, Lawry a ri et s'est exclamé « ça y est ! Tu es Américain ! Dis : je suis Américain ! ».
Je n'ai rien dit : je n'étais pas encore Américain, il me manquait une voiture. Ça s'est déclenché il y a trois jours : A la First National Bank of Oregon est arrivé le fruit de mes salades des derniers mois dans Moto Journal.
En sortant de la banque, je suis allé chez Ugly Duckling louer un break Oldsmobile avec un moteur de 455 CI (sept litres et demi) et j'ai foncé à Milwaukie pour aller acheter à Petit Prince ce dont il rêvait depuis des temps mémoriaux : son premier vélo !
Ah ! le premier vélo ! C'est quelque chose dans la vie d'un gosse ! Je me souviens du mien comme si c'était hier. Le premier vélo de Petit Prince ne ressemble pas du tout à celui que j'avais eu à l'époque (Bon sang ! Il y a plus de vingt ans !), parce qu'on est en Amérique et que l'on vient du Japon.
Ici et là-bas, la grande mode, c'est le vélo de cross. Des engins sous-dimensionnés, avec des cadres ultra-solides, pas de frein avant, des pneus à tétines, des guidons à barre de renfort et des protections en caoutchouc mousse sur toutes les parties métalliques où l'on risque de se faire un gnon. La bête de Petit Prince, c'est un Huffy Pro Thunder 4S, le dernier cri en matière de vélo de cross, avec des roues monobloc !
Haha ! La tête de Petit Prince quand il a vu son vélo ! On a fêté ça. Petit Prince a fait une manche de cross dans le parking de « Church's Fried Chicleen », quelle joie !
Une ou deux heures après, coup de grelot du restau où je faisais des extras comme plongeur de nuit « notre plongeur n'est pas venu bosser. Combien de temps vous faut-il pour venir le remplacer ? »
En temps normal, il faut que j'aille prendre le bus n°5 sur Union Avenue ou le n°29 sur Vancouver Street, un passage toutes les demi-heures et un quart d'heure de trajet jusqu'à la cinquième avenue sud-ouest, puis marcher jusqu'à la 22™ avenue nord-est, c'est un coup d'une heure avec du bol.
Là, j'avais l'Oldsmo-bile. « Je serai là dans un quart d'heure ! » J'ai fait ronfler les 7 litres 5 du char d'assaut, dix minutes après j'étais au boulot, deux heures après j'étais officiellement embauché sous le numéro d'employé 909.
C'est là que j'ai craqué. Le lendemain matin, j'ai regardé les petites annonces de l'Oregonian, j'ai écume les « station wagons », et c'est comme ça que je suis devenu proprio de GGN 218.
Tiens, si on l'appelait « Gégène » ? La bagnole m'a amené un boulot permanent, le vélo de Petit Prince lui a permis de s'intégrer dans la bande des gosses du coin.
Eh oui, on le mettait de côté parce qu'il n'avait pas de vélo, il ne pouvait donc pas suivre la bande. Ce qui est drôle est que comme nous vivons dans un coin pas cher, c'est naturellement un quartier à majorité noire. Donc les copains de Petit Prince sont des colorés.
Or les noirs ne parlent pas avec le même accent que les blancs, en parlant au téléphone avec quelqu'un, par exemple, on peut quasi-infailliblement savoir s'il est noir ou blanc. Hé bien, comme dirait l'autre, ça déteint. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est drôle quand mon Petit Prince rentre de jouer, d'entendre ce petit blond aux yeux bleus parler avec un accent nègre. Une fois je lui en ai fait en riant et en anglais la remarque, il m'a répondu « Ouate de phoque ? »
C'est l'Amérique. Voilà... J'ai une auto, je suis Américain.
Petit Prince a un vélo, il est noir Américain.
Portland, jeudi...
Merde... L'ascension sociale en Oregon, c'est pas ce que j'eusse cru que ça fût : au John's Meatmarket, au moment où l'on a décidé de m'embaucher à plein temps, je me suis dit que c'était le pont d'or, ou presque. O colossale désillusion : à la fin de la quinzaine, il s'est horriblement et épouvantablement avéré qu'en fait de pont d'or, je gagnais moins qu'avant.
Toujours 3,25 Dollars de l'heure, moins la Fédéral income tax (FICA) moins la Sécurité Sociale, moins la taxe sur la taxe, moins la taxe sur la taxe ajoutée, ça me fait gagner un bon 20 % de moins.
A part ça, j'ai la super cote dans la boîte, ils ont tout de suite vu que j'avais la plonge dans le sang. La plonge, c'est comme tous les arts, il faut avoir le feeling. A l'oeil je discerne l'assiette pas trop grasse que la machine va laver toute seule de celle avilie de fromage râpé (le pire), de beurre ou de pâte à gâteau qu'il va falloir dégrossir au jet d'eau chaude ou même au Scotch Brite plus Chloro 12 ou autres si l'on veut que le truc sorte propre de la machine.
La machine... Je l'ai appelée « Conchita » parce que, les jours où il y a des banquets de 80 couverts, et que quand les 80 invités repoussent d'un seul geste leur assiette et couverts et verres à entrée avant d'entamer le New-York steak à $13.95, les bussers m'amènent aussitôt toute la came à laver.
En fait, ils pourraient le faire plus progressivement, mais ils sont comme tout le monde, ils voient bien un client finir, puis un autre, mais ne déclenchent le geste d'aller ramasser les assiettes ou les verres sales qu'au moment où un tel déplacement devient éminemment rentable.
L'inertie aidant, on prend du retard, si bien qu'un vent forcissant prend des allures de tornade. D'un coup, je vois arriver des montagnes de putain de vaisselle sale, alors comme je suis le dernier de la chaîne, il faut bien quelqu'un à appeler au secours. Or, en-dessous de moi dans l'échelle hiérachique, il n'y a que Conchita, il fallait bien que je lui trouve un nom... Conchita... Il y a des nuits où je n'ai plus qu'elle...
Faut dire qu'ici, c'est le meilleur des mondes de Huxley : chacun sa tâche. Les « hosts » sont les hôtes. Les « waiters » sont les garçons, les « bussers » ramassent la vaisselle sale sur les tables. Les « dishwashers » lavent le tout, je dis « les dish-washers » parce qu'il y en a deux : Conchita ma machine et moi.
On porte le même nom : ici, un plongeur humanoïde (moi) et une machine à laver la vaisselle (Conchita) sont tous deux appelés dishwasher. C'est nous le bas de l'échelle. Au-dessous de nous, le néant.
Oh, le néant a un nom : Janitors : ce sont les esclaves souvent loués a une compagnie extérieure qui viendront nettoyer le restau quand les derniers des derniers sont partis. Bref, il y a bien des soirs où j'en ai quelque peu ras zobi. Pourtant, y'a pas, faut bien continuer, pas le choix. Retourner à la Rescue Mission avec le pasteur qui ne s'est jamais remis de n'avoir pas participé à l'inquisition, aller faire la file à 11 heures 30 à la porte de la « Blanchet House » pour le déjeuner gratuit et tout le quotidien de celui qui ne sait pas où bouffer...
Au fond, tout seul, je m'en foutrais. Seulement, il y a Petit Prince qui pour moi vaut bien mieux que ça. Je n'ai plus le droit de buller... Lavez, lavez, lavez, lavez la vaisselle...
J'en ai marre d'être regardé de haut par les garçons et les ramasseurs de vaisselle sale, j'en ai marre que les ramasseuses femelles laissent accumuler leur merdier avant de venir avec un sourire de mes deux me dire : « Pourriez-vous me faire une faveur ? Je n'arrive pas à porter mon bus tray (plateau à merde), pourriez-vous le faire à ma place ? »
En plus, c'est évident, je me fais estamper. La première fois où j'ai bossé ici, c'était comme extra. Le dishwasher de nuit d'alors, ça me paraît déjà si loin... Comment s'appelait-il ? Un tout grand maigre, coiffé en brosse ou presque, même que son nom m'avait fait marrer parce qu'il me rappelait un très mauvais chanteur rock français des années 60.
Ouais ! Vince, comme Tay-lor qui est riche. Bref Vince avait demandé un mec en extra parce qu'il y avait un banquet de 60 couverts en plus de la litanie habituelle.
Depuis que je suis là, gros banquets ou pas, je suis seul à me démerder avec la vaisselle sale. Vince travaillait ici depuis un an et demi. Ben... Ils l'ont lourde, normal, vu que je travaillais plus... O. K, Vince était plutôt bran-leur, un peu du style à laisser le boulot aux autres dans la mesure du possible m'a-t-on dit.
Mais merde ! A $3,25 de l'heure moins 20 % de taxes, remboursables à la fin de l'année si l'on n'a pas gagné assez gros pour être imposable, qu'est-ce qu'on voudrait ? Des héros ? Bref, ma furie de la plonge a mis au chômage un véritable Américain, Vince.
Au coin de Burnside et de la 22ème avenue Nord-Ouest, en face du Ring Side, au John's Meatmarket, il n'y a plus qu'un plongeur de 18 heures jusqu'à la fermeture : l'envoyé spécial et exclusif de Moto Journal en Oregon, môa...
Quelle merveille ce nouveau plongeur, il bosse dur, il est toujours à l'heure, il ne gueule pas trop sur le fait qu'il gagne moins depuis qu'il est employé régulier, c'est vraiment de la bonne pâte.
Je suis en transit. Je ne pense pas rester ici plus longtemps qu'en Inde, au Népal, ou où que ce soit. Je ne veux rester nulle part. Je triche. Du coup, bien sûr, c'est facile de donner plus quand on sait que dès que l'on en aura marre ou qu'on le pourra, on reprendra ses billes.
Pardon, Vince, je t'ai foutu au chomedu, et puis merde, quand je me tirerai d'ici, ils auront bien ton numéro de téléphone pour te faire revenir... Merde... Je suis crevé...
Ce soir, comme chaque soir de travail, je me suis tapé mes deux mugs de Budweiser à 55 cents à l'Acropolis, et la grosse Gégène est garée de l'autre coté de Burnside, dans le parking du restau mexicain qui est fermé à cette heure.
Il est deux heures cinquante cinq du matin, le temps que je traverse la rue, que je démarre la Gégène, que je descende Burnside, que je tourne à gauche dans la llème, à droite dans Everett, que je passe le pont métallique sur la file du milieu le pied à la planche, que je tourne à gauche vers Seattle, droite sur Union Avenue, tout droit jusqu'à Killingworth, droite jusqu'à Cleveland avenue, gauche jusqu'à Jessup, droite sur Rodney, je trouverai Petit Prince, s'il ne s'est pas endormi, en train de regarder la fin de « Peter Gunn » à la télé sur le Channel 6. Complètement nul ce que je viens d'écrire. C'est ma vie...
Portland, lundi
Ce matin, enfin... Ce matin... Il est 2 heures 03 de l'après-midi, d'après ma Picco quartz alarm achetée $12,99 chez Fred Meyer au coin de Union et Killingsworth, et échangée sans discussion ni présentation du ticket de caisse après que la première eût expiré peut-être un peu à cause dun geste désordonné de Petit Prince qui la fit violemment choir.
Ici, c'est l'Amérique, le client a raison. Bref, je m'éveille au 5733 NE Rodney et le monde a de nouveau bougé. Je ne bosse pas ce soir, mais Petit Prince, lui, est au charbon. A cette heure, il est élève de 3rd grade (CE2 chez nous) à l'école Martin Luther King Jr, à l'angle d'Al-berta et de la 7èmc Nord-Est.
C'était franchement plus possible qu'il n'ait comme horizon que la télé, les petits copains et moi. Faut qu'il apprenne à vivre sur la terre telle qu'elle est, enfin, je crois qu'il faut, je sais pas. je sais rien, que celui qui sait m'écrive, il gagnera certainement son enveloppe retournée avec la mention « parti sans laisser d'adresse ».
Je suis crevé... Je ne bosse plus... J'ai démissionné du Meat Market. Hier... Dimanche, jour calme, en plus jour d'élections. Reagan a été élu, ça m'a foutu les boules... J'ai fait une visite dans la réserve à vins. Exerunt deux bouteilles de Chablis pas californien, que j'ai éclusées, allongé tel Néron sur une table à découper la viande.
Eh bien croyez vous qu'on m'ait viré ? Non, il a fallu le même soir que je démissionne pour une raison d'avance sur salaire qu'on ne pouvait plus me donner vu qu'à une heure et demie du matin, la caisse était fermée.
A priori. Petit Prince, la grosse Gégène et moi quitterons l'Oregon la semaine qui vient. On ne pouvait pas rester éternellement en Oregon. Il y fait un temps dégeulasse, brouillasseux, triste à se tirer des balles dans toutes les têtes que l'on a.
Du coup, j'ai vendu un peu de texte à un journal auto. Ben... quoi ? Au fond j'ai eu ici pour $534 mon permis de conduire et la grosse Gégène fière de ses quatre phares, ses huit cylindres et six litres sept de cylindrée, pourquoi ne pas en profiter pour vendre de la copie à l'automobileux ?
Il faut que j'en profite pour vous parler de Gégène, mon ô-to-mô-bile. Gégène (GGN 218), c'est l'anti moto par excellence. Une auto comme même l'Amérique n'en fait déjà plus. Eh oui, ici en matière d'auto, c'est la panique à l'économie de carburant. Pensez, le prix de la benzine qui est monté ici au-delà de $1 le gallon (environ 1,20 F le litre) O, ciel ! Ça a provoqué une sorte de mouvement de panique, une masse d'automobileux s'est précipitée vers les autos économiques.
Or, les autos économiques sur le marché américain, étaient toutes étrangères. Cette année, les trois marques américaines (Ford, GM et Chrysler) contre-attaquent comme des bêtes pour que l'Amérique reste l'Amérique. Un peu comme Motobécane a piteusement essayé de le faire en France il y a dix ans lorsqu'il s'aperçut que le marché moto (quelle honte) était reparti.
Donc, Gégène avec ses 8 pistons gros comme des tambours de garde républicaine, c'est déjà une pièce de collection, Six litres sept, 6700 centimètres cubes ! Presque cent fois la cylindrée de Puce ! Sauf erreur, le plus gros moteur offert aujourd'hui sur le marché américain des has been à roulettes ne cube que six litres. Une histoire qui prend fin. Finis les 8 litres 2 des Cadillac Eldorado 1972, la cylindrée baisse sur l'index Dow Jones, devrais-je dire Down John ?
Gégène, c'est pourtant tout doux. Un bateau et un avion. Un bateau a cause de son inertie effrayante, de l'impression qu'elle donne a son barreur de piloter une péniche sous les ponts de la Seine. Tout prévoir à l'avance...
Un avion parce qu'elle pousse tout de même relativement fort, et avec une constance... J'en viens a conduire mon wagon souvent comme une grosse moto moderne : fais attention au compteur, sinon tu ne sais plus à quelle vitesse tu vas.
L'anti-moto, Gégène. Que tu roules à 10 miles ou à 100, même absence de bruit moteur même absence de tout ce qui te donne l'impression d'être en train d'avancer. S'il fait froid comme en Oregon en ce moment, mets donc le chauffage qui pourra si tu le veux te rappeler la Floride en été, s'il fait chaud, le bouton à gauche, sous la colonne de direction te met en route un air conditionné dont le compresseur est aussi gros qu'un moteur de Mob. Gégène, c'est le moyen de se mouvoir sans avoir l'impression de sortir de chez soi. En tant qu'Américain, je trouve Gégène positivement idéale...
Portland, mercredi...
Ça merde... Ma carrière de journaliste automobile a foiré. Je ne sais pas si mon papier est paru, toujours est-il que je n'ai pas touché de sous. J'ai donc entamé une seconde carrière de laveur de vaisselle ; avec mon expérience du Meat Market, ça n'a pas fait un pli.
Maintenant, je suis plongeur en chef et assistant aux pizzas chez Accuardi's. Je gagne plus en travaillant moins. Le personnel, après 22 heures, est une grande famille. Il m'a fallu deux jours pour comprendre en partie pourquoi : à partir de cette heure-là, où le chef en chef s'en va dormir, tout le monde s'en va par groupes de deux ou trois fumer le calumet de la paix dans la chambre froide.
Une fois, j'ai fumé avec Andrew en début de nuit, comme je n'ai pas l'habitude, ça a été infernal. Je bossais trois fois moins vite, tout me paraissait colossalement difficile à faire, depuis je ne fume plus le calumet de la paix qu'une fois le boulot fini. J'aide à la cuisine, je fais des pizzas, je dépanne un peu au bar quand le personnel normal roule un peu trop sur la jante. C'est un bon boulot, relax. Personne ne me regarde ni de haut ni de bas. On m'a promis une augmentation en fin de mois...
Downtown Portland, lundi...
Les gars, ça ne va pas être facile : ce soir il faut faire le point, et pour ça, il va falloir marcher tout en flashes-back : accrochez vous, on y va... Ça y est : je suis Américain. Si d'aventure ce soir, je devais canner d'un serrage de bielle au coin de Sandy et de la 122èmc avenue, le flic de service qui fouillerait mon cadavre encore fumant conclue-rait, au vu des « credentials » contenus dans mon crapaud made in USA, que la belle Amérique a perdu un citoyen.
Permis de conduire... Carte de Sécurité Sociale... Carte de membre de l'American Motorcycle Association. Carte de l'American Automobile Association, Carte de la State Farm Insurance. Carte du National Home Health plan, tout y est. Carte de crédit aussi, Bon... oui... oh... D'accord, la mienne c'est pas ça qu'est ça, que voulez-vous, dans ce pays qui n'est plus riche, qui vit sur son passé ou rêve de le retrouver, on ne trouve plus les cartes de crédit dans les pochettes surprise.
La mienne, c'est pas la Visa, c'est pas la Master Card, c'est pas l'American Express don 't leave home without it, qu'ils disent à la télé, c'est pourtant ce que je vais faire, c'en est une qu'on achète pour 50 cents dans les chiottes de tous les bistrots louches, la « Charge a vice ».
Comme son nom l'indique aussi bien en français qu'en anglais, elle n'est pas valable que pour les activités dépravantes, encore moins pour les autres. Je l'ai effectivement achetée 50 cents dans une des machines à sous des chiottes de la Jockey Club Tavern au coin de Killingsworth et de la 10ème avenue nord, non, pas cette machine-là, celle-là c'est les capotes françaises scientifiquement designées pour le plaisir de la femme, celle qui est pile au-dessus du lavabo. Américain je suis.
Blague à part je peux discuter pendant une demi-heure au café du coin avec un quiconque sans que l'on me demande où j'ai ramassé cet accent. Je comprends presque tout ce qu'on me dit, et pour le reste, j'ai appris assez de borborygmes et autres monosyllabes pour avoir l'air d'être en train de suivre la conservation. C'est peut-être bien a cause de ça que j'ai soudain décidé d'aller voir ailleurs si le ciel est plus clair.
Sûr qu'il le sera, le climat d'hiver de l'Amérique du nord-ouest, c'est pas du canot cake : froid pas trop, mais pluie, brouillard pire qu'à London-London : quand je rentrais à trois plombes du mat de mon dernier boulot d'un bout du monde de plongeur en chef et sous-assistant cuisinier chez Accuardi's au coin de Davis et de la 5ème nord-ouest, souvent a moitié bourré et toujours aux trois quarts stone, j'avais l'impression en traversant Burnside Bridge qui enjambe la Willamette plus cinq autoroutes et dix-sept voies de chemin de fer, d'être la vedette américaine du dernier thriller signé Alfred Hitchcock.
Sinistre à ne pas en croire sa pointe Bic.
Ajoutez à ça les patrouilles de flics en auto, incessantes à cette heure de la nuit dans ce quartier pourri, flics-flics dont le regard me vrille le dos, je vous jure que je les sens penser « qu'est-ce que c'est ce mec A PIEDS à cette heure de la nuit » ben oui, merde, mon boulot étant à dix minutes à pieds de chez moi, je laissais mon sept litres full power air conditionné devant ma porte pour aller bosser pedibus jambiscum.
Ah le crime ! Ah l'anathème ! Abjure !! Une Dodge bleue-blanche de la Portland Police, allant vers l'est sur Burnside, m'a repéré MARCHANT A PIEDS et sur mes jambes de l'autre côté du pont.
Trois fois, la bagnole-à-bourres est allée faire demi-tour sur Union Avenue pour venir se garer de mon côté. Pas pour me taper aux faffes. ici, c'est pas la France, ça ne se fait pas sans raison. Non. Pour m'inspecter des yeux, pour voir si j'allais me sauver en courant, confirmant par là mon évidente culpabilité.
La première nuit où j'ai eu comme ça les flics au dos. le cerbère de mon hôtel (c'était une cerberesse cette nuit-là) ne dormait pas.
Dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a dit : « Ne vous arrêtez pas, foncez dans votre chambre, les flics sont après vous ».
C'est vrai que j'habite de nouveau dans un hôtel. Fini la maison de la sorcière, Lawrence d'Amérique, après m'avoir invité chez lui « par amitié » a voulu me faire casquer un loyer tellement astronomique qu'un matin j'ai mis Petit Prince, son vélo, ses jouets et tout dans la Grosse Gégène, pour disparaître sans laisser d'adresse.
Maintenant, on crèche au Bridgeport Hôtel, l'hôtel des traîne-patin. Trente Dollars la semaine, dans ce pays où un « Motel6 », la chaîne de clapiers la moins chère, coûte 12 dollars par jour, c'est vous dire si c'est la zone. D'ailleurs, une affiche à la réception annonce qu'il est interdit de taper des cigarettes ou de l'argent aux autres locataires sous peine de se faire virer.
Malgré ça, le Bridgeport, comme le Shore-line, le Broadway, le Clifford et tous les bouges de la vieille ville, sont le refuge des t'as pas cent balles, qui se dit ici : « can you spare a quarter », le leitmotiv de l'Amérique pauvre.
Oh, putain... Elle est là et bien là, je baigne dedans jusqu'au cou. l'Amérique du chômage, des allocations de ci ou ça, des food stamps, coupons pour acheter de bouffe délivrés par les bureaux d'aide sociale, des taux d'intérêts à 20,5 % dans les banques et 49,33 % plus frais de dossier dans les monts de piété.
L'Amérique... Probablement le seul pays du monde où l'on puisse être à la fois propriétaire d'une bagnole de six mètres de long avec un moteur qui vous tracterait un train de banlieue et assez de circuits hydrauliques et de moteurs électriques pour combler le déficit de l'EDF, et être positivement au fond de la merde.
Devant l'hôtel des Tapassemballes, on se bouscule pour les places de parking. Des clochards qui consomment 30 litres au cent parce qu'ici, plus les bagnoles consomment, et moins elles sont chères. La Volkswagen de ma copine Mimi la Crêpe, tape cul exigu plus bruyant qu'une moissonneuse batteuse, cote trois fois plus cher que mon palace roulant qui a le même âge et à peu près le même kilométrage.
La moindre petite cylindrée en ruines se vend plus cher qu'une Cadillac en état correct. Woh ! Chierie ! L'Amérique est folle. La bagnole normale américaine la plus chère (Cadillac Seville, 21088 dollars list priée) est équipée en série d'un moteur diesel de 105 chevaux pour mille huit cent soixante quinze kilos à tirer (traction avant). Comment ? Si ça se traîne ? Un peu mon neveu ! Une Seville Diesel, comparée à une auto de clochard comme la mienne, c'est une mobylette sans variateur contre une Yamaha OW 31. Sept ans et 20 263 dollars de valeur marchande les séparent. Eh eh ! Pour posséder une bagnole qui se traîne, ici, faut avoir les moyens !
Remarquez, 21088 dollars au cours actuel, ça fait en gros neuf briques, et avec en série la FM stéréo, les glaces, les sièges, la fermeture de coffre, les verrouillages des quatre portes électriques, l'extinction des phares automatique quand on quitte la bagnole et autres gadgets-surprise, c'est plutôt bon marché. Seulement, ça ne veut rien dire de convertir les Dollars en francs. L'Amérique, c'est un pays pauvre.
21000 dollars, ici, c'est un vieux tas de pognon. Les Seville dernier modèle, facilement reconnaissables à leur cul en lame de rasoir style Rolls des années 40, il n'en traîne pas des masses à Portland. C'est presque aussi rare qu'une Harley.
Je vous assure que quand il passe une Harley dans la rue, on la remarque. Ici, on roule jap à moto, à part pour les fanas, la Harley, c'est débile et inutilement cher. A Tokyo, les Harley je ne les remarquais presque plus. Faut dire qu'au Japon, pour être « in » faut avoir l'air américain, les pauvres, s'ils savaient ! Le monde marche à l'envers...
L'Amérique est complètement à coté de ses pompes. La Chrysler Corporation ne sait plus à qui taper cent balles pour ne pas se casser la gueule. Le président Reagan a promis de « remettre l'Amérique au travail », Nom d'un chien, il va en avoir, du taffe ! Ouillaillaille ! A 204 ans, l'Amérique doit apprendre à devenir adulte, Remarquez, 204 ans pour un pays, c'est probablement à peine l'âge de la puberté. Ça y est ! Je sais ce qui bouleverse l'Amérique : c'est la puberté...
Ouais, je dis ça parce que je suis un Américain pauvre, que je gagnais péniblement 500 dollars par mois en faisant 40 heures par semaine, eh oui, « gagnais », jusqu'à hier... Maintenant que je suis devenu un honnête travailleur américain, bien vu de son employeur, la comédie est finie, il est largement temps d'aller me faire pendre ailleurs.
J'ai collé ma

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Temple Bar, jeudi...
Ouf... Ce soir et pour quelques jours, on fait la pause. Temple Bar, Arizona, au bord du lac Mead. On n'a pas quitté l'Amérique, et en fait, on ne la quittera pas avant le printemps au plus tôt.
On est parti tambour battant, Portland, San Francisco, Los Angeles, A Los Angeles, en feuilletant les petites annonces du « Recycler » on s'est équipé pour le camping.
Une tente pour 35 dollars, sûr qu'elle a pas l'allure d'une tente de riches étrangers, on dirait plutôt une cahute de Huns. Cela dit, comme le dit si bien le cardinal Belfigo, il vaut mieux un petit chez les Huns qu'un grand chez les autres...
Un réchaud deux feux à essence Coleman, 12 dollars. Là, j'ai peur qu'on n'ait pas fait une affaire : le père Coleman, ça fait deux fois que je le démonte pièce à pièce en jurant mes nom de dieu, et il ne nous a pas encore réchauffé la première boîte de conserves.
C'est ici, à Temple Bar, Arizona, qu'a commencé notre expérience de campeurs. La première nuit a été horrible. Le sol était trop dur pour planter les pieux de la tente. Le père Coleman n'a pas voulu chauffer quoi que ce soit. Bref, on a trépigné, hurlé, on s'est acharné sur les pieux de tente, on a crié fichtre et foutre, on a masturbé à deux mains la pompe du père Coleman, puis on a mangé froid, et on a couché à l'arrière de la grosse Gégène, y'a de la place. La Grosse Gégène est toujours là quand le logement va mal.
Bref, je reprends mon flash-back... On a donc avionné en direction du sud, en prenant tout juste soin d'avoir le pied assez léger pour ne pas ouvrir le second corps du carbu de la Grosse Gégène. because ça fait monter sa consommation jusqu'à des hauteurs difficilement concevables par un cerveau de motard.
On a donc fait les mille et quelques kilomètres de Portland à San Francisco d'un souffle, là, j'ai découvert une chose : la voiture américaine, c'est la voiture par excellence, l'antimoto absolue. De la place à ne pas y croire, à trois sur le siège avant, on peut gesticuler sans se flanquer mutuellement le coude dans l'oeil.
Le siège arrière sert de dortoir. Derrière, c'est la soute à bagages. Du confort à l'américaine : dans une bagnole de chez nous, on est assis comme sur une chaise de cuisine : dos droit, genoux à 90 degrés.
Dans une bagnole américaine, on se répand, on se fait tout mou. On ne roule pas assis, mais effondré, les mains tenant le volant a 10 heures 10, c'est bon pour les névropathes qui roulent dans des défouloirs à roulettes avec des suspensions dures, des sièges durs, mains crispées sur le volant et regard fixé sur la ligne bleue des Vosges.
Ici c'est une toute autre affaire. A 70 miles sur la freeway (n'allez pas croire qu'en Amérique on respecte les limitations plus qu'ailleurs), la main gauche tient vaguement le volant, coude appuyé sur la cuisse pour économiser l'énergie, la droite caresse langoureusement la fesse de la voisine ou du voisin, cela pour les women drivers ou les minorités sexuelles, le pied droit maintient vaguement le champignon à l/8e des gaz, le gauche gît quelque part sous le siège ou n'importe où, si l'on a le cruise control (champignon automatique monitoré par le compteur de vitesses), on laisse traîner ses jambes absolument n'importe où pourvu que ce soit confortable.
L'oeil doit être mou. dans ce pays où l'on commence à conduire à 15 ans une voiture, on sait conduire en somnolant. Pas de réflexe de femme saoule, pas de panique, pas de changement de file sans prévenir, ici, parce que l'on apprend à conduire comme on apprend à marcher, on conduit par réflexe et sans agressivité.
Voila, je vis l'Amérique, je vis l'Automobile dans toute sa splendeur, comme elle ne sera jamais plus. Les caisses de deux tonnes avec des moteurs tout en fonte de 7 litres de cylindrée qui vous fait péniblement 11 miles par gallon d'essence, (21 litres aux 100) même ici, c'est déjà du passé.
La grosse Gégène est une sorte de dinosaure. Relief d'une époque déjà révolue. Je me marre, je revis la préhistoire. Quand je reviendrai en France, si je reviens en France, pour le contraste je m'achèterai un engin plus dur que jamais. Une Norton avec un moteur Combat si j'en trouve, ou sinon, une 1000 Yam V twin, bref une moto moto, bien démente, bien irrationnelle, et qui coûte dix fois le prix de la grosse Gégène. Je veux redevenir idiot et irrationnel.
Jai peur les mecs... Ici, je calcule tout. ' On me proposerait au choix une mobylette sans variateur et une Vincent HRD pour le même prix, je commencerais par penser « which one is the best value for money ? », laquelle est la plus rentable.
Je n'ai plus de coeur, plus de pulsions... Je veux redevenir idiot ! En écrivant ça, je me rends compte à quel point l'Amérique me change. Rigolo de faire un parallèle entre ma première moto à Paris porte de Clichy en mai 66 et ma première auto quinze ans après.
Le jour de ma première moto, je pensais acheter une BMW, une moto de curé, et ce fut une Aermacchi, une ballerine. Le jour de ma première auto, c'eût pu être une Cadillac, une Chrysler New-Yorker avec plus de cylindrée et dix fois plus de gadgets que la grosse Gégène, et me voilà t-y pas avec le plus pépère et le plus familial des dinosaures américains.
Tout simplement parce qu'on est en Amérique, qu'ici on est tough on money, qu'on n'achète pas sur un coup de tête. Ici l'on consomme beaucoup, c'est sûr, mais le consommateur est extrêmement soucieux d'en avoir pour son fric.
Une pratique courante dans ce pays, le « satisfait ou remboursé ». En France, quand on propose ce genre de garantie, c'est pour la pilule qui vous donne les muscles de Maciste en trois jours, et la société qui vous vend le miracle par correspondance est une boîte postale quelque part à Monaco, Valduz ou Kuala Lumpur.
Ici, ce sont des sociétés ayant, et pas qu'un peu, pignon sur rue, et vous rendront effectivement vos billes si vous n'êtes pas content. La Chrysler Corporation l'a fait il n'y a pas longtemps pour les voitures. Achetez une Chrysler neuve, si dans le mois qui suit vous décidez d'acheter un modèle équivalent d'une autre marque, on vous rend vos sous.
Franchement, vous imaginez ça chez nous ? Ici, le consommateur cherche la bonne affaire, et le marchand en tient compte. Si, au début de 81, vous achetez une moto ou une voiture neuve d'un modèle 80, on vous le soldera toujours. Ça fait drôle de voir un concessionnaire Rolls Royce proposer un rabais de 20 000 dollars (neuf briques) sur les modèles 80 qu'il lui reste en stock.
Le consommateur est dur ici. Il faut faire avec. Si vous aviez acheté avant février une Harley de haut de gamme n'importe où aux Etats Unis, vous auriez eu droit a 800 dollars d'accessoires gratuits.
Harley devait avoir besoin d'argent frais cet hiver. J'espère que c'est pas pour sortir un nouveau modèle ait encore l'air d'une antiquité remise au goût du jour. Je suis devenu un consommateur américain. Méfiant, lorgneur d'étiquettes, avide de specials, soucieux de saisir la meilleure marchandise pour chacun de ses Dollars.
Vivant ici, j'ai la sourde impression qu'en France on vend n'importe quoi très cher avec une garantie bien souvent en bois, et que si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. La France n'a pas encore bien réalisé que la monarchie et la féodalité sont révolues depuis 1789, que le vendeur est redevable de l'acheteur, que le système politique « votez pourrions, nous ferons le reste » est un peu périmé.
L'Etat d'Oregon, lors des élections présidentielles de novembre dernier, a mis un sacré coup de freins à l'installation de centrales nucléaires sur sa terre. Il a refusé l'augmentation des taxes sur l'essence. A refusé l'interdiction de piéger les animaux sauvages. Il n'avait pas seulement à élire telle ou telle tête de clown à la tête du continent, mais aussi à décider d'une quarantaine de mesures aussi bien à l'échelon de l'Amérique entière que de celui de l'état d'Oregon ou du canton.
Oh, bien sûr, l'Amérique c'est pas le Pérou, comme on dit. Seulement, quand j'y pense, je trouve excessivement lamentable que longtemps après 1789 et peu de temps après 1968, on ait élu un mec qu'on appelle Giscard de mes Choses...
Le soleil s'est couché sur le lac Mead. Un gag, ce lac. Un truc artificiel né de la construction d'un barrage à 30 miles d'ici il y a une cinquantaine d'années en plein désert. Eh bien croyez moi si vous le voulez, mais même après 50 ans, la nature, autour a l'air de faire comme s'il n'était pas là.
Pas de verdure autour du lac Mead. Une gigantesque mare d'eau au milieu du désert. Pour vous donner une idée, à part la petite convenience store du terrain de camping, où l'on ne vend absoument rien de ce qui puisse ressembler de près ou de loin à quelque chose de frais, la plus proche épicerie est à Las Vegas, Nevada, à 100 bornes d'ici.
C'est immense, immense l'Amérique. Mimi la Crêpe qui a des tendances écologiques en crève d'avoir à bouffer ce que l'Amérique fait de plus dégueulasse en matière de boîtes de singe, mais on ne peut tout de même pas se taper 200 bornes de route, donc 40 litres d'essence, pour aller chercher de la salade fraîche...
Faut dire que pour des campeurs américains, on est équipé franchement minable : quand d'aventure on jette un oeil sur nos voisins, on se sent franchement romanos. Les voisins ont un motorhome (camion-caravane) de 32 pieds (10 mètres), air conditionné, télé en couleurs, chaîne hi-fi et tout le toutim, et dans leur congélateur, vous savez ce qu'il y a entre autres ? Un aurignal entier. Ça c'est du campinge, les mecs.
La plupart de nos voisins sont des retraités qui passent leur temps à parcourir le pays avec leur motorhome, histoire de toujours se trouver là où c'est beau et où le soleil brille. Façon sympa de passer sa retraite, pas plus chère et bien plus excitante que la villa Sam Suffit, pas vrai ? Ben non, pas plus chère, un motorhome comme celui des voisins, ça vaut dix ou douze briques, et des parcs pour garer le machin, il y en a partout en Amérique, d'Alaska jusqu'en Floride. Merde y'a pas, ça a des côtés sympa l'Amérique...
Daytona Beach, 5 mars 81
Alors là, les mecs, quand je vais vous dire où je suis, vous allez crever de rire la bouche ouverte. Je suis à Daytona Beach. Floride, pas vraiment surprenant pour un motard, même en bagnole, qui navigue dans cette région de l'Amérique, mais ce soir je ne suis ni au bord de la piste, ni au terrain de camping mais dans un grand hôtel d'un genre un peu particulier.
Ma chambre, qui mesure 2 m 80 sur 1 m 80, a de jolis murs peints en vert, très jolis et très solides. La fenêtre fait 1 m 60 de large sur seulement 10 cm de hauteur. Drôle d'architecture, hein ? La porte est en acier double épaisseur, avec deux meurtrières de 30 x 10 cm et ne s'ouvre que de l'extérieur.
Mince d'hôtel, pas vrai ? Dernière chose, l'hôtel qui ne fait que la pension complète, est gratuit. Bon à savoir... Quoi ? Un hôtel gratuit à Daytona Beach ? Vite, Le nom !!!
Attendez, il est écrit de l'autre côté de la feuille sur laquelle j'écris... « Volusia County Correctional Facility » Eh oui ! Je suis en taule a Daytona, n° 112664, cellule JL6, je suis en train de découvrir un nouvel aspect de l'Amérique.
Il est des Etats ou des comtés, ici, où il est redoutablement facile de se retrouver en cabane. Le comté de Volusia, où se trouve Daytona, a quelque peu l'air d'en faire partie.
Que je vous fasse un peu l'historique de la chose. Nous étions donc depuis trois jours à Daytona, Petit Prince, Mimi la Crêpe, la grosse Gégène et moi. On avait planté notre tente de Huns dans le Daytona Beach Camp-ground, à 4 miles du circuit. Dix Dollars la journée de camping, vingt dieux, pas le cadeau.
La Floride, quoi ! Quoi qu'il en soit, lundi, je me suis mis en quête de mes collègues motojournaleux qui devaient logiquement se trouver quelque part autour de Daytona. Par l'intermédiaire d'un transfuge du FBI, j'ai fini par les situer dans un hôtel à 12 miles au nord.
J'y suis allé séance tenante et y suis arrivé à 4 heures et demie de l'après-midi. Les collègues n'étaient pas encore là, mais par contre le diable y était. 16 heures 30 au bar de l'hôtel en question, c'était le début de la « happy hour ». La happy hour, l'heure heureuse, est une tradition dans pas mal de bistrots à travers l'Amérique.
Pendant les heures creuses, vous avez deux pots pour le prix d'un ; attention, pas question d'en avoir un à demi-tarif, vous en achetez un et on vous en sert deux, nuance ! Seulement, à ce bar là, la « happy hour » ne s'appliquait pas à la bière, qui dans ce pays est ma boisson favorite.
Alors je me suis mis au Martini. Ici, un Martini, c'est du gin avec un peu de Martini dedans. Bref, quand les motojournaleux sont arrivés deux heures après, j'étais pas mal gai. On est allé bouffer ensemble, et quand on s'est quitté, je l'étais encore plus.
Je retournais au camping au volant de la grosse Gégène quand les flics me sont tombés dessus. Une heure après j'étais avec quelques compagnons dans une cellule au poste de police de South Daytona.
Passage à la machine électronique à détecter les poivrots, photo, empreintes digitales et tout, a une heure du matin on transférait la viande saoule à la prison du comté de Volusia, et c'est ainsi que j'ai passé ma première nuit dans une prison américaine.
Oh, ce n'était pas l'horreur, c'était plutôt folklorique, on rigolait bien, (j'ai réussi à leur piquer une des photos d'identité qu'on m'a faites au poste).
Ça s'est juste un peu gâté quand on n'a pas voulu me donner mes clopes et mes allumettes. En guise de protestation, j'ai passé le reste de la nuit à foutre des coups de lattes dans la porte de ma cellule en chantant des chansons communistes.
C'est que j'en connais des wagons avec toutes les paroles, l'Internationale, Hardi camarades, le Chant des survivants, Il est mort l'ami Lénine, le Chant des Martyrs, l'Armée de l'Ebre, El Commandante... Ils ont été servis.
Chaque fois qu'un gardien venait m'engueuler, je réclamais mes clopes et mes alloufes. On m'a changé de cellule, menacé de la camisole de force, mais on ne m'a pas rendu mes clopes.
Le lendemain matin, je suis passé en jugement, ou plutôt en première audience. Je n'aime pas les juges, professionnels ou amateurs. J'ai donc été très peu coopératif.
En plus, je n'aime pas le système judiciaire américain. Voilà comment ça se passe : un juge examine votre cas et vous fixe un « bail bond ». C'est une caution. Si vous déposez l'argent demandé, on vous libère, et vous êtes jugé plus tard en présence de votre avocat.
Sinon, vous restez en taule jusqu'à votre jugement. En un mot, si vous avez du fric tout va bien, pas de fric c'est pas bien.
Je me suis donc retrouvé devant Monsieur le juge. L'était pas antipathique, le mec, mais une chose m'a fait bondir : il a fixé ma caution à $250. Or, il figurait dans mon dossier que j'avais 260 et quelques Dollars lorsque j'ai été mis au trou.
Vous savez ce qui m'est alors venu à l'esprit ? Un épisode des aventures de Lucky Luke qui s'appelle précisément « le juge ». Lucky Luke est arrêté pour je ne sais plus quoi, et le juge Roy Bean lui demande : « combien d'argent avez-vous sur vous ? ». Lucky Luke répond : « vingt Dollars environ » ; le juge alors décrète « vingt Dollars environ d'amende !!»
Bref, j'ai refusé de raquer la caution, refusé de promettre de venir à mon procès à moins qu'il ne soit programmé dans les deux semaines à venir, on m'a donc immédiatement condamné à $250 d'amende ou 25 jours de prison. J'ai choisi...
Ben, vous savez, ici, la bouffe est bonne pour l'Amérique, les cellules sont confortables, y'a une bibliothèque, une salle de billard, une de musculation où l'on a accès trois fois dans la journée, un téléphone longue distance P.C.V. que l'on peut utiliser jusqu'à 11 heures du soir, par contre le téléphone local est dans la cour, donc on peut s'en servir moins souvent et il y a toujours la queue.
Ah oui, aussi, les seules tables commodes pour écrire sont dans la bibliothèque, pas pratique pour moi. On ne peut y aller qu'aux heures de repas ou pendant l'heure de récréation. A part ça, elle est super coquette, la prison de sud-Daytona.
Une salle à manger qui ressemble à un restaurant de gare moderne, une gentille petite cour ensoleillée, des cellules coquettes. Toute la journée, on a accès à une salle commune avec une télévision, mais j'aime mieux ma petite cellule ou je peux bouquiner ou écrire en paix. La paix... Les gardiens sont a 50 % aimables, 50 % pas aimables, mais ça ne va pas plus loin.
Alors 25 jours ici, pourquoi pas ? A moins que Mimi la Crêpe flippe trop d'avoir à s'occuper seule de Petit Prince. Elle va probablement récupérer la grosse Gégène à la fourrière et emmener Petit Prince se baigner dans le golfe du Mexique, et moi je resterai tranquillement derrière les barreaux.
Sinon, on verra. De toutes façons, mon amende se réduit de $12 par jour de détention. Le temps, pour une fois, joue en ma faveur. Cela dit, dorénavant, en matière de courses moto, il faudra que je me méfie des grands classiques. Il y en a deux qu'à ce jour je n'aurai jamais vus : Daytona et le Tourist Trophy. Daytona, je ne la verrai pas puisque les 200 miles, c'est après demain, et que j'ai encore 22 jours de taule à tirer.
Le TT, l'année où j'ai voulu y aller, ça n'a pas marché, devinez pourquoi ? J'étais en taule à Southampton pour entrée illégale en Grande Bretagne...
Je m'installe doucement dans ma petite vie de prisonnier. La vie est plutôt douce dans la prison de sud-Daytona. Faut dire que ça n'est pas Alcatraz. D'abord Alcatraz est fermée depuis longtemps, ensuite, à sud-Daytona, on ne garde ni des assassins de haut lignage, ni des gangsters prestigieux.
Ici, c'est du petit gibier, des cas peu intéressants avec même pas de sang sur les mains. Conduite en état d'ivresse, ivresse publique, détention de tabac qui rend fou et autres « second degree misdemeanors », infractions de midinettes.
Sûr que quand on a été transféré de Deland, où se font les first appearances, à la prison de Daytona, on a eu droit aux menottes au poignet et à la cheville, attachés tous ensemble comme une grappe de raisin, comme dans les films, mais à part les paranoïaques et autres neurasthéniques, ça rigolait chez les forçats.
Maintenant j'ai un chouette uniforme vert parfaitement à ma taille, ma petite cellule JL6 dans l'aile Est, et je vis mon petit train-train. Petit déjeuner à 5 heures 30, retour à ma cellule, ouverture des portes des cellules à 9 heures, s'il y a l'un des fauteuils en rotin de la salle de séjour disponible, j'y vais bouquiner.
Sinon, je lis dans ma cellule. L'éclairage y est moins bon, mais par contre, je ne suis pas dérangé par la télé qui braille. La télé américaine est très chiante, car il est difficile de ne pas l'entendre.
Chez nous, la télé, c'est un ronron continu. Quand une émission commence, on n'a qu'à regarder la première minute pour savoir de quoi il s'agit. Si c'est un ouèsterne on sait qu'on va entendre des cris, des galopades et des coups de revolver, si ce sont les actualités on sait qu'on entendra le premier de la classe grmgrembler son laïus sur un ton consterné, si c'est un discours de Giscard, c'est le bruit d'un veau satisfait en train de mâchonner la mamelle de la France.
Les vannes intérieures du cerveau se ferment a ces bruits à venir, et aussi fort que le son soit mis, on n'entend plus rien jusqu'à la fin de l'émission. Au début de la suivante, il n'y a qu'à faire une nouvelle programmation réjectionnelle pour avoir une paix royale.
Avec cette putain de télé américaine, c'est beaucoup plus difficile, à cause des publicités. D'une part, bien sûr, elles sont conçues pour attirer l'attention. D'autre part et surtout, elles déteignent sur le ton général de l'émission, c'est comme si au milieu d'un discours de Giscard on mettait soudain une galopade et des coups de pistolet : ça réveillerait tous les téléspectateurs en sursaut : c'est à cause de ça que je préfère la télé française à l'américaine, et ma cellule à la salle commune.
Vers midi et demi, c'est le déjeuner. Une viande hachée ou du poisson avec deux légumes et du gâteau, avant de retourner dans nos appartements, on a le temps de passer un coup de grelot ou de prendre le soleil dans la cour, ou encore de se faire un petit billard ou aller prendre des bouquins à la bibliothèque.
Ensuite retour en cellule ou salle de séjour, puis on sort pour la récréation de 15 heures. Les paresseux flemmardent ou bouquinent au soleil, les billardeux billardent, les musculeux se musclent sur une énorme machine truffée de poids en fonte et hérissée de guidons de motocross, les consommeux se gavent de Pepsi Cola qui sortent des machines en bidons d'alu.
J'en ai récupéré un pour me faire une lame pour... tailler mes crayons. Ici, les stylos sont interdits, il faut écrire au crayon, et j'ai beau en avoir quatre, je suis souvent à cours de mine. Or, le seul taille-crayon est dans le bureau d'un gardien à l'entrée de la cour. Je ne peux donc y aller qu'aux heures de repas ou de récréation.
Dans le plus pur style Comte de Monte Cristo, j'ai donc fait un couteau avec l'alu d'un bidon de Pepsi-Cola, arme redoutable que je dissimule fourbement dans un paquet de tabac à rouler « Bugler ». C'est totalement débile parce que mon taille-crayon Pepsi est d'une inefficacité navrante. Je passe plus de temps à l'affûter sur le sol en ciment de ma cellule qu'il ne m'en faudrait pour affûter mes crayons par érosion naturelle en soufflant dessus, mais que c'est romanesque ! Cela dit, j'espère que les gardiens ne fouillent pas trop bien les cellules, s'ils trouvaient ça, ils seraient fichus de se faire un cinéma pas possible. Y'a pas, on vit intensément...
Merde ! J'ai été dégradé ! Je suis entré dans la prison de Daytona en « close custody » (haute surveillance). Hier soir, tout le monde a eu une entrevue avec un sikologue, et j'ai été dégradé en « médium custody » et transféré dans un autre secteur de la prison.
C'est la déchéance. Fini la belle cellule avec des murs épais comme ça et une porte de coffre-fort, maintenant, je suis dans une chambre a six lits, avec accès à une salle commune où se trouve une télé couleur que l'on peut (hélàs) regarder toute la nuit.
Le bâtiment est au milieu d'un terrain de sport auquel on a accès de 5 heures du matin à 11 heures du soir. Bien sûr, on est entouré de grillages de 3 mètres barbelés en haut, mais avec toutes ces portes ouvertes, on ne se sent plus en prison.
Plus de solitude du prisonnier dans cet immeuble ouvert à tout vent. Neuf chambres -difficile de les appeler des cellules- dans le bâtiment, ça fait neuf télés qui braillent toute la journée sur des chaînes différentes, c'est l'horreur !
Accès a la bibliothèque de 6 à 23 heures, idem pour le terrain de sport, c'est frustrant ! En ce moment, il est neuf heures du matin, je suis en train de scri-bouiller sur le bureau des gardiens, assis sur une chaise, juste en face du taille-crayon à manivelle. J'affûte mon crayon à satiété, ça me permet d'écrire plus petit et plus lisible.
Mais merde, ça n'est plus la prison ! En plus, il va falloir que je travaille, on m'a donné le choix entre le jardinage/ramassage des poubelles et la cuisine, j'ai choisi de travailler dehors, on m'a mis sur le camion n° 2, c'est-à-dire qu'on va se balader en ville pour ramasser deux ou trois poubelles ou tondre des gazons. Facile de s'évader dans ces conditions. Bref, c'est plus vraiment la prison. Tiens, je vais affûter tous mes crayons d'avance et aller écrire dehors. Il y aura moins de bruit...
Holà, c'est chouette ici. S'il n'y avait pas des grillages et des barbelés tout autour, on se croirait dans un camp de vacances. Dommage que le ciel soit couvert. J'écris maintenant sur une espèce de table de jardin en vrai faux marbre style café de la Côte d'Azur en 1900. Attendez, on m'appelle. C'est l'heure des visites, ça doit être Mimi la Crêpe qui vient voir le détenu, on va faire quelque chose de parfaitement contraire au règlement de la prison. A tout à l'heure...
Gnyark gnyark ! On vit intensément ! Pendant la visite, j'ai filé à Mimi-la-Crêpe les six pages de copie que j'ai écrites depuis ma mise en cabane. Tout à fait interdit.
Toute correspondance doit être inspectée par la censure de la prison, les lettres ne doivent pas faire plus de deux pages et tout le tremblement. Bref, il fallait bien passer outre, puisque je voulais profiter de la présence des motojournaleux à Daytona pour qu'ils emmènent ma copie toute fraîche.
On a fait le passage du message pendant la visite. Faut dire que la visite ici, c'est plutôt bon enfant. Ça se passe dans la salle à manger, on fait entrer prisonniers et visiteurs en vrac, et la salle prend des allures de dernier salon où l'on cause, avec quelques gardiens qui assistent benoîtement au truc, adossés au mur.
Y'a bien aussi des caméras de surveillance, mais, si vous pensez que la gardienne qui regarde en tricotant les six écrans de télé qui surveillent les points vitaux de la prison peut noter sur l'un des écrans que l'une des cent personnes dans une salle pose une enveloppe sur la table et que c'en est une autre qui l'emporte, vous avez gagné un stage de six mois à l'IDHEC...
Pensez donc que les salades que vous lisez écrites par le détenu 112664, sont passées à travers le filet de la censure du système pénitentiaire du comté de Volusia, Floride, USA. C'est-y pas du scoop, ça ?
Cela dit, Mimi la Crêpe n'apportait pas de bonnes nouvelles. Les flics ne veulent pas lui donner la grosse Gégène, elle se retrouve du coup toute seule avec Petit Prince dans un terrain de camping pas terrible qui coûte $10 par jour, sans moyen de transport. De plus, le stockage en fourrière de la grosse Gégène revient a $4 par jour. Cette histoire risque de revenir plus cher que mes $250 d'amende, qui ne sont plus que de $202, puisque ça fait quatre jours que je suis en taule. Bah... On verra ça demain.
Je commence à m'habituer à ma nouvelle résidence. Y'a pas, elle ressemble plus à une caserne qu'à une prison. Les gardiens sont sympas, ceux qui sont là aujourd'hui passent presque autant de temps à jouer au billard ou au baby foot avec les détenus qu'à gardienner proprement dit. S'il n'y avait pas les neuf télés allumées en permanence qui me scient les oreilles, ça serait un chouette camp de vacances...
Daytona, lundi
Aujourd'hui, c'était mon premier jour de travaux forcés. Ben oui, ici, on essaie de rentabiliser les prisonniers, remarquez, on est payé : un Franc de l'heure, dont 25 % utilisables à la prison même pour cigarettes ou autres, le reste à la sortie.
Les veilles de jour de travail, les télévisions sont coupées à 11 heures. Remarquez, ça m'arrange bien, d'entendre ces machines-là brailler à peu près toute la nuit, c'est assez éprouvant. Hier soir par contre, ça m'ennuyait un peu à cause des informations de 11 heures, où j'espérais voir quelque chose sur Daytona, la course, je veux dire.
J'avais sottement espéré que ça soit transmis en direct, mais là, fallait pas rêver. L'organisation ne tolérerait pas que l'on transmette la course en direct dans la région, ça ferait perdre des spectateurs. Peut-être que si j'avais été en taule en Californie, j'aurais vu Daytona en direct, je ferai mieux la prochaine fois... Enfin... Au moment où le gardien a coupé les télés, j'ai entendu une voix caverneuse crier d'une cellule voisine : « ne coupez pas !Je veux voir les courses de motos !
-Y'en a d'autres qui veulent les voir ? » a demandé le gardien à la cantonnade.
Ben ça m'a étonné, mais d'un peu toutes les cellules, des « ouais » ont retenti. Du coup, le gardien a remis les télés, et dans un flash d'une minute, j'ai tout de même vu Sarron tomber, Fontan louper son stand et trois bricoles. Vous en verrez sans doute plus en France.
J" ai donc commencé les travaux forcés : ' on se balade sur les routes avec un camion, et l'on joue les cantonniers. On désherbe, on nettoie.
Oh, c'est pas l'horreur du tout, le camion est plein de café, de bouffe, de bouquins cochons, de tabac et de papier à rouler, et entre les pauses-café, le repas de midi et les snacks, si l'on bosse trois heures par jour, c'est bien le maximum.
On voudrait s'évader, ça serait du billard, on est huit par camion, on travaille sur des routes de campagne avec des forêts tout autour, et notre gardien, Fields, n'est même pas armé.
Les prisons, par ici, ne sont plus ce qu'elles étaient. Notre gardien de travaux forcés ressemble très fort à un cow boy de cinéma : avec son mètre quatre-vingt-cinq sans graisse, ses bottes, sa mâchoire carrée et son uniforme gris avec étoile style shériff sur la poitrine, y'a pas, il cote.
Côté tempérament, il me fait penser à ces vers de Brassens : « Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins ». On s'entend très bien avec lui, il nous fout une paix royale tant qu'on arrive à faire le peu de boulot qui nous est attribué. Bonne ambiance dans l'équipe du camion n° 2.
Evidemment, entre convicts, la première question que l'on pose à un collègue est « pour quoi t'as plongé ? »
Y'a un peu de tout dans l'équipe. Pas mal de DWI comme moi (conduite après dose illégale de Beaujolais villages ou équivalent), petits vols (le plus doué a détourné $80 000 et s'en sort avec un mois), excès de vitesse...
La plus belle condamnation est celle de Jim. Au début je ne l'ai pas cru quand il m'a raconté qu'il était allé picoler une nuit au Boot Hill Saloon dans Main Street avec sa copine, que la boisson leur a excité les sens, et que du coup ils sont allés dans le cimetière en face où sa copine religieusement à genoux s'est mise à jouer miserere my Savior sur la flûte enchantée de Jim, si vous voyez ce que je veux dire.
Les flics, nombreux pendant la semaine de la moto, les ont vus, et vlan ! Enchristés, et comme Jim n'avait pas de quoi payer la caution pour être en liberté provisoire...
J'me suis dit que c'est pas Dieu possible de se retrouver en cabane pour pareille gâterie, peut-être que Jim affabulait, et ayant vu que Fields notre gardien avait avec lui le dossier de chacun d'entre nous histoire de savoir quoi redouter de qui, je lui ai demandé de me montrer le dossier de Jim. Eh bien en face de « motif de l'emprisonnement », il y a « lewd + lascivious behaviour ». Comportement malsain et lascif. C'est donc vrai, on croit rêver...
Ici, je suis là pour m'en rendre compte, on met très facilement les gens en prison. Si vous faites du stop a Daytona, c'est interdit, donc, on vous colle une amende. Or si vous faites du stop, c'est que vous n'avez pas d'argent, donc en taule !
Il est de même interdit à Daytona de se trouver dans la rue ou tout lieu public avec une bouteille d'alcool ouverte. Là encore, amende ou taule. J'ai entendu ce matin à la radio que des gens, du côté de Daytona Beach, avaient été mis au trou parce qu'ils faisaient du jogging torse nu.
Bref, Daytona, c'est pas le paradis. En ce moment, où il y a beaucoup de tourisme, les prisons du comté de Volusia sont bourrées a craquer. Sur le terrain de foot, on a dû installer des tentes militaires pour loger l'excédent de taulards.
Etats-Unis d'Amérique. Pays de la liberté... Pas toujours et pas partout.
Attention, il ne faut pas faire du comté de Volusia et de Daytona Beach en particulier un reflet de l'Amérique toute entière. Ici, les Etats, les comtés, les villes même, ont une très grande liberté dès qu'il s'agit de règlements, si bien que ce qui est permis ou toléré ici peut très bien être sévèrement interdit 20 miles plus loin.
De toute évidence, le comté de Volusia, Daytona en particulier, est un coin à éviter soigneusement si l'on aime la vie olé olé. Il était d'ailleurs question que les motards boycottent Daytona cette année, à cause justement du côté facho du comté. En fait, ils étaient moins nombreux cette année. Motards et flics, ce n'est pas le même combat...
En attendant, je vis ma petite vie de prisonnier. Evidemment, cette prison bourrée de télés en couleurs ce n'est pas du tout l'idée que je me faisais de la geôle. Que j'essaie un peu de vous décrire l'endroit où je suis en ce moment. C'est un petit immeuble carré de plain-pied.
Au milieu, il y a un hall avec au centre le bureau des gardiens. C'est là que j'écris entre la rangée impressionnante des commutateurs électriques et l'indispensable taille-crayon.
Derrière mon dos, la porte du bâtiment. Ouverte de 6 heures du matin à 11 heures du soir, elle donne dans le terrain de sports. En entrant, on trouve d'abord à gauche le billard et à droite le baby-foot, à cette heure-ci (il doit être dans les 10 heures, tiens 10 heures 11 du soir à la montre du gardien Villafane) la bataille fait rage.
Ensuite donc le bureau des gardiens et une table à tout faire, où en ce moment on joue aux cartes. Tiens, v'ià un mec qui vient de prendre du savon dans les tiroirs des gardiens. Ici, c'est très self-service.
Quand on a besoin de quelque chose, pécul, savon, allumettes ou autres, on ne demande pas, on se sert, on est en famille. Disposées en U, sur les trois côtés qui me font face, les neuf cellules communes, chacune a sa machine à eau chaude pour faire du thé ou du café, et sa télé Zénith en couleurs.
Elles sont toutes allumées jusqu'à 11 heures, plus tard le week-end. Elles n'ont de murs que sur trois côtés. La cloison qui fait face à l'intérieur du bâtiment est seulement grillagée. Les portes des cellules sont aussi ouvertes de 6 heures du matin 11 heures du soir.
Une vraie auberge espagnole, le truc. Une grande salle de bains pour chaque groupe de cellules, c'est là que se trouvent les téléphones. Accessibles 24 heures sur 24. Le rire, pas vrai ?
Bon, remarquez, ici, c'est l'aile ouest, la plus cool, celle des gens considérés comme pas dangereux. Celle des mauvais garçons est l'aile nord. Vraies cellules avec des portes de coffre-fort toujours fermées, sortie une heure par jour et c'est tout.
C'est le cabinet noir de la prison de Daytona. Tiens, la preuve, ce matin, on a coupé les télés pendant cinq minutes pour nous lire un message du grand chef qui disait qu'il y avait des détenus du bloc G (le mien) qui mettaient des billets doux dans leur sac à linge à laver, à l'intention des prisonnières qui travaillent à la blanchisserie.
Ça flanque la panique parce que les nanas ouvrent les sacs (individuels), les referment mal, et après, tout se retrouve mélangé. Avis : celui qui se fera piquer à mettre des billets doux dans son sac à blanchisserie sera envoyé « environ une semaine » dans l'aile nord. Y'a pas, être en taule ici, c'est pas vraiment traumatisant. Heureusement d'ailleurs, puis qu'on s'y retrouve si facilement. L'un compense l'autre...
Daytona, jeudi
La vie va son train train pour le détenu 112... Ça y est, j'ai encore oublié mon numéro de détenu, pour le retrouver, il faudrait que j'aille fouiller dans mon coffre à fringues près de mon lit, ça fait rien on est entre amis, z'avez qu'a m'appeler 112 tout court.
Bref, 112 se porte bien. Il vit chaque jour la même journée, petit déjeuner à cinq heures et demie, retour au lit, départ au boulot à sept heures et demie sur le camion n° 2, désherbage, nettoyage des routes du comté de Volusia entre les pauses bouffe-café, retour a la prison à 14 heures, fouille complète jusqu'à la « rue du quai » incluse pour vérifier que je n'ai pas profité du travail à l'extérieur pour ramener un Colt M 16 en vue de détourner la prison sur Cuba, temps libre, dîner à 5 heures et demie, fin de la journée.
Une vie bien plus confortable et peinarde que celle que j'ai eue ces trois dernières années depuis le jour, en juin 1978, je crois, ou j'ai enfourché ma 80 Yam pour essayer d'aller voir si c'est vrai qu'à l'autre bout du monde, les gens se promènent avec la tête en bas.
Drôle de vie, les mecs... Au fil du hasard, la 80 Yam est devenu une 6700 Ford, le promeneur solitaire a eu un enfant à Kathmandu, puis une femme à Portland, il a été garçon de restau, prof de langues, balayeur, emballeur de vieux caoutchouc, plongeur, traducteur, et le voilà taulard à Daytona... Les vacances... Pas de souci.
Un toit au-dessus de la tête, solide. Qu'il pleuve, qu'il vente, je serai sec. Un bon lit avec de vrais draps et une couverture par dessus. Je peux coucher a poil là-dedans. Dans la tente des huns, notre super guitoune à 35 dollars, dès que ça se met a flotter sérieux, on est noyé tel le rat, et mort de mes osses, il y a des nuits où l'on a roupillé tout fringue dans le duvet.
Ici, la nuit, c'est toujours chaud et jamais mouillé. Les repas se font tout seuls. Ici, je n'ai pas besoin d'argent, si j'ai mal aux dents, le gardien me donnera de FAmbasol, mal au crâne il me donnera de l'aspirine, mal ailleurs, le toubib passera ce soir. Ici, rien de mal ne peut m'arriver.
Demain se passera comme se sont passé hier et aujourd'hui. Tant que je serai là, je serai protégé de toute agression extérieure. Le toit est solide, les murs sont épais, s'il pleut cette nuit, je ne le saurai que demain matin en voyant la terre mouillée. Sur le moment, je ne l'entendrai même pas. Ici, c'est la sécurité et la paix.
C'est peut-être pour ça que je m'emmerde...
Daytona, dimanche
Je m'emmerde... Pas tout le temps, oh non, mais par moments, et très fort. Je m'emmerde parce que tous les jours sont pareils et qu'on est une cinquantaine à vivre dans une cage à poules, et qu'il n'y a pas un fichu moment pour se trouver en paix et en silence.
Neuf postes de télé, plus les transistors, le baby foot et cinquante voix humaines dans un quadrilatère aussi petit que l'aile ouest de la prison de sud-Day-tona, c'est désespérément trop.
Si l'on était en taule comme au bon vieux temps, brimés, frustrés, battus, perclus, on ferait bloc en silence et l'on aurait au moins une haine à partager. Mais tu parles, Qui haïr ici ? C'est la prison famille...
Quand je suis arrivé ici, l'une de mes premières idées a été de faucher quelque chose de folklo pour l'offrir à Petit Prince. La sélection a été vite faite : l'étoile de shériff avec « Volusia County department of Corrections » que les gardiens portent sur leur chemise toujours, sur leur veste souvent.
Leur veste, ils la laissent toujours posée sur leur chaise quand ils vont faire un tour. Seulement, à qui vais-je piquer son étoile de shériff ? A « M, D » (on l'appelle comme ça parce qu'il a un nom italien imprononçable en anglais) qui a rédigé et fait parvenir pour moi sur le bureau de la trésorière de la prison une lettre à en-tête inscrit en rouge (les premières à être lues) demandant que mon fric soit d'urgence remis à Mimi la Crêpe et Petit Prince qui se morfondaient sur un terrain de camping de Daytona Beach ? A Villafane, qui a rallumé les télés parce qu'on voulait voir les courses de motos, qui me donne de l'Ambasol chaque fois que je remplis un sick slip pour avoir une consultation de dentiste aux frais du gouvernement américain ?
A Fields, qui va encaisser la consigne des bouteilles de soda qu'on ramasse en nettoyant les routes pour nous acheter du tabac et des bouquins cochons ? Je ne peux pas, c'est pas possible, Belzébuth aide-moi !!! Je veux retourner en enfer...
Mouaif... 112 s'emmerde, et pendant ce temps, Petit Prince et Mimi la Crêpe s'emmerdent aussi dans un terrain de camping près de la plage de Daytona. La plage la plus abomifreuse de la terre, les gars. Il faut l'avoir vue pour y croire. Les bagnoles y sont autorisées, en fait, des bagnoles, il n'y a que ça. Ce n'est pas une plage, c'est un parking à voitures. Effarant.
De voiture, par contre, Mimi la Crêpe n'en a pas, et pas de voiture, ici, je vous l'ai dit souvent, c'est vraiment le désastre. Pas vraiment le gag, cette situation. Moi, à part que je m'emmerde un peu, je n'ai pas à me plaindre. Au fond, c'est tout à fait comme si j'étais au service militaire. Vie communautaire et existence réglée par une autorité supérieure. C'est loin d'être le rêve de ma vie, mais ça n'est pas l'enfer. Non, c'est la zone parce que je ne suis pas tout seul, et que le fait que je sois au trou coince Petit Prince et Mimi la Crêpe dans ce putain de Daytona... Boah, je ne suis pas là pour vingt ans...
Avant de me faire coller au trou, j'aurais vu, de mon terrain de camping, les coulisses de la grande parade des choppers et autres, assisté à l'arrivée des motards venus de loin. Sûr qu'en faisant le tour du parking du circuit, on est impressionné d'y voir sur les motos des plaques d'immatriculation au goût étrange venu d'ailleurs.
Une plaque d'Oregon par exemple, en Floride, ça représente quelque cinq mille kilomètres parcourus pour venir, un peu comme si dans le parking du Grand Prix de France au Paul Ricard, on voyait des motos immatriculées à Abidjan ou la Mecque.
C'est que c'est grand,l'Amérique ! Seulement, vous vous en doutez, les jolies bêbêtes ne viennent à peu près jamais par la route, même celles qui pourraient le faire.
Les motos, ici, parcourent les longues distances sur une remorque, dans une camionnette, ou accrochées derrière un motorhome. Dans les terrains de camping, les parkings d'hôtels, c'est le festival de la remorque à motos.
De sous les bâches, on sort aussi bien de vieilles anglaises que des choppers ou des 1000 Honda équipées grand tourisme avec pare brise, sacoches en poly dans tous les coins et chaîne stéréo. On les astique, on les met en route, et il reste trois bornes à faire pour aller du terrain de camping en ville montrer comme on est beau. Eh oui, la moto, ici, n'est qu'un jouet, ou une façon de se donner un look. T'es autant motard ici avec une moto que t'es cow-boy parce que tu portes des bottes.
Un jouet coûteux. Les motos sont ici beaucoup moins chères qu'en France, mais les voitures le sont encore moins, surtout d'occasion. Pour le prix d'une malheureuse moto BMW, ici, on peut se payer une Lincoln MK5 « signature séries » de trois ans d'âge, avec un intérieur hyper luxe tout cuir et assez de gadgets électriques pour équiper un appartement de 9 pièces.
Pensez un peu que pour ce que j'ai payé la grosse Gégène, qui nous a tout de même fait traverser l'Amérique dans sa plus grande diagonale (nord-ouest/sud-est), j'aurais chez nous pu me payer une Mobylette neuve, une avec clignotants peut-être, et encore... Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 2200 balles ?
Y a pas, la moto, ici, c'est dix fois plus idiot qu'en France. Ici, la moto est un jouet d'enfant gâté, pas étonnant que, après la folie des années 70, le phénomène se tasse par ici. La moto, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est un joujou excitant, peut-être, mais qui ne peut pas servir en même temps de moyen de transport, le pays est trop grand et trop dispersé dans tous les sens.
Typique de voir un motorhome traînant une bagnole en remorque. Se passer de bagnole, suffit pas de vouloir, encore faudrait-il pouvoir : ici, ultra-rares sont les petites épiceries qui ont en stock quoi que ce soit de frais, viande, légumes, salade...
Ça, il faut aller le chercher dans les supermarchés, lesdits supermarchés pouvant être à 5 bornes, ou 10 ou 20, ou 100 comme c'était le cas quand on campait au lac Mead en Arizona.
L'Amérique, ce n'est pas le pays des courses au jour le jour, un petit steack dans le filet, une belle tranche de jambon de Bayonne, une demi-livre de haricots verts... Ah, non ! Si l'on veut jouer ce jeu là, il faut être prêt, en admettant que l'on vive dans une ville où ce soit faisable, a payer tout deux fois plus cher. Ici, on stocke. On achète en gros chez Fred Meyer, chez Sentry, chez Pantry Pride, chez Winn Dixie ou autres selon les endroits où l'on se trouve, et l'on revient avec cinquante kilos de trucs et de machins, poulet à 2,50 F la fivre, côtes de porc a cinq francs, fraises à cinq francs les trois paquets d'une pinte, ici, les prix varient avec le sens du vent.
Pas de garde fou. tout suit la loi de l'offre et de la demande. La récolte de fraises a été surabondante en Louisiane, si la demande ne suit pas. on achètera les fraises au prix de la merde.
On peut bouffer très bien pour pas cher ici, à condition de toujours suivre la bourse des biens bouffatoires dans le journal local, et d'acheter les bonnes choses au bon moment.
Hein ? Quoi ? Quel est le fils de sa mère qui a dit « c'est un détail » Hô, Ducon, c'est pas un détail, c'est l'image même de l'Amérique. « Keep moving », faut bouger. Ici, comme chez nous on achète les maisons avec un crédit de 15 à 20 ans, mais très rares sont ceux qui arrivent au terme de leur crédit sans avoir déjà revendu la maison, on vend la maison sur laquelle il reste 15 ans de crédit, on a même emprunté de l'argent sur ce qu'on avait déjà payé de crédit.
Si jamais on a mal calculé et que ça tourne mal, il n'y a qu'à s'en aller ailleurs. Le pays... que dis-je... le continent est si grand ! C'est fou l'Amérique.
Quand je sortirai de taule, j'aurai devant moi trois mois de retrait de permis. Je vous fiche mon billet que je le repasse dans un autre état, Alabama, Mississipi, ou ailleurs, et que l'on recommence à zéro.
Le travail, c'est pareil. On se fait virer ou l'on démisionne pour un oui pour un merde. Rien n'est permanent ni définitif ici, entre l'immatriculation des véhicules renouvelable tous les ans, les permis de conduire à renouveler tous les quatre, même les cartes d'identité ne durent pas plus longtemps, comme si l'on pouvait changer de nom, de père, de mère et de lieu de naissance en l'espace de 4 ans.
Fais gaffe, fils, petit fils ou beau fils de l'Amérique, tu n'es ce que tu es qu'à titre temporaire. La petite moto avec trois sacoches pour parer au plus urgent, c'est bon pour ceux qui savent que quoi qu'il arrive, il y a pas tellement loin un endroit où l'on est plus ou moins né, où peut-être grand-papa et arrière-grand papa sont nés, et que merde quoi qu'il arrive ce sera toujours un endroit où revenir. Ici, pas question. Tu n'es officiellement toi-même que pour quatre ans. Bouge, bouge, petit Américain, accumule ce que tu peux dans ta bagnole à six places, et fuis !
Sur le bureau des gardiens, gît un caïman en plastique véritable, couché sur le dos. Il a l'air si mort que c'en est pas possible. L'Amérique me fascine et m'horrifie, trop grand... Trop diversifié... Trop multicolore. Putain de pays ! Peut-être que dis ça parce que je suis en taule. On devrait aller au bouclard de temps en temps, ne serait-ce que pour avoir le temps de savoir où l'on est. Eh merde ! La semaine prochaine, je sors de taule...
Daytona, 25 mars
Demain matin, c'est fini. Demain matin, je vais rendre mon uniforme vert, mes chaussures de travail, mes draps et ma couverture, ma timbale en acier inoxydable, et je vais revenir à la vie civile. Ouais, je dis la vie civile, car j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir fait une période militaire ou je ne sais quoi que d'avoir été en taule.
Dans l'histoire, je n'aurai pas vu Daytona. La course s'entend, même pas à la télévision. La « course des courses » dans l'Empereur des pays, ballepeau. Je suis et reste un émasculé de la moto, un minable chronique. Je n'aime pas les grosses motos, quand je vais a Daytona c'est pour m'y faire flanquer en taule, y'a pas, j'ai pas la classe. Désastreux, le mec. Minable à un point qui confine à la provocation... Bof, prenons les choses comme elles sont. Demain, en route pour de nouvelles aventures...
Voilà une semaine que je suis de nouveau un citoyen libre. Libre, le matin, de n'ouvrir qu'un demi-œil ou même moins et de dire « bof, je me lèverai plus tard ». Libre d'aller faire un tour où je veux et quand je veux, libéré surtout de neuf postes de télé qui me cassaient les oreilles jusqu'à l'extinction des feux, ceci d'autant plus que la télé de Petit Prince est en panne.
C'est vrai, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, Petit Prince a une télé, une petite merveille made in Taïwan, cadeau de Mimi la Crêpe, de ces trucs qui, ici, coûtent trois cents balles au supermarché du coin. Manque de pot, pendant que j'étais en taule, il y a eu un gros orage sur Daytona Beach, la tente des Huns a été inondée, et la télé a du coup déclaré le black out général.
Comme par hasard, pendant que je me languissais dans la prison de sud-Daytona, j'avais tout le temps d'éplucher les journaux, et entre autres de repérer parmi les innombrables publicités une vente promotionnelle de mutimètres chez Radio Shack, dont un suberbe à $24,95. Alors, avant de quitter Daytona, je suis allé m'offrir le joujou à sonder les circuits électriques, et on va jouer les apprentis sorciers...
Blague à part, on a donc quitté Daytona sans l'ombre d'un regret, et nous voilà depuis six jours dans une île au sud de la Floride, Key Largo. Une île... Enfin... C'était une île dans le temps, mais l'Amérique étant ce qu'elle est, a profité du fait que la mer entre les îles est aussi profonde que la mare aux canards, pour les relier toutes par un enchaînement de ponts, dont le plus long fait tout de même onze kilomètres.
On a planté la tente des Huns dans le parc d'état John Pennekemp, à deux pas de la mer. C'est un camping à l'américaine, la nature, OK, mais pas la sauvagerie.
Des bébêtes sauvages, il y en a des foules dans ce parc, même, hélàs, de ces petites bestioles qui piquent. On prend le petit déjeuner avec les écureuils, on déjeune avec les canards sauvages, on dîne avec des cohortes d'oiseaux en tous genres, n'empêche qu'on a des salles de bains de luxe, l'eau, l'électricité et tout le toutim.
La nuit, le parc ferme, seuls les résidents, qui ont la clé de la barrière, ont encore accès ici. Les résidents, entre autres, c'est nous. La nuit, on reste seul avec les racoons. Ah les racoons... Il est temps de mettre un terme à une légende...
Le racoon... Chez nous, on l'appelle le raton laveur. Joli nom, plein de poésie, qui semble fait pour désigner le plus aimable des petits mammifères. O erreur ! Jusqu'ici, je n'avais connu le raton laveur que par l'Inventaire de Prévert. Ça me l'avait fait paraître plutôt sympathique.
Ici, surtout la nuit, on vit avec. Je vous garantis que ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas pour rien que l'animal porte un bandeau noir autour des yeux. La spécialité du racoon, c'est le vol à la tire et le cambriolage.
O malheureux campeur, quand la nuit tu fais ta popote, ne quitte pas des yeux ton frichti si tu ne veux le voir soudain disparaître. Quand tu dors, serre bien toutes tes victuailles si tu veux qu'il t'en reste un peu le matin venu. Cache soigneusement aussi tout ce qui peut-être mordillé, déchiré, rongé, emporté Dieu sait où, car s'il ne trouve rien de comestible, maître Racoon, à titre de représailles, se vengera sur le reste.
Le premier jour, on a trouvé ça plutôt drôle. Le second, nettement moins. Le troisième, la rogne commençait à monter. Avant hier, un maudit racoon a volé en plein jour la part de poulet de Petit Prince. Ça déclenché le processus des sanctions. Vous savez ce qu'on a mangé à midi ? Du racoon rôti au feu de bois. A vrai dire, c'est pas terrible-terrible, beaucoup de gras et chair plutôt fadasse. C
ela dit, c'était bon. Joie primaire : tu piques la bouffe de mon petit, je te chope, je te scouique de mes mains nues, je te bouffe... C'est la joie ! On se trucide selon les lois de la Sainte Nature.
Mimi la Crêpe n'a pas encore digéré le racoon, pourtant, parole, elle n'en a pas bouffé des masses. Normal ! Elle est écolo. Ecolo à l'américaine, mais écolo. A priori végétarienne. Pas de meurtre ! Eh merde... Quand tu arraches un radis ou une salade, tu le tues. Même si le radis ne se débat ni ne saigne ni ne crie, il meurt. Pire encore, vu l'inertie de ces fichus végétaux, tu les bouffes encore vivants. Salauds de végétariens ! Sadiques ! ! !
Bouffer un frère mammifère que tu as estrangouillé de tes mains pleines de doigts, que tu as senti se débattre, essayer de te griffer, de te mordre, jusqu'à ce que dans un dernier sursaut la bielle se bloque sur le maneton, c'est cruel, mais c'est au moins pas faux-cul. La vie, la nature est cruelle. Toute mort est au fond éminemment naturelle. .. Je suis content de me savoir animal.

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Key Largo, lundi.
Yahou ! Wahoo ! J'ai réparé la télé de Petit Prince... Moi... Tout seul, aidé de mon multimètre analogique Micronta 22-204 B, de quatre diodes 1000V-1A à 67 cents la paire chez Radio Shack, d'un fusible 1,5 A que j'ai trouvé dans ma caisse à outils, j'ai redonné la vie à la boîte a images made in Taiwan.
Oh, oui, d'accord, c'était juste le pont de diodes après le transfo d'alimentation qui avait joué au cercle infernal. Grâce à Dieu, c'est le genre de truc qui arrive aussi sur des motos à alternateur. C'aurait été la bobine Gorgougnoff entrée en rut avec le transgalacteur prophylactique, j'eus séché... Je n'ai jamais su comment marche une télé. Seulement, là, bol, joie...
Quand j'ai shunté le fusible mort avec mon testeur sur 500 milliampères, au lieu d'un silence silencieux éventuellenent suivi d'un nuage de fumée, j'ai entendu Walter Cronkite dévider ses salades sur CBS News...
La joie, la joie, la joie. Le truc qui ne marchait plus, que tu tripotes de tes doigts, et qui reprend vie par le fait même, c'est fabuleux. Cette joie, je l'avais oubliée depuis... Je ne sais plus quand, à propos d'un joint spi parti a la dérive sur mon GT 80, quelque part au bord de la mer Rouge...
Oh, mec, au lieu de t'acheter le dernier casque a la mode (il est presque aussi ou plus mauvais que les autres, et il faut bien mourir un jour), le slip en zinc qui fait vachement course, ou le pare-avant qui te fera voir bizarre quand les jours de folie tu regarderas le monde à travers lui, et le reste du temps t'empêchera de sentir que tu te traînes, achète-toi des outils ! C'est le pied, promis, juré...

Key Largo, dimanche
On va déménager de John Pennekamp State Park demain matin, à cause de la pollution. Jusqu'à maintenant, on avait un voisin adorable. Ed, un Michiganien d'une cinquantaine d'années, pépiniériste huit mois de l'année, il passe ses hivers en vacances, jusqu'à ce qu'il fasse assez chaud dans le Michigan pour travailler les jardins.
Il venait d'écumer le sud des Etats-Unis avec sa 504 break diesel et sa petite caravane. Ouais, les mecs, une Pigeot a Mazout, qu'il a, le père Ed, une bonne Pigeot de chez nous avec 140 000 miles au compteur, un machin made in France avec des sièges durs et où l'on est assis comme sur une chaise de cuisine, avec une boîte de vitesses bizarre qu'il faut toutes les passer à la main, avec trois pédales, un machin qui fait 25 miles avec un gallon d'espèce de fuel domestique.
Allons donc... Une Frenche ôtomobile, qu'il a... C'est le deuxième pigeotiste que je rencontre aux Etats-Unis, papa Ed. Le premier nous avait pris en stop à Portland un jour que j'avais emmené Petit Prince à l'hosto pour une otite.
Si je me fie à cette statistique effectuée en neuf mois sur un échantillon de deux pigeotistes américains, les propriétaires de Pigeot aux USA sont des gens sympas et bons vivants. Avec Ed, on était bons voisins, on s'invitait à dîner ou à boire, on se racontait nos aventures, bref, on s'entendait bien ; avant-hier il est reparti vers son Michigan natal, clac, clac, clac...
On a hérité de deux Khânâdiens anglais de Winnipeg, venus jusqu'ici avec une voiture Honda 600 et une tente, canadienne comme il se doit. Oh, ils sont sympas comme tout, la première chose qu'ils ont faite en arrivant a été de nous inviter à une colossale Tequila party, mais ils sont polluants, ils ont une radio de bord avec un booster de 40 watts, et toute la journée on a droit à la radio locale.
Par ici, la radio locale, c'est pas vraiment le genre intellectuel : environ un mot de langage articulé toutes les demi-heures, pour le reste, ils ont une vingtaine de disques, les plus à la mode, et vl'a-t-y pas une station de radio qu'a côté, Europe 1 ou RTL, ce sont les académies française et Goncourt.
Jésus Marie Joseph ! Ça toute la journée, c'est un supplice d'une intensité difficilement imaginable sur cette terre. Une pollution à côté de laquelle les retombées radioactives sont une joyeuse rigolade, car elles ont au moins le mérite de tuer.
L'Amérique m'apprend a haïr la musique, je veux dire cet ersatz de musique que l'on entend sans l'écouter, mais dont la répétition vous abrutit le cerveau comme les consignes de comportement énoncées pendant votre sommeil dans le « Meilleur des Mondes » de Huxley, il m'a fallu venir ici pour comprendre ce bouquin. C'est l'horreur. Bref, on va se tirer demain. Ed nous a dit que, 100 miles plus au sud, il y a un autre state park absolument paradisiaque, sur l'île de Bahia Honda (rien à voir avec les motos, en espagnol honda veut dire profonde). C'est juste après le pont de 11 kilomètres. On n'a jamais franchi un pont de 11 bornes de long. C'est le moment ou jamais...
Bahia Honda, mardi
Question : quel effet cela fait-il de franchir un pont de 11 bornes de long ? Hébin c'est pareil comme si il était plus court, sauf qu'il est plus long. Oh, c'est pas le plus long du monde, le pont soit-disant le plus long du monde est, bien sûr aux Etats Unis, mais en Louisiane, et fait quarante bornes de long. Ça, le pont le plus long du monde, fallait bien qu'il soit en Amérique, sinon ça serait la honte, manquerait plus que ce soient les Russes qui l'aient...
C'est une manie américaine : avoir le truc le plus ceci ou le plus cela du monde. Daytona Beach se gausse à grand renfort de banderoles d'être la plage la plus connue du monde. Ben tiens...
Je suis sûr que si je pouvais me faire parachuter au tréfonds de la Sibérie et que je demande au premier moujik de passage « si je vous dis y 'a bon, oh pardon, si je vous dis plage qu'est-ce que vous répondez ? » Sûr qu'il s'exclamerait : « Plage ? Mais, babushki, Daytona Beach, boljemoï ! »
De même Disneyland se vante d'être l'endroit le plus heureux du monde. Quelque part dans le parc national de Yosemite, il y a un arbre entouré de grilles, c'est soi-disant le plus gros du monde. C'est l'idée fixe de l'Amérique. Etre toujours le plus ceci ou le plus cela du monde.
Rien ne saurait en aucun cas être mieux que l'Amérique. Quand d'aventure je raconte a un Américain que je fais plus ou moins le tour du monde, la question quasi-automatique est « alors, quel est le meilleur pays du monde ? »
Haha ! La grande question... Quand ils demandent ça, les fils de l'Oncle Sam, ils ont l'air d'un teckel qui mendie un sucre. Arf ! Arf ! Fais moi plaisir, dis moi que c'est l'Amérique, on m'a rabâché ça depuis first grade à l'école, après la guerre du Viet Nam, le Watergate, la récession de 1973, avec les taux d'intérêt qui ont fait une pointe à 20,5 % et l'essence à un Dollar trente le gallon, je pourrais finir par avoir l'ombre d'un doute.
Arf, arf ! Dis moi qu'on est les plus beaux, que tu vas épouser une Américaine pour obtenir un visa d'immigrant, que le rêve de ta vie est une maison en bois bouffée par les termites avec une hypothèque de 35 ans et une seconde hypothèque sur le peu que tu as déjà payé, une carte Visa, une Mastercard, une Master card II, une Carte Blanche, une Diner's Club, une carte Sears, une Arco card, une Texaco, une Mobil, une American Express, pour être . ement endetté que tu ne risques pas de mettre un jour la clé sous la porte pour aller voir ailleurs si tu y es.
Dis moi que tu rêves d'une Cadillac Séville avec un V8-6-4 ou - une Lincoln Mark VI contresignée Cartier ou Givenchy pour te rappeler ton pays natal, tu vois qu'on n'est pas raciste. Seulement, arf ! arf ! Dis nous que l'Amérique est le neumbeure ouane !!!!!!!!!!!!! »
Argh !!! Ça me rendrait sadique, ça me donne envie de hurler que l'Amérique est un tas de merde plein de Juifs, de Noirs et surtout -.méricains, que je suis syphilitique, communiste et pédé, que je suis ici en attente
d'asile politique en URSS, que dès que j'aurai quitté ce putain de pays pot-pourri, j'irai vendre mon auto américaine à un Arabe pour m'acheter une moto japonaise, ouais, mec, une 920 Yam V Twin noire avec des commandes reculées, des bracelets et surtout pas de carénage, que...
Et puis non, je n'arrive même pas à me mettre en colère. Alors, je dis la vérité. Que si, à la fin de cette aventure, j'avais envie de trouver une raison de vivre dans le travail, j'irais bosser au Japon ou au moins avec des Japonais, parce que là-bas, on ne prend pas le travailleur pour une merde, et que s'il se met à discourir de la politique générale de l'entreprise, on poussera le vice jusqu'à l'écouter parler, que si j'avais envie de vivre un point c'est tout, j'irais en Italie ou en Syrie parce que là-bas, on prend encore le temps de parler à son voisin, qu'on sait se moquer de soi-même et que l'on a envie de tendre les bras aux enfants dans la rue.
Que si j'avais envie de me retirer tel Ulysse sous ma tente, j'irais au Népal, parce que là-bas on n'a que faire de te juger et donc qui que tu sois on te fiche une paix royale. Que si j'étais retraité avec $20 000 par an, j'aurais peut-être un motor-home, les trois cartes de crédit principales, et là, je vivrais un peu partout sur le continent américain du Canada au Mexique.
Qu'en France, tout de même, il y a des années où le Beaujolais nouveau est fichtrement bon, qu'on sait encore passer deux heures à table en discutant le sexe des anges, et qu'au fond, je ne suis pas frustré d'être né à Pontoise, Val-d'Oise, plutôt qu'à Milwaukie Oregon.
Eh ben. tout de même, ça les frustre, Comment peut-on être en Amérique depuis dix mois et ne pas rêver d'être Américain ?
Au fond, c'est vrai, les Etats-Unis d'Amérique n'ont que 205 ans d'âge, vouloir être le plus ci ou le plus ça, c'est une passade d'ado. Ça passera. D'ici un petit millier d'années, l'Amérique n'éprouvera sans doute plus le besoin qu'on lui dise que c'est elle la meilleure. A ce moment là, j'y reviendrai, promis...
En ce moment, je pense au bœuf en daube que Mehni faisait au restau « Le petit Pavois » presque en face de là où Moto Canard était quand il a fait sa crise de puberté.
Ce qui est angoissant, c'est que je ne revivrai jamais ça, Josyane la patronne qui me faisait crédit pire que si j'avais été un gouvernement d'Afrique équatoriale, a mis la clé sous la porte, l'année dernière quand je suis passé a Paris en transit entre le Japon et la Californie, je suis venu en pèlerinage chez Josyane et je me suis retrouvé en face d'un restaurant chinois... Je perds mes racines...
Ne quitte pas trop longtemps l'endroit où tu vis, mec, sinon tu risques fort de revenir en terre étrangère, fais gaffe a tes pieds si tu ne veux pas passer ta vie en exil. Wouh ! Ça fait du bien d'écrire ça, pour la première fois depuis trois ans, je me sens home-sick, j'ai le mal du pays. Je voudrais bien être en train de commander un demi chez la mère Chartier, en face du canard, qui le fera bien mousser pour économiser la camelote, et là, je parlerais avec Zinzin... Merde... Il est mort...
Non, avec Guido... Merde... Il est parti... Avec Sacha... Merde... Il est parti aussi. Enculé. Je crois bien que si je revenais à cet instant, je me retrouverais tout seul.
De toutes façons, si ça se trouve, le bistrot d'en face est fermé. Ça fait une paie que les Chartier parlent de retraite. Si d'aventure je reviens, ne me resteront peut être bien que les amitiés que j'ai faites en route, Petit Prince, avant tout. Kathmandu, juin 1979, Jusqu'à quand ?
Oh, les mecs, attachez vos ceintures, éteignez vos mégots, je suis assis sur du vent et en ce moment ça me fait terriblement peur... Allo ? Maman ? Bobo...
Voilà ma réalité vraie de l'instant présent. Il a l'air fin, le voyageur au long cours. Parti sur son glorieux 80 Yam, l'œil plein de flamme et le jarret puissant, le v'ia-t-y pas trois ans après, assis sur un siège de chasseur dans les toilettes du plus beau terrain de camping de Floride, griffonnant entre deux lavabos sur un bloc de papier jaune à lignes bleues des Vosges que s'il en avait la possibilité a l'instant instantané, eh bien, il retournerait chez sa mère, avec aux tripes la trouille atroce qu'à l'arrivée il n'y ait personne pour lui dire sur un ton crédible : « content de te revoir », vous savez comme dans la chanson de Brassens, qui s'appelle, je crois « Celui qui a mal tourné » et se termine par : « et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps », Débile tout ça, débile...
Puis, au fond, j'en ai marre de ces terrains de camping trop beaux pour être vrais, de la Floride où en ce moment, la moitié de la population a l'air d'être là pour passer sa retraite ou ses vacances. Faut bouger... Aller ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Ailleurs, c'est toujours plus beau, au moins jusqu'au moment où l'on y arrive. Quelques fois, tout de même, ça dure encore un moment après.
Pouatch ! J'ai un bourdon, que celui de Notre Dame de Paris, à côté, c'est le buzzer de la Casio quartz-alarm-chronograph que je me suis achetée en solde à Miami. Toutes les heures, elle fait bip-bip.
Ça a l'air débile, hein ? Tout à coup, quand on était à Key Largo, non, ça m'a pris avant...
Oui, à Los Angeles, après qu'on ait acheté le matériel de camping, j'ai eu une envie d'acheter une montre. Pas une Piaget en platine, ni une Audemars-Piguet incrustée de diamants, non ! Un truc made in Japan, bon marché, pas plus de 30 dollars, mais qui soit très précis et fasse impérativement chrono et réveil.
Ça a l'air débile, quand on s'apprête à partir en camping, d'avoir soudain une envie de femme enceinte de montre-chrono réveil, n'est-ce pas ? Je ne l'ai achetée qu'à Miami parce qu'il a fallu attendre jusque là pour trouver le truc que je voulais à un prix qui me convienne.
En plus, j'ai eu le bip-bip facultatif (on peut le déconnecter) que sur le coup je trouvais débile, que foutre avais-je à faire d'un bip bip qui sonne les heures comme un coucou suisse ou une horloge de campagne, qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit : Je vous attends... ?
Ma Quartz-alarm-chronograph m'a été confisquée lorsque je suis entré en prison à Daytona. Quand on me l'a rendue, quelqu'un avait touché aux boutons, et le bip-bip avait été mis en route. Je l'ai laissé au début par flemme. Maintenant, pour rien au monde, je ne l'arrêterais. Il vient heure après heure me faire réaliser quelque chose : depuis une date et une heure inconnues, je suis en train de perdre mon temps ! Yapas, faut bouger.
New Orléans, lundi
Haha ! Petit Prince, Mimi la Crêpe, la grosse Gégène et moi, on a franchi le pont le plus long du monde. Trente-huit bornes au-dessus du lac Ponchartrain, une cabine téléphonique tous les 500 mètres, à la fin, quand on arrive à New Orléans, y'a un marchand de bagnoles d'occase qui s'appelle Caruso, c'est tout l'effet que ça m'a fait, le pont le plus long du monde... Ah, si... Il est très long.
New Orléans... La nouvelle Orléans. Une drôle de ville, pour l'Amérique s'entend. Une ville ou les rues portent des noms. Généralement, par ici, on donne des numéros aux rues et avenues.
On coupe la ville en carrés selon les points cardinaux, et l'on flanque des numéros. Les avenues vont du nord au sud, les rues d'est en ouest. Ça fait un quadrillage sur la ville. Le premier, ou les deux ou trois premiers chiffres d'une adresse représentent le nombre de « blocks » (espaces entre deux carrefours) à partir du centre-ville. Une rue qui ne part pas du centre ville n'aura donc en aucun cas de Numéro 1, la première maison aura un numéro commençant par le nombre de carrefours par rapport au centre. Le 17501 N, par exemple, indiquera une location à 175 blocks au nord du centre ville, même si c'est la première maison de la rue en question.
Ce quadrillage, s'il manque de poésie, est très pratique : on s'oriente comme on joue aux échecs. Maintenant, dans une ville américaine normale avec des rues et avenues à numéros, je ne peux pas me perdre.
Seulement, à la Nouvelle-Orléans, les rues ont des noms. Complètement débile, à la limite anti-américain. Du coup, la première fois, je me suis perdu comme ça ne devrait pas être permis sur cette terre d'Amérique. Me perdre, dans le temps, j'aimais.
Seulement, avec la grosse Gégène qui bouffe ses 25 litres aux 100 en ville, ça m'angoisse, d'autant plus que depuis que j'ai mis mes pieds sur la très sainte terre d'Amérique si l'on excepte la période où j'étais plongeur en chef a Port-land (Oregon)J'ai toujours été fauché comme les blés en automne.
Du coup, ce système de rues avec des noms, où l'on se retrouve par opération synchronisée du plan de la ville et du Saint-Esprit, je le hais...
New Orléans a aussi ses bons côtés : on peut y faire une chose rare en Amérique : prendre le bus jusqu'au centre ville et marcher. Ouais, mec, marcher. N'importe où, là où ça a l'air sympa.
Ainsi, on a décidé de jeter l'ancre à la Nouvelle-Orléans. On a loué une caravane de 10 mètres de long qui n'a pas roulé depuis la guerre de sécession, située sur un terrain au bord de Chef Menteur Highway, il a fallu se battre pour la reconquérir des cafards, mais c'est grand, c'est chez nous, on a une adresse et tout.
P'tit Prince est heureux comme tout d'avoir une cambuse où l'on soit seuls locataires, il est beaucoup plus calme, un soir il est arrivé avec un des petits gars du coin et m'a dit « Jack s'est engueulé avec ses parents, il pourrait rester chez nous cette nuit ? »
Je l'ai vu tout fier quand je lui ai dit « bien sûr » : il pouvait héberger un pote. C'est vrai que depuis si longtemps, pour lui. c'était toujours vivre en hôtel, en camping, ou chez « quelqu'un d'autre ». Il est content d'être chez lui.
Ecoutez je vais même vous révéler un secret : il a perdu sa couverture de Linus. Jusqu'ici il avait son « susuce », un vieux bout de jean qu'il trimbalait partout avec lui et suçotait comme d'autres sucent leur pouce ou rongent leurs ongles.
Un jour qu'il était parti jouer avec des copains, je l'ai trouvé oublié sur un lit. Petit Prince, oublier son Susuce ? Je me suis dit qu'il a dix ans et demi, et que peut être... Je l'ai mis dans le congélateur pour qu'il ne s'abîme pas, et n'ai rien dit. Il s'est passé un ou deux jours avant que Petit Prince me demande si je l'avais vu, il l'a cherché un peu, puis n'en a plus parlé... On a tourné une page, même pas ! Une page s'est tournée toute seule. C'est la vie...
New Orléans Jeudi
Wâho, les mecs, je vais vous faire vivre ce que je vis à l'instant-même, Ce qui vous amènera peut-être à me conchier, à me compisser, à rigoler au fond de votre tête ou à rien du tout.
Il est sept heures trente du matin ici à New Orléans, c'est-à-dire quatorze heures trente au pays dont labourage et pâturage sont, dit-on, les deux mamelles. Je suis cuté sur le siège avant-droit de la grosse Gégène, garée en face de Eunice's restaurant, au 8300 Chef Menteur-Highway, New Orléans, Louisiane. « Breakfast, lunch, short orders, hot biscuits served dayly ».
Oh je ne suis là ni pour le petit déjeuner ni pour le déjeuner, simplement parce qu'à trois mètres de la porte, il y a un poste de téléphone public, 242.98.30, eh oui, ici les cabines publiques ont un numéro, et on peut les appeler comme un téléphone privé.
A la page 13 de la section 4 du Times Picayune, le journal du coin, il y a parmi tant d'autres une petite annonce ainsi rédigée. «73 LTD 8 seater Squire wagon, clean, no rust, new shocks + brakes, asking $800, must sell. Fred 242.98.30 ».
Page 9, à la rubrique équipement de chasse et de pêche « 12 x 12 tent, installs in 5mn, Coleman 2 burner gas stove, propane lamp, $100 or separate. Fred 242.98.30 ».
Voilà, je suis le 242.98.30 et j'attends que le téléphone sonne. On vend la baraque. Sonne, sonne, petit téléphone, il faut que tout disparaisse.
A vendre la grosse Gégène et ses 400 pouces cubiques de cylindrée. Sacrée Gégène. Si ce week-end tu t'en vas aux mains d'un autre, parole, j'en aurai gros sur la patate. Sacrée mémé ! En sept mois, tu m'as peut-être bien bouffé autant d'essence que toutes mes motos en l'espace de quinze ans. Tu m'as aussi fait traverser l'Amérique, tu m'as inséré pour un temps dans cette société américaine, où à quelques exceptions près, on n'existe véritablement que si l'on a une automobile.
A l'instant où je signerai ton certificat de propriété, mon expérience américaine sera close. Ecoute, ma grande. Je souhaite sincèrement que tu sois vendue vite : j'ai envie de me tailler d'ici. Cela dit, je sais que je te regretterai autant que ma première moto : je sais qu'un jour, bientôt, je me dirai : « j'aurai dû la garder, c'était une pièce de collection, une fin de génération ». Mais bon, il faut du pognon pour rentrer. Cette fois-ci c'est décidément décidé, on rentre.
Voir Petit Prince s'épanouir simplement parce qu'il a une maison où vivre, même une vieille caravane en bois où l'on doit en permanence faire la chasse aux cafards, d'avoir vu qu'en Oregon il n'était pas malheureux du tout d'aller à l'école, qu'il était content de ramener parfois des petits diplômes de « math wizard » (fort en maths) ça m'a fait lui demander : « qu'est-ce que tu dirais de rentrer en France ? Je te mettrais dans une école de rattrapage kool où l'on te fera pas trop chier, on aurait un apparte où t'aurais ta piaule... » Sans hésiter, il a dit OK. On rentre.
Eh ben voilà. Ça y est. Ma période automobile est close. Aujourd'hui, à 14h30 central time, je me suis rayé d'une signature du monde des automobileux.
J'ai vendu ma Gégène à un citoyen des Etats-Unis d'Amérique, noir comme du cirage depuis la tête jusqu'au nombril, et vachement sympa, même que j'avais un peu honte de la lui vendre plus cher que je l'ai achetée, après m'en être servi pendant sept mois et 8819 miles, soit 14 286 km.
J'ai acheté la Gégène 525 dollars, je l'ai revendue aujourd'hui 700 dollars dont 350 sous la table pour pas payer de taxe locale.
Bah je lui ai tout de même acheté en route un jeu de durites de refroidissement (12 dollars), quatre amortisseurs (en solde chez K Mart, 32 dollars), une durite haute pression de direction assistée (14 dollars), un pneu d'occasion (12 dollars), une réfection des freins arrière (40 dollars y compris la rectification des tambours), un cardan de sortie de boîte (30 dollars), un mécanisme d'avance à dépression (21,70 dollars), un plateau de rupteur (5,45 dollars), un rupteur/condensateur (6,15 dollars) et, O erreur, avant de partir d'Oregon, un tune-up (changement de rupteur, condensateur, bougies et réglage allumage/carburation, 60 dollars).
Si un jour, je me retrouve en Amérique avec une bagnole qui a besoin d'un tune up, je m'achèterai un stroboscope en solde chez Sears ou chez K Mart, et je le ferai tout seul comme un grand. Quand j'ai fait faire le truc à Portland, a la fin de l'année dernière, j'étais timide comme une pucelle en face d'un V8 de sept litres avec un rupteur qui s'ouvre quatre fois par tour moteur. Ça m'a passé.
Bref, j'ai tout de même dépensé 212,30 dollars de pièces et services divers sur la Gégène, soit au cours le plus élevé 1093 francs. Ouais ! Vous vous rendez compte, j'ai roulé en bagnole américaine pendant 15 000 bornes, et, en mettant tout de même à part l'essence, je m'en sors avec 307 francs de bénéfice sur le véhicule... L'essence... Ah, là... J'ai dû bouffer dans les huit cent cinquante gallons d'essence. Trois mille deux cent trente litres ! ! ! En mettant le prix moyen de l'ordinaire à 1,30 dollars le gallon, ça veut dire que j'ai dépensé mille cent cinq Dollars d'essence. Cinq mille cinq cents balles de benzine, deux fois ce que m'a coûté la bagnole, Jésus Marie Joseph. J'en suis sur le cul.
Heureusement que j'étais ici, à la pompe d'à côté, l'ordinaire est à 1,23 dollars le gallon, ça nous met sauf erreur le litre à 1,70 F. Par rapport au moment ou je suis arrivé en Amérique, ça fait cinquante centimes d'augmentation, dus en petite partie à la libéralisation des prix de l'essence ici et à la baisse du franc par rapport au Dollar. Merde. Quand j'ai acheté des Dollars à Paris en juin dernier, ils valaient 4.10 F. Aujourd'hui, c'est 5,15 F. Merde, mais j'ai fini de parler de fric ???
Ce pays m'empoisonne. Le fric, le fric, le fric... C'est vrai que quand on vit ici, ça devient rapidement une sorte d'obsession, une raison de vivre. Ça fait dix minutes que je vous parle de mes pertes et profits
aux Etats-Unis d'Amérique, et sauf erreur, vous n'en avez positivement rien à cirer. Que voulez-vous ? C'est L'Amérique qui veut ça... Foutons le camp d'ici...
On va rentrer au pays, en espérant seulement qu'à notre arrivée, on n'aura plus le Giscard pour nous polluer les oreilles et les yeux, ça va être les élections très bientôt. On voudrait revenir dans une France qui essaie de vivre quelque chose, plutôt que de chercher mesquinement à conserver un vague acquis à force de mégotages.
On a au fond de nous un ridicule espoir. Si ça ne marche pas, encore une fois, on partira ailleurs. En Russie, en Corée du Nord, en Mongolie, au Viet-Nam. Partout où l'on chie des bulles parce qu'il y a encore tout à construire, et qu'il faudra des mains fermes et... Merde. J'ai oublié le mot, bref, des mains qui veulent réaliser le soi-disant impossible, justement parce que ça serait mieux comme ça.
Ça y est ! J'ai trouvé. Utopique. A l'instant même où j'ai trouvé un mot pour dire ce que j'avais à dire, la pluie a commencé à tomber sur New Orléans. Tant mieux, cette nuit, on va respirer...
En route, dimanche, 18 h 47
Et voilà. Notre bus Greyhound vient de traverser la Ponchartrain Causeway, on a quitté la Nouvelle-Orléans. L'Amérique, ça va être fini, après, ma foi, dix mois et demi.
On ne verra plus de ce fichu continent, à part la route qui défile, qu'Atlanta (Géorgie) pour neuf heures, et New York, pour sept heures.
Sauf erreur ou imprévu, on sera à Genève mercredi après-midi à deux heures et quart. Ça aurait été plus simple de vous dire mercredi à quatorze heures quinze, mais ici, il n'y a que les militaires qui comptent les heures par tranches de 24.
Au fait, pourquoi Genève ? Ben... J'ai beau être né dans le Val d'Oise, je suis comme qui dirait pas français. Or, quand on est en France et pas français, on a besoin d'une autorisation pour quitter provisoirement le pays du camenbert-beurre, et l'on n'a droit de partir que pour un temps limité.
La France prend soin de ses métèques. Jusqu'ici, on m'avait donné des visas de sortie et retour valables un an, parce que d'habitude, à la préfecture du Val d'Oise, il y avait au service des gnakoués des nanas sympa et débrouillardes qui n'hésitent pas à se servir du téléphone quand le métèque de service demande quelque chose qui n'est pas a priori inscrit dans le manuel.
Avant de partir aux Etats-Unis, j'ai voulu avoir mon coup de tampon habituel, mais là je suis tombé sur une espèce de premier de la classe qui a décidé que ce serait six mois pas plus. Les six mois passés, je suis allé faire une demande de prolongation au consulat de France à Los Angeles, et maintenant, quatre mois après, ledit consulat n'a comme qui dirait pas reçu de réponse de France.
Bref, au moment de quitter les Etats-Unis, je ne peux pas rentrer en France. Alors où aller ? Ben c'te bonne blague, en Suisse, nom de bleu ! Le pays qui ne casse les bonbons à personne, et où l'on va lorsque les autres sont en train de s'empoigner pour des raisons fumeuses, et le reste du temps ne passe pas un humanoïde aux rayons X avant de lui accorder un visa de visiteur.
Mercredi dernier, je suis allé au consulat suisse pour demander le fatidique coup de tampon sur mon passeport. J'ai eu une chaleur quand on m'a dit que l'on avait besoin de l'autorisation du ministère à Berne. Autorisation du ministère, selon les pays, ça peut demander jusqu'à six mois de délai, en admettant que la réponse arrive, ce qui n'est pas toujours évident.
Bref, j'ai demandé, la sueur au front, combien de temps ça risquait de prendre. « Oh, en passant la demande par télex, faut bien compter deux jours ».
Je n'osais pas trop y croire, eh bien si, en quarante six heures ça a été réglé. Merde ! J'espère que ceux qui racontent des blagues sur la lenteur des Suisses ne travaillent pas dans l'administration française, si non, nom de bleu, dès que j'aurai fait mon coup d'état, je les ferai déporter en Girurgie Ouesthétique, là où c'est justement une limace qui a pris le pouvoir, et je décréterai très démocratiquement qu'il faudra être Suisse pour avoir le droit de travailler dans l'administration française.
Enfin... Dans trois jours, Genève... Ça va faire tout drôle d'entendre des gens parler français dans la rue, de voir des télévisions ousque ça cause français dans le texte, faut dire que j'en ai un peu ma claque de vivre en version originale même pas sous titrée, je brûle d'entendre des gens qui disent « merde » quand ils glissent sur une crotte de chien... Ça s'appelle... Je crois que ça s'appelle le mal du pays...
Kennedy Airport, mardi
Je me marre !
Le cul bordé de nouilles... Y'a pas si j'essaie de planifier un tant soit peu les choses, tout cafouille, puis une fois que tout est bien embrouillé, il y a à peu près toujours un événement imprévu pour arranger la salade. Là, quand on est parti de la Nouvelle Orléans, en théorie, tout était planifié.
Départ de New Orléans par le bus Greyhound de 17h45, arrivée à Atlanta, Géorgie, à 6 h 35 lundi matin, achat de deux billets Bruxelles-Genève, puis consulat de Belgique pour le visa de transit, départ d'Atlanta par le bus de 15h30, arrivée à New York mardi à 13h30, vol CL 210 New York/Bruxelles à 21 heures (check-in à 19 heures) arrivée à Bruxelles à 10h45 heure locale, départ de Bruxelles par SN793 à 13 h 40, arrivée à Genève à 14h50.
Ça faisait à cracher 177 dollars pour Greyhound, 413 dollars pour Capitol Airlines, 221 dollars pour Sabena, donc exactement 811 dollars, ce qui nous laissait soixante trois Dollars et quarante trois cents d'argent de poche, pour la bouffe et les éventuelles taxes d'aéroport. A 6 h 35, comme prévu, on était à Atlanta.
On s'allonge pour sommeiller un moment, un mec en face de moi ouvre son journal du matin, « The Atlanta Constitution ».
Gros titre en première page « French voters give a nod to Mitterand ».
Voyons, voyons. Les voteurs français hochent la tête à Mitterrand, que ça veut dire. Oui, mais en clair...
D'après les résultats du premier tour, il me semblait que le vicomte de Giscard allait repasser, alors, pourquoi les voteurs français hochent-t-ils la tête à Mitterrand ? Pour lui dire « c'était bien, mais tâche de faire encore mieux la prochaine fois » ?
Faut que j'aille acheter le canard... Je lis vite la première page, et reviens vers Petit Prince hilare : « la France change de gouvernement, la Gauche est élue ! » Petit Prince ne réagit pas trop. Pour un routard de dix ans, la politique de son pays natal...
Allez, dépéchons nous de rentrer en France...
Ça a commencé mal, puis a continué mieux que prévu. D'abord, ni le vélo de cross de Petit Prince, ni sa malle à jouets ne tenaient dans les casiers de consigne automatique, donc pendant que j'allais acheter les billets d'avion et demander le visa de transit belge, il a fallu que Petit Prince reste seul dans la gare routière à surveiller ses trésors, dans cette fichue ville d'Atlanta où au jour d'aujourd'hui un quiconque a déjà assassiné 26 enfants.
Bon, c'était pas le gros gros risque, d'une part Petit Prince n'est pas tombé de la dernière pluie, d'autre part la gare routière est truffée de vigiles bardés de matraques, revolvers et autres walkie-talkies, et de tierce part le tueur en série ne s'attaque qu'aux enfants noirs.
M'enfin c'était pas le rire... Par contre, le bureau de la Sabena et le consulat de Belgique se trouvent face à face à 500 mètres de la gare routière.
En bref, les démarches pour lesquelles je m'étais attribué neuf heures ont été expédiées en 55 minutes. Et youpi, on va pouvoir prendre le bus de midi 45. La joie...
Vlà-t-y pas que sur les coups d'onze heures, on annonce un bus pour New York qui ne figurait pas sur notre horaire. Qu'à cela ne tienne, on agrippe les bagages et l'on prend la queue comme tout le monde. C'est là que ça a commencé à merder...
Nos bagages, c'est un peu le folklore : une grosse malle style « trésor de Rackham le Rouge » qui contient tous les jouets que Petit Prince a accumulés en dix mois d'Amérique, une valise pour les sapes, et le Schwinn.
Un super-vélo de cross made in Chicago, un de-luxe avec partie-cycle chromée, le cheval de Petit Prince. Pas question de partir d'Amérique en abandonnant son cheval tout de même...
A New Orléans, le chauffeur du bus avait fait la moue en voyant un vélo dans nos bagages, mais, bof, il a laissé glisser.
Nous voilà donc faisant la queue pour prendre le bus Atlanta-New York, dernière étape avant de prendre l'avion pour notre vieille Europe.
« Je ne peux pas prendre ça », nous dit le chauffeur.
« Ça », c'est le vélo de Petit Prince. Là a commencé une lutte diabolique.
Du chauffeur à son chef jusqu'au chef en chef, il s'est avéré que Greyhound ne pouvait transporter un vélo que dans son emballage d'origine, qu'à la nouvelle Orléans on n'aurait jamais dû le prendre, et que de toutes façons, à Atlanta, Géorgie, il n'était plus question de le prendre.
Après des heures de tractations inutiles j'ai fini par courir les supermarchés pour trouver un emballage de vélo. Ça a fini par s'arranger avec beaucoup de carton et cinquante Dollars de supplément.
Du coup, quand on est arrivé à New York, on n'avait plus assez d'argent pour payer les deux billets d'avion. C'est alors qu'à la station du bus Carey qui emmène à l'aéroport, j'ai vu une liste de compagnies qui pratiquent les tarifs « stand by » : vous faites le bouche-trou : s'il y a des places libres vous partez, sinon on verra au prochain vol.
Dans la liste figure « Capitol Airways », la compagnie sur laquelle on avait réservé par téléphone de la Nouvelle Orléans. New York/Bruxelles, tarif normal, $275. Stand by, $169 !
Ainsi je me suis présenté la gueule enfarinée pour demander deux passages en stand by, me disant que de toutes façons, parmi les titulaires de réservation, il y en aurait au moins deux qui ne se présenteraient pas : nous précisément.
Ça a marché. On se retrouve même plus riche que s'il n'y avait pas eu le sac de nœuds d'Atlanta. Le bol quoâ... A moins qu'on ait froidement calculé cette spéculation depuis la Louisiane, en faisant les réservations sous un nom en bois style Macheprots ou Duschmol ? Oh Noooooon...
Enfin nous voilà prêts, bagages enregistrés, tickets d'embarquement en poche, si le Coucou ne se crashe pas en route, demain matin on reverra l'Europe...
Culoz, jeudi
Vous connaissez Culoz ? C'est en France, pas très loin de la frontière suisse. Il y a une heure ou deux, une bagnole de contrebandier suisse nous y a déposés, Petit Prince et moi, avec tout notre szimbreck, et dans quatre heures, on va prendre le train pour Paris.
Le cercle est bouclé, ce sera la dernière carte postale d'un bout du monde.
En attendant, Petit Prince est allé « jouer avec les gamins », et moi, je suis assis à une table du Café de la Paix, en face de la gare, devant un saucisson beurre et un ballon de Côtes, à griller des Gitanes en essayant de mettre un peu d'ordre dans ma tête.
Demain matin, on va se retrouver à Paris, avec cent cinquante balles en poche et pas d'adresse.
Il va falloir faire fumer le téléphone pour trouver une bonne pomme qui nous offre l'asile en attendant qu'on puisse, comme on dit, se retourner.
Trois ans après...
J'entends déjà l'indicatif « il n'y a plus d'abonné au numéro que vous avez demandé »
Tu parles d'un programme, mec. Je me sens à peu près aussi à l'aise que quelqu'un qui sort de prison.
Demain va commencer un film en Technicolor et Panavision « histoire d'une réinsertion sociale », parce qu'une chose est sûre : je ne repartirai pas avant longtemps. Pourquoi ?
Peut-être parce que je voudrais donner une maison à Petit Prince, un endroit où il sache qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il pourra se cacher lorsque le roi des Aulnes le poursuivra. Peut-être aussi parce que je sais que ma partie est perdue : « ça » n'est au fond pas mieux ailleurs, le paradis sur terre n'a pas encore été créé, ou, s'il existe, je suis passé devant sans le voir.
Ah le taffe ! S'il n'y avait pas Petit Prince.
Ah oui dernière chose : c'est vrai que la terre est ronde...
je crois bien que je viderais des ballons de Côtes jusqu'à tomber endormi sous la table. pute borgne... Quelle galère...
Au fait, pourquoi étais-je parti ? Si je l'ai jamais su. j'ai oublié. Probablement parce qu'on ne m'aimait pas assez.
Seulement, est-ce qu'on m'aimera plus maintenant ? On navigue en pleine utopie. Le problème sera surtout de savoir si en trois ans de clé sous la porte j'aurai ramassé assez de coups de pied au cul pour trouver dans le futur que la vie n'est pas si mal que ça.
Holà, mec, c'est pas la frite, dis donc, t'en fais une gueule, t'es Mâââlâââde ? Non mais regarde le poireau, il se paie trois ans de tour du monde et il trouve encore le moyen de faire la tronche !
Non... Je déprime parce que j'ai la trouille.
Tant que j'ai été sur la route, j'avais une paix royale : bien sûr c'était souvent la dèche, mais personne pour me casser les bonbons.
Etre en constant déplacement est en fait la meilleure méthode pour n'être agressé par personne.
Je vivais avec Petit Prince, je pouvais entrer en contact avec des gens si je le désirais, mais pas eux avec moi.
Aux Etats-Unis, il y a six mois, j'avais songé à tout simplement disparaître, changer d'identité, brouiller définitivement les pistes et créer une astéroïde isolée dans un désert d'Arizona, où j'aurais vécu avec Petit Prince, deux volcans et quelques baobabs.
Puis j'y ai renoncé, parce que même en Amérique on ne peut pas réinventer le monde comme ça, et qu'au fond je ne suis pas aussi misanthrope que je le croyais.
Du coup il va falloir recommencer à vivre parmi des gens qui me connaissent, m'ont vu et me voient vivre.
Finie la tour d'ivoire, mon existence va retourner au domaine public. Je me demande si au fond je n'en ai pas l'envie.
Sinon, pourquoi revenir.

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
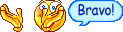 à ce grand voyageur au grand cœur qui a fait de belle rencontres.
à ce grand voyageur au grand cœur qui a fait de belle rencontres. Dernière édition par cobalt57co le Jeu 17 Jan 2013 - 13:28, édité 1 fois

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Fred Tran Duc a quitté son bout du monde
Fred Tran Duc a quitté son bout du monde
Fred Tran Duc a quitté son bout du monde
Par PierreO, le 26 juillet 2011
Fred Tran Duc, “notre” Fred, pilier de Moto Journal, s’est éteint à Hanoï, au Viêt-Nam, où il vivait depuis quelques années. Le 20 juillet, il a été emporté par la maladie contre laquelle il se battait. Fred, mi-journaliste, mi-globe-trotteur, c’était l’homme de La Carte Postale d’un bout du monde, qui a longtemps fait la joie des lecteurs de Moto Journal, notre joie. En fait, ce sont plusieurs “tours du monde” qu’il a effectués, à moto bien sûr, à diverses périodes, la première en 1978 sur une Yam GT 80. Parce qu’il avait la bougeotte, parce qu’il ne concevait pas la vie autrement. Parce que c’était Fred, tout simplement.

Fred, en juillet 1992. Ce jour-là, il assiste à un supercross à Los Angeles. (Photo Carlo Bagalini)
Fred, c’était un ami rare, une personnalité forte, un caractère bien trempé, capable, dans un élan de colère, de balancer un fax défectueux par la fenêtre du journal. Tantôt jurant comme un charretier, tantôt nous régalant de mots châtiés et choisis. N’hésitant pas à planter sa tente, littéralement, dans les bureaux de MJ. A dormir dans sa camionnette, sous nos fenêtres.
Fred, c’était aussi un talent et un humour fous, une gouaille incroyable, une générosité de tous les instants au service d’une culture et d’une plume géniales.

Semaine après semaine, dans Moto Journal, il nous a régalés de ses récits drôles et mordants, souvent épiques, toujours imagés et hauts en couleur. Il y a quelques années, il s’était installé au Viêt-Nam, dont sa famille paternelle était originaire. Il y a acheté une petite maison.
Fred avait 61 ans. A sa famille, son frère Patrick, et tous ses proches, toute l’équipe de Moto Journal présente ses plus sincères condoléances.
Pierre Orluc

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Personnalité de Légende : Frédéric Tran-Duc
Décès de Frédéric Tran-Duc, auteur de La carte postale d’un bout du monde.
Fred est parti pour un dernier voyage, le 20 juillet 2011 à l'hôpital d'Hanoï.
Fred Tran Duc a rejoint l’astéroïde B612 pour toujours !

« On s’emmerde ici ! » ces trois mots qui résument de la manière la plus laconique qui soit l’ennui de se trouver immobile dans un lit d’hôpital, Frédéric Tran Duc les prononcera une heure avant de rejoindre enfin le (vrai) Petit Prince et son astéroïde immatriculé B612…
Fred, c’était les Mauvaises Langues, mais surtout la Carte Postale d’un Bout du Monde, une saga parfois interrompue par des retours à la terre natale, qui fera rêver des générations de motardes et de motards.
On dit parfois qu’untel s’était retrouvé ministre ou garde-champêtre par le plus pur des hasards, mais foin de hasard pour Fred, il était écrit que celui qui désolait les profs d’histoire-géo, maths, physique ou autre activité par son désintérêt pour ces matières rébarbatives, voire, pour lui, subsidiaires, serait plumitif et de talent, de surcroit.
Un jour, rendant un contrôle de géographie, le prof annonça : « je vais vous lire ce qu’a écrit Monsieur Tran Duc » : « cher monsieur le professeur, excusez moi de ne pas reproduire ici la carte que vous me demandez, mais je dessine comme un pied et ne puis décemment me déchausser en classe ! » Cette anecdote qui situe l’humour de Fred, un humour dont il se départira pas jusqu’aux ultimes instants de sa courte vie, nous a été relatée par Harald Ludwig, un camarade de classe de Fred au lycée d’Enghien qui deviendra plus tard chef de studio à Moto Journal…
Après avoir été prié d’aller voir ailleurs par quelques proviseurs de lycées cacochymes, malgré les concerts de protestations de la plupart des profs de Français que Fred avait eu la bonté d’écouter avec attention et qui avaient décelé en lui un réel talent, Fred décide très tôt d’en rester la avec les études et de voler de ses propres ailes en décrochant un boulot de magasinier chez l’importateur Yamaha à Levallois.
La course en survèt’…

Fred avait déjà été piqué sans espoir ni souhait de guérison par le démon cornu de la motocyclette et surtout du sport moto, effectuant quelques prestations sans grand éclat en National, équipé d’un survêtement noir du plus bel effet et de bottes de pompier, au guidon de son Aermacchi Ala Verde offerte pour ses 16 ans par un père qui rêvait pourtant davantage pour lui d’une moto de curé, dixit Fred, en l’occurrence une R51/3 des Domaines retapée par Alazard, avenue de Clichy. Mais Fred, avec astuce, avait sournoisement argumenté que la petite 250 ritale roulait certainement moins vite que la béhème avec son flat 500…ce qui était à peine faux mais pas tout à fait vrai.
Installé dans le sous sol de Sonauto entre ses casiers de pièces détachées, Fred rencontre des noms connus de l’époque, courant pour la marque aux trois diapasons :Lhérault, Ravel, Latouche, Auréal et il fait l’acquisition à bon prix d’une 250 Yam YDS6 afin de se couvrir de gloire à son tour, mais en Formule Sport, l’ancêtre des Promos. C’est ainsi que la Yam, glissée avec peine dans la 2CV AZU fournie et pilotée par son frère (Fred ne possédera jamais le permis auto en France…) rejoindra à la vitesse de la cagouille paralytique (plus de 20 heures pour se rendre à Pau) les différents circuits du championnat, participera au Bol d’Or du renouveau en 1969 avant de cesser toute activité dans son état originel, après que Fred eut vu ses efforts réduits à néant à l’arrivée de la course des 250 des Critériums du MCF 1969 à Montlhéry, où il sera privé de sa première place suite à une réclamation déposée par un vil séide de l’importateur Ossa…
Ulcéré, Fred décide alors de confier à Pierre-Louis Tebec la construction de la Fred-Yam, une machine composée d’un cadre de Bultaco TSS et du moteur de la vaillante YDS6, affublé de pots et de pistons de TD2, afin de concourir en National. « Au moins là, personne ne me fera chier pour deux bouts de tube de trop, soulignera Fred… »
Mais face aux TD2, TD3 et A1R de l’époque, Fred et sa Yam ne font pas le poids et déçu, il décide alors de mettre un terme qu’il pense définitif à sa carrière de pilote.
Entré à la FFM pour aider le Directeur des Sports, Paul Spérat-Czar, à la rédaction et à la fabrication de l’austère revue fédérale France Moto, Fred se sent rapidement des fourmis dans les pieds rue d’Hauteville et dès le début des années 70, il se trouve associé, avec Jacques Bussillet, Gilles Mallet, Micou Montange et surtout Guido Bettiol, le pittoresque rédac’chef et Pierre Barret, le boss, homme génial et charismatique lui aussi trop tôt disparu, dans l’aventure de Moto Journal, un hebdo réalisé dans un deux pièces-cuisine de la Rue de la Tombe Issoire. En 1974, Fred crée les Mauvaises Langues de Khomer Tran Duc, une page de ragots, foutages de gueule, et autres commérages (souvent pour initiés), alimentée par quelques informateurs occultes et bien inspirés dont le jeune H.R, pilote monégasque de talent mais fourbe, à ce qu’il parait…

Fred participe à une animation à la Fête de l'Huma avec la Monark de son frère Patrick
La Carte Postale

Fred pose fièrement devant le GT80 avec lequel il va effectuer son tour du Monde et faire rêver des générations de lecteurs
Et en 1978, jaillit une idée loufoque parmi tant d’autres (comme les essais marche ou crève) dans la tête du Frédo, lassé de la vie sédentaire d’essayeur-gratteur d’articles en détail, gros et demi-gros : faire le tour du monde à moto, mais non pas au guidon d’un flat bavarois ou tout autre engin de n’importe quel quidam sans imagination, mais d’une mini moto, un GT80, alias Miniyam.
Bien entendu, ce choix technique fait s’esclaffer grassement la plupart des membres de la rédaction, mais il s’avère finalement judicieux. Le Miniyam ne laissera jamais Fred en carafe, même abreuvé jusqu’à plus soif des carburants et des lubrifiants les plus pourris de la terre et l’aspect comique d’un adulte sur sa moto de nain déclenchera la sympathie et permettra souvent à Fred de venir à bout de certains obstacles administratifs style passage de frontière, un moment toujours délicat pour Fred…en particulier au Proche Orient, que Fred sillonnera de la Syrie à l’Irak, en passant par la Jordanie, le Pakistan et autres contrées où il fera figure d’extra-terrestre.
Le périple accompli par Fred et la Puce (nom attribué à son GT80 bleu) pourrait remplir des volumes entiers, tant les pérégrinations du globe-trotteur/journaliste, relatées chaque semaine (tout du moins quand les aléas des PTT ou une période de flemme traversée de manière imprévisible par Fred le permettront) dans Moto Journal seront émaillées d’épisodes souvent cocasses, parfois dramatiques, comme ce triste jour de l’an 1992 quand Fred se fera agresser
par un mexicain qui lui cassera le nez afin de lui dérober son maigre pécule.

Durant près de 8 ans, Fred va vivre dans son camion Ford
Fred sera, sans ordre chronologique, prof d’anglais-français-italien dans une école privée, homme de ménage/serveur dans une trattoria au Japon, plongeur, emballeur de caoutchouc, ambulancier/chauffeur de corbillard bénévole au Mexique avec son camion Grosbébé, assistant crêpier de Mimi (dite la Crêpe), une française rencontrée au Saturday Market en Oregon mais c’est à Katmandou que la première partie de sa vie (Fred a eu comme chacun sait, plusieurs vies) basculera, avec la rencontre du Petit Prince, un gamin de huit ans affligé d’une dysenterie amibienne et d’une espérance de vie très limitée que ses parents, baba cool déjantés et irresponsables lui laisseront sur les bras avec pour seul viatique un passeport en règle…
Oh, Calcutta !
Toujours prêt a aller derrière les idées reçues, sans préjugé ni retenue, Fred passe de longs mois en Inde, un pays où la notion de choc des civilisations est tangible à tous les coins de rue, entre résidences pour touristes à fric et meublés cradingues de Jochen Tole. Touriste aux yeux des indiens, dont forcement riche, lui qui dépense en France, en faisant le plein du Miniyam (moins de 5 litres) et de sa nourrice en plastoc achetée sur l’autoroute, l’équivalent d’une semaine de salaire d’un ouvrier agricole indien, il subit avec colère les tracas de la bureaucratie locale, dans un pays où celui qui peut arborer deux galons s’ingénie à faire ch… celui qui semble ou plus riche ou plus pauvre que lui.
Bref Fred n’aimera pas l’Inde et c’est avec soulagement qu’il débarquera, avec petit Prince et la Puce, au Japon, le 22ème pays dans lequel il trainera ses guêtres. Autre contrée, autre choc des civilisations pour Fred qui débute une prometteuse carrière de garçon de café dans un restaurant du Pigalle tokyoïte pour embrayer sur une non moins brillante carrière de professeur de langues dans une des nombreuses écoles privées qui tentent de permettre aux japs de rompre avec leur isolement, eux dont les profs n’ont jamais mis les pieds dans un pays anglophone et dont le niveau linguistique équivaut à celui d’un lycéen français de troisième…
Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin et faute d’avoir pu obtenir un nouveau renouvellement de son visa, il doit, à regret, quitter un pays qu’il a appris à apprécier.
La période américaine

A l'arrivée d'une manche WERA à Daytona en 1996.
Après un bref retour en France, une nouvelle Carte Postale dans les pays de l’Est avec une 125 Yam TDR, Fred trainera ses bottes aux USA durant plusieurs années (avec en guise de stage d’adaptation 25 jours de prison à Volusia, Floride, pour avoir refusé de payer la caution suite à une interpellation par les pigs locaux au volant de son camion après une soirée un tantinet arrosée…) Pour la petite histoire, il parviendra, malgré la surveillance des matons ricains, à faire passer ses textes à Moto Journal avec la complicité de Mimi la Crêpe qui glissera les six pages de copie pissées en cellule aux journalistes de MJ venus couvrir la Bike Week de Daytona… Oui, Fred conduit, lui qui n’a jamais passé son permis auto en France, mais aussi vit et dors dans un gros Ford Econoline fatigué où il transporte d’abord une 175 Bridgestone, connue sous le doux nom de Brigitte puis une 175 Bultaco (Tacotte) avec laquelle il décroche un titre improbable de champion des USA en Vintage Pre-66 WERA, sorte d’AFAMAC à la mode Yankee, mais très nettement moins rapide...
Il relate ainsi durant des années sa vie de pilote moto fauché, les copains américains, le plaisir de retrouver la course et de voir du pays. Pauvre dans un pays de riche, Fred est heureux et il s’incruste assez : près de sept ans chez l’Oncle Sam, un record pour Fred qui squatte le terrain d’un Québécois adorable avec son Ford.

Sur un circuit californien au guidon de Tacotte

Fred obtiendra un titre de champion des USA WERA avec sa 175 Bultaco
Et puis la bougeotte, le mal du pays, une certaine lassitude des ricains, peut-être…Fred embarque Grosbébé, Tacotte et Grenouille, une 125 Cagiva prêtée par Marcel Seurat, sur un cargo mixte, direction la France.
Il tape d’abord l’incruste chez son frangin Patrick puis chez sa mère à Troo, dans le Loir et Cher… Jusqu’à ce qu’à nouveau, l’appel du large…

Avec Stéphane, alias Petit Prince, au guidon de la Guzzi Saviem de Paulo Salvaire

avant de partir sur les routes, Fred assurera le reportage de nombreuses courses de vitesse pour Moto Journal et France Moto
Le dernier voyage
On aurait pu le croire rentré dans le rang, payant ses impôts et ne se mouchant plus dans les rideaux, mais chez Fred, une période de calme est immédiatement suivie par une période d’agitation et c’est à nouveau le départ, pour une autre saga de la Carte Postale. L’ambiance qui règne désormais à Moto Journal où tout excès de comportement ou de langage dont Frédo est parfois coutumier ne semble désormais plus de mise n’a pas l’heur de lui plaire et il n’a plus qu’une idée, à nouveau tailler la route.
Cette fois, la moto est une Zongshen chinoise confiée par l’importateur, Pierre Laurent-Chauvet. Fred se faufile en Chine avec la 125, avant de passer la frontière vietnamienne, pays dont son père est originaire (et qu’il a quitté en 1925…) La magie de ce pays attachant opère et Fred décide, à la surprise générale, de poser enfin et définitivement, ses valises. Bien entendu, le clash est consommé avec Moto Journal qui n’a que faire d’une chronique, même à la Fred, du Vietnam et le globe-trotteur sédentaire qu’est devenu Fred n’intéresse plus. Mais qu’importe, Fred a pris sa décision, c’est là, enfin, qu’il veut être. Mais un an à peine après son installation dans une bicoque de 16 m2 dont il croit être le propriétaire, coincée au fond d’une ruelle tortueuse et passablement cradingue de Hoan Kiem, dans le quartier du vieil Hanoï, au bord du Fleuve Rouge, Fred tombe malade et le 20 juillet 2011, le mal insidieux qui le ronge –le même que celui qui emporta Barry Sheene, autre grand fumeur-a raison de lui. Fred a rejoint l’astéroïde B612, son numéro de course pour l’éternité.
« La mort n’est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté. Ne prends pas un air solennel et triste. Continue à rire de ce qui nous faisait vivre ensemble. Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ? Je t’attends. Je ne suis pas loin. Juste de l’autre côté du chemin. »

Une des dernières photos de Fred, prise au Vietnam : anar, certes, mais grand coeur aussi.

Noël en famille : chez ses parents, dans le Loir et Cher

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
titi-l'anar88 aime ce message
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde

:thanks: cob,
pas tout lu, j'men garde sous le coude tellement c'est bon


jef
-

Nombre de messages : 3388
Age : 52
Localisation : Mont Dore
Moto : Bandit 1200
Date d'inscription : 13/07/2011
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Excellent Cob
Merci
J'aurais aimé le rencontrer ce mec là
je pense que l'on a pas mal de choses en commun

Kriss
-

Nombre de messages : 3894
Age : 64
Localisation : Nouméa
Moto : BMW F800R & Royal Enfield 500
Humeur : Massala - Chaï
Date d'inscription : 14/04/2008
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Et ça m'a permit de me rendre compte qu'un post trop long génère une erreur..et si tu n'a pas "copié" ton texte avant...et bien, on recommence! Et c'est donc la cause de certains sujets tronqués en plusieurs post.

cobalt57co
-

Nombre de messages : 11732
Age : 55
Localisation : Nouméa
Moto : T'es de la police?
Humeur : Bonhomme...
Date d'inscription : 27/02/2009
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
merci pour ce post. La lecture est vraiment passionnante .
Génial
ducat848
-

Nombre de messages : 7
Age : 61
Localisation : Nouméa
Moto : ducati 848
Date d'inscription : 30/09/2012
 Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Re: Fred Tran Duc - La carte postale du bout du monde
Semaine prochaine, je suis en wouacancy, je lirais donc ce que j'ai pas lu ce soir parce que tout d'un coup, ça fait beaucoup pour mes zieux...
:thanks: Cob' pour ce bel article !!
 Fred me manque
Fred me manque
Merci, grazie Emile, gracias, شكرا لكم , cảm ơn...
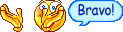
En 1987, quand j'ai découvert Moto Journal, j'ai tout de suite été passioné de "La carte postale du bout du monde". Je me jetais dessus chaque jeudi !
Tout comme je chérissais le tome 1 de ses voyages, que j'ai lu 2 ou 3 fois.. Malheureusement, j'ai beaucoup déménagé au cours de ma vie, et j'ai perdu ce livre. J'ai passé pas mal d'annonce dans MJ, mais personne n'avait un exemplaire à me vendre.
Et puis, cette semaine, je suis tombé par hasard sur votre forum, et surtout sur ton post Cobalt.
Quel merveilleux travail tu as fais là ! Chapeau (casque) bas l'ami !
Bon maintenant il faut que je trouve un moyen d'imprimer ton post et que ça soit lisible.
Je lis beaucoup, mais je n'aime pas trop lire sur PC et encore moins sur tablette ou téléphone.

titi-l'anar88
-

Nombre de messages : 2
Age : 54
Localisation : Vosges 88
Moto : Aprilia Falco transformée
Date d'inscription : 09/02/2022
 Sujets similaires
Sujets similaires» La carte grise
» Recherche cuisinier confirmé
» BD à nouzautes
» Cherche 1 carte SIM
Forum de Motards en Nouvelle Calédonie :: LE COIN DES MOTARDS... :: MOTOS ET MOTARDS : DU SERIEUX A L'HUMOUR





